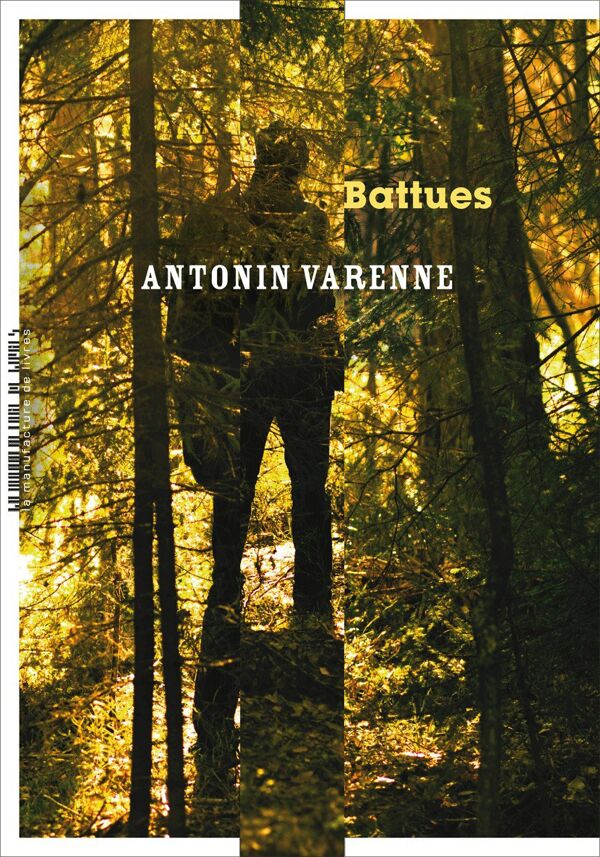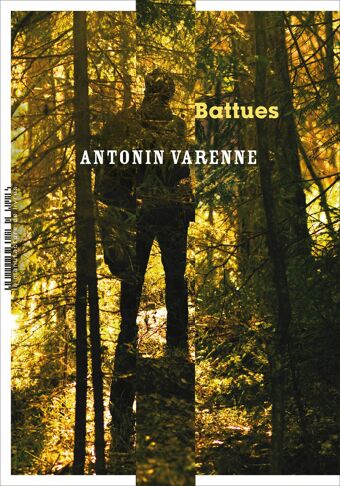
Antonin Varenne
Battues
Philippe Mazenas, garde forestier, a disparu. Après plusieurs jours de recherche, son meilleur ami, Rémi Parrot, découvre en forêt son corps mutilé par les bêtes sauvages. Dans cette affaire, la profusion des rancunes qui se révèlent au fil des interrogatoires ne cesse d’allonger la liste des suspects. On pourrait croire à un règlement de compte, mais à l’instar de la mémoire des hommes, la terre sait conserver les secrets. Et l’amour de jeunesse de Rémi choisit précisément ce moment pour réapparaître et attiser les tensions. En ce pays de rivalités ancestrales, l’heure de la battue a sonné.
Roman policier et roman d’amour, Battues nous propose un plongeon dans les secrets d’une ville où les hommes ne cessent de s’affronter pour la terre et le pouvoir.
Cette nouvelle édition du roman Battues, publiée dans le cadre de l’opération « 10 ans, 10 livres » de La Manufacture de livres, sera accompagnée d’une préface inédite de l’auteur.
- À chaque livre, Antonin Varenne force mon admiration pour la justesse et la profondeur de ses personnages, ainsi que pour la maîtrise de la narration et son talent à instiller une atmosphère.Rythmé et bien ficelé, ce récit surprend jusqu’à la dernière ligne.Un roman noir rural rugueux, sans concessions pour ses très beaux personnages, passionnant de bout en bout. C’est totalement réussi !Un véritable page-turner !Un roman qui nous tient en haleine !Un très bon roman noir où personne n’est innocent…
- téléchargez l’extrait
1
Vingt ans après l’accident, neuf jours après la découverte du premier cadavre, douze heures après la fusillade
Quand j’y suis née, R. était encore une ville. Quatre cents personnes travaillaient à l’usine Phillips. Vivre ici avait autant de sens qu’ailleurs. Il y avait une vingtaine de bistrots, des boutiques de vêtements. Les restaurants avaient des clients, il y avait la queue au cinéma le samedi soir, on construisait des lotissements autour de la ville. Les banques prêtaient à des ouvriers qui comptaient sur leur boulot pour les amener jusqu’à la retraite.
Les jeunes faisaient leurs études dans le département et revenaient travailler ici. Ceux qui allaient plus loin, à l’université, revenaient aussi parfois. Il y avait des architectes, des maçons, des charpentiers et des couvreurs. Les petits immeubles étaient habités, entretenus, ils valaient un peu d’argent. On se rencontrait au collège, au lycée, parfois même à l’école primaire. On se mariait à l’église et à la mairie. Les parents se connaissaient tous et ça ressemblait à des mariages arrangés, sauf que tout allait bien, alors on avait l’impression de faire ce qu’on voulait.» Les patrons de Phillips, des tanneries et des filatures n’avaient pas encore entendu parler des années 80. Les syndicalistes n’étaient pas des révolutionnaires et les arrangements se faisaient à l’amiable. Personne ne se souvient d’une manifestation dans les rues de R. Les salaires augmentaient tranquillement. La ville était pleine, pas d’espoirs démesurés, mais paisible, elle donnait l’impression que tout irait bien. À vingt ans, on savait qu’on aurait des enfants. On était embauché de père en fils ou de mère en fille. On reconnaissait les familles : mêmes boulots, mêmes vêtements, les mêmes épaules et des visages qui se ressemblaient d’une génération à l’autre. Si on voulait sa place, R. la gardait en attendant que vous soyez prêt. Les élections ne soulevaient pas de grands débats : il y avait du travail. Les candidats, depuis des décennies, étaient choisis dans le club des entrepreneurs de la ville. Les écoles étaient remplies, tout comme les clubs de sport et les centres de loisirs. Le supermarché était une curiosité pour les paysans qui venaient une fois par semaine faire des courses à la sous-préfecture. Deux fois par semaine, le marché bloquait la grand-rue, de la place d’Espagne au pont Neuf. Les fermes faisaient dix ou cinquante hectares.
Vous croyez que je suis nostalgique ? Pas du tout. J’ai toujours détesté R. Et je n’étais pas la seule.
Ce n’est pas parce qu’il y a du boulot qu’il n’y a plus d’adolescence. Et s’il n’y avait pas grand-chose d’autre comme injustice que l’ordre établi, ça suffisait bien à mettre quelques têtes brûlées en colère. Mais R. est indestructible. Les rebelles n’avaient pas besoin d’être matés, la ville se chargeait de les calmer. Des types qui tournaient mal, qui voulaient vraiment finir en taule, il fallait qu’ils aillent voir ailleurs. Pour ceux qui avaient juste besoin de ruer dans les brancards, il y a toujours eu les bals et les bistrots. À trente ans, c’était fini. On les saluait avec un sourire dans les commerces et à l’usine. Les adolescentes regardaient les bagarreurs avec admiration en les voyant au parc avec leur premier mouflet, en se disant qu’elles aimeraient bien en trouver un comme ça, aussi ; un dont on disait, à quarante ans et devenu contremaître : « Ouh ! Le Roger, fallait pas le chercher, dans le temps ! » On pouvait se faire une petite légende, ça faisait partie du folklore, ça occupait les apéros. Que R. soit un cimetière aujourd’hui, ce n’est pas très étonnant. La ville était déjà morte, à l’époque.Vous ne l’avez pas connu, il est mort avant que vous arriviez ici, mais R. est à l’image du père Barusseau. Il avait une épicerie dans la rue Vieille. Pendant dix ans, chaque mois, il a retrouvé sa vitrine peinte de croix gammées, de « salaud » et de
collabo ». À la mairie, c’était devenu une habitude de le voir débarquer, rouge à se faire éclater la carotide. Il balançait des coups de canne aux gamins qui s’approchaient de sa boutique. Il engueulait le maire et voulait qu’on retrouve les saligauds qui faisaient ça. La commune lui remettait un coup de peinture sur sa façade, mais, à force, les gars de la mairie en ont eu marre. Le maire a demandé à la gendarmerie de faire quelque chose. C’est finalement le cantonnier qui s’y est collé. Il a passé dix nuits à l’affût dans un jardin en terrasse, au-dessus de l’épicerie du père Barusseau. Un soir, il a vu le vieux sortir avec une chaise, un pinceau et un pot de peinture, et dessiner les croix gammées, écrire « salaud » en toutes lettres sur sa propre vitrine. Le maire est allé le voir et le vieux s’est mis à chialer comme une madeleine, à raconter qu’il avait fait du marché noir pendant la guerre, renseigné les Allemands et balancé des infos sur les résistants du coin. Le soir même, il s’est pendu.C’est comme ça qu’on raconte l’histoire, en tout cas. Et je me suis toujours demandé, quand je l’entendais, de quelle famille étaient les types qui rigolaient le plus fort.
Ici, la vie d’adulte ne laisse pas beaucoup de temps à l’enfance. Les femmes ont des gamins à vingt ans, et la raison la plus commune de divorcer est un mari qui tape trop fort, au point que ça se voit. Sinon, on s’accroche à ce qu’on a, parce que R. vous offre une chance, mais une seule. Si tu la rates, c’est terminé. Le cancer de cette ville, c’est la mémoire. Mais si vous voulez mon avis, la vraie plaie de R., c’est la gastronomie. Vous avez déjà goûté le pâté de pommes de terre ?
Je suis partie à vingt-deux ans. La fille Messenet. Le scandale. Quand je suis revenue… Mais vous savez à quoi ressemble la ville à présent. Phillips a fermé. Il reste deux filatures moribondes et un musée de la Tapisserie. La moitié des immeubles sont vides et fuient, les commerces de la grand-rue changent tous les ans et la moitié des boutiques sont à vendre. La population doit être la plus vieille d’Europe et, les soirs de bitures, les jeunes ne se foutent plus sur la gueule, ils vont se pendre à un arbre. Les plus petites fermes font cent cinquante hectares et ma famille possède la plus grosse de toutes. Il y a trois supermarchés et les usines ont fermé. Tout ce qu’il reste de possessions est plus gros et plus moche.
Pourquoi vous souriez ? Ça ne répond pas à votre question ?
– Tout ceci explique votre départ, mais je voulais savoir pourquoi vous étiez revenue.
– Mon père était malade. Est-ce que je pourrais avoir un café ?
– Brigadier, vous pouvez nous apporter du café ?– La maladie de votre père… cancer, je crois ?
– Les os. Mais ce n’est pas pour lui que je suis revenue. Il y avait quelqu’un d’autre que je voulais revoir.
– Monsieur Parrot. Vous ne vouliez pas le dire devant le brigadier ?
– Le brigadier, comme vous dites, Marsault, je le connais depuis l’école primaire. C’est un vieux copain de Thierry Courbier. Son père était un des types les plus hargneux du coin, avec ses mômes et surtout avec sa femme. Quand elle est partie Saint-Vaury en maison de repos, dans le coin les gens ont dit qu’elle avait une maladie du sang. Son mari est allé la voir une fois. Elle a avalé toute une armoire à pharmacie après son départ. En fait, il y a deux possibilités : ou bien Marsault est devenu aussi con que son père, ou bien c’est lui qui a mis un oreiller sur la bouche de son vieux le jour où on l’a retrouvé dans son lit, tout violet. Cette fois-là, les gens ont dit que c’était l’alcool. La prochaine fois que la femme de Marsault ne vient pas à un pot de départ ou à un barbecue de la gendarmerie, allez voir chez elle si elle n’a pas forcé sur le maquillage.– Mademoiselle Messenet, je suis désolé de vous poser toutes ces questions alors que vous traversez une période si difficile. Vous êtes épuisée et sur les nerfs. Peut-être devrions-nous remettre votre déposition à plus tard.
– Je ne sais pas ce qu’on vous a dit à propos de moi, mais je vous assure que même les pisse-vinaigre d’ici sont en dessous de la vérité. Je n’ai aucune envie d’attendre plus longtemps pour en terminer avec ce cirque. Si vous croyez que j’exagère, mettez ça sur le compte de la colère, ou même du deuil, si ça vous arrange. Si vous étiez d’ici, vous ne vous feriez pas des idées de flic en voyant une femme qui ne pleure pas, alors que partout ailleurs elle devrait.
– Je ne me fais aucune idée, je vous assure. Voulez-vous que je fasse remplacer Marsault ?
– Ça ne me dérange pas qu’il entende. Comme ça je suis sûr que tout le monde dans le pays sera au courant. Vous croyez que parce qu’il est gendarme il n’ira pas tout raconter ? Soit vous êtes naïf, soit ça vous arrange.– Ces affaires exceptionnelles mobilisent tous nos effectifs en attendant le retour des enquêteurs de la police judiciaire. Tous mes hommes sont sur le terrain et le brigadier Marsault est le seul sous-officier de permanence ce matin.
– Bien sûr.
– Nous pouvons rester tous les deux, si vous le souhaitez. Nous enregistrons votre témoignage, comme je vous l’ai dit. Vous n’aurez pas à déposer à nouveau devant les OPJ. Vous êtes certaine de vouloir continuer ?– Je vous ai dit ce que j’en pensais.
– Bien. Vous disiez que vous étiez revenue pour monsieur Parrot. C’est la seule raison ?
– Vous voulez dire qu’un type comme Rémi n’est pas une raison valable de vivre ici ? Je suis entièrement d’accord. Le seul problème, c’est que cet abruti n’a jamais voulu partir.– Nous pourrons en reparler, mais si cela ne vous dérange pas, j’aimerais revenir en arrière. Ce que vous avez fait avant votre retour.
– Vous voulez parler de mon casier ?– Sucre ?
– Oui, merci.
– Il y a deux ans, à Toulon, vous avez été arrêtée et condamnée pour trafic de stupéfiant. Cocaïne. Possession avec intention de revendre. Cent cinquante grammes. Dix-huit mois, dont douze avec sursis. Un mois de préventive, et vous avez finalement purgé une peine de trois mois au centre pénitencier de Farlède. Vous avez prétendu ne faire que la nourrice et ne jamais avoir vendu. Vous faisiez ça pour l’argent ou pour la drogue ?– Ça revient au même, non ? Mais si vous voulez, oui, je faisais ça pour la drogue.
– C’est de cela dont vous rêviez, en quittant R. ?– Exactement.
– Excusez-moi, mais vous êtes une belle femme. La prison n’a pas dû être facile.
– Je suis aussi une fille de paysan. Je m’en suis sortie. Et je n’ai pas fait que de la prison pendant les huit ans où je suis partie.
– Rémi Parrot a déclaré, je cite, que « vous avez toujours été trop belle pour cet endroit ». Qu’est-ce que cela veut dire,votre avis ?
– Il a dit ça ? »
2Vingt ans après l’accident,
dix jours avant la découverte du premier cadavre
La meneuse s’éloigna de la harde, s’approcha de la rivière et tourna le dos à l’eau, face au vent. Elle releva la tête et huma l’air pendant une longue minute. Une bête de sept ou huit ans. Cent vingt kilos. Quatre laies de quatre à six ans, quatre bêtes de compagnie, trois portées de marcassins. Rémi en compta douze dans la lumière verte des jumelles, en train de fouiller l’herbe nerveusement. La harde était en bonne santé, signe que la meneuse était une bête intelligente. Les femelles tournaient autour de la carcasse de chevreuil, attendant le signal. La meneuse quitta son poste d’affût et trotta jusqu’à la dépouille. Sans hésiter, elle planta ses défenses dans l’arrière-train. D’un seul mouvement de tête, elle arracha vingt centimètres carrés de peau et de pelage, mettant les muscles à nu. Les membres de la harde la rejoignirent et le repas débuta. Les pattes du chevreuil étaient dressées en l’air, secouées par les coups de groin et de défenses qui fouillaient son abdomen.Le froid commençait à traverser ses vêtements. Rémi posa lentement les jumelles infrarouges sur le tronc couché devant lui, réunit ses mains et souffla dessus pour les réchauffer. Il aurait pu repartir maintenant que le relevé était fait, mais il décida d’attendre la fin du repas et d’inspecter la carcasse. Il roula doucement sur le côté, s’allongea sur le dos et regarda le ciel entre les frondaisons, bercé par le bruit du vent dans les branches. Il enfouit ses mains dans les poches de sa veste, ferma les yeux et s’assoupit.
Le vent était tombé quand il rouvrit les yeux. Il entendait au loin le bruit étouffé de la retenue. Les arbres s’étaient tus. La rivière était presque immobile à cet endroit, ralentie par le petit barrage de la pisciculture. Il roula sur le ventre, retrouva les jumelles à tâtons et les braqua sur le chevreuil mort. Les marcassins avaient disparu, ainsi que trois des femelles. Les jeunes mâles, groins noirs de sang, étaient immobiles, reniflant l’air. La meneuse avait de l’eau jusqu’au ventre et regardait dans sa direction. Rémi retint son souffle. Dans le spectre des jumelles, il voyait ses yeux : deux billes de vert acidulé braquées sur lui. Une crampe monta le long des muscles de son dos. Il inspira un peu d’air pour libérer sa cage thoracique. Le souffle de la bête courait sur l’eau. Elle resta sans bouger encore quelques secondes, le reste de la harde dans l’attente de sa réaction.
Rémi attendit lui aussi.
La femelle tourna la tête à gauche et à droite, effleura la surface de l’eau de son groin, lapa deux gorgées d’eau et recula vers la berge sans quitter des yeux la direction de sa cache. Les mâles se regroupèrent en silence, abandonnèrent ce qu’il restait de viande de la dépouille, puis la harde disparut derrière les arbres.Il longea la Thaurille jusqu’au barrage, traversa à gué et remonta la berge jusqu’au lieu du repas. Il s’arrêta de marcher quelques mètres avant, écouta le silence et alluma sa torche électrique.
Il restait à manger. Après les corbeaux et les renards, les sangliers dévoraient habituellement jusqu’aux os. Mais la meneuse n’avait pas laissé de place au doute. Des bêtes sans prédateur, que leur instinct poussait à éviter l’affrontement.
Le brocard n’était pas blessé, du moins dans les parties intactes du cadavre. Rémi souleva les babines et écarta les mâchoires. Il estima son âge à trois ou quatre ans. Il éclaira la colonne vertébrale, tira le Buck de son fourreau et, de la pointe, inspecta une marque, écartant les chairs. Il incisa le long des vertèbres sur trente centimètres, écarta la fourrure et la peau. Les nodules étaient répandus de façon uniforme sur toute la surface des muscles, les cicatrices de sortie étaient noires. Infection. La ponte des œufs et la migration des larves dataient de l’été. Varron. Le brocard était affaibli. Les premiers parasites du printemps l’avaient achevé.
Personne d’autre que les sangliers n’aurait pu profiter de cette viande. Il enfila des gants de cuir, saisit le chevreuil par les bois et tira la carcasse sur une dizaine de mètres, l’éloignant par précaution du cours de la rivière. D’ici un ou deux jours, il n’en resterait rien.
Le froid de l’eau montait jusqu’à lui. Il s’accroupit, ôta ses gants, lava le couteau, puis se rinça les mains. Il aspergea son visage et ses yeux chauds de fatigue. Avant de se relever, il resta là, dans la position de la meneuse, à regarder l’autre rive où il s’était tenu à l’affût.
Il marcha jusqu’au barrage, traversa la Thaurille, remonta le GR1 pendant cinq minutes, bifurqua à travers bois et longea une parcelle de ray-grass en pousse avant de retrouver le Hilux garé sur la piste forestière.
il s’assit au volant, alluma la veilleuse, tira le carnet d’inventaire de la boîte à gants et regarda l’heure au tableau de bord.
Inventaire destruction administrative. 25/03/2012. 02 h 45. Thaurille, berge nord. Harde n° 4. Meneuse 6-7 ans, + / - 120 kilos. Compagnie : quatre mâles, 12 à 24 mois, quatre laies (5-6 ans), douze marcassins. Passage : communes Saint-Feure/Pontgiraud. Parcelles AZ 35/36/41, nord-ouest/sud-est. Itinéraire : source Gartempe/berge Thaurille, deux cents mètres amont retenue pisciculture. Consommation : charogne brocard (+ / - 4 ans). Décès : varron saison 2011 + parasi-tose). »
Il rangea les documents, éteignit la veilleuse et démarra.
Le faisceau des phares rebondissait sur les racines et les trous du chemin. Il rétrograda en seconde, laissa le gros diesel l’emmener au ralenti, jusqu’à ce que les ampoules puissantes balayent la maison en une poursuite désordonnée. Il gara la voiture sous l’auvent du garage et coupa le contact.
Il entra sans allumer, retira ses chaussures et son pantalon trempé, jeta la veste et s’allongea sur le lit, en pull et en caleçon. Le sommeil qui l’avait surpris dans les bois se refusa à lui.
Il resta sur le dos jusqu’à l’aube, dans les odeurs de lasure et de vernis. Depuis l’hôpital, les endroits neufs le rendaient insomniaque. Il attendit l’aube, se persuadant qu’allongé il récupérait toujours mieux que debout.Quand la première lumière du jour grisa la maison, il se leva et, pour sauver les apparences, se prépara un petit déjeuner, plongeant le nez dans son bol de café au lait pour ne plus sentir la maison. Il fit descendre les comprimés avec la dernière gorgée tiède, se leva pour poser le bol dans l’évier, et fut pris de vertige. Un instant, le décor prit les couleurs vertes des jumelles infrarouges. Le manque de sommeil devenait inquiétant. Les doses de codéine, avec la fatigue, étaient de plus en plus nécessaires.
Il prit sur l’étendoir un uniforme lavé. Comme sa maison neuve, les vêtements propres le gênaient. Pour secouer sa torpeur et assouplir les tissus rêches, Rémi attrapa le merlin et s’attaqua au tas de bûches benné devant la maison. L’effort dénoua son corps. Une heure durant, le bruit de la cognée éclatant le chêne occupa son esprit. Il empila le bois contre le pignon et le protégea à l’aide d’une vieille tôle ondulée. La transpiration coulait sur son visage. Il se rinça au robinet extérieur et se prépara un sandwich qu’il mâcha lentement à l’ombre du porche.
Le terrain était encore défiguré par les travaux d’abattage et de défrichage, les tranchées de l’assainissement, du réseau électrique et de l’eau. La prairie semée deux semaines plus tôt commençait à germer. Sur la terre sombre, un duvet de vert colorait ce coin de forêt remodelé. Il avait laissé le plus possible d’arbres et de noisetières, jusqu’aux genêts qui poussaient en haut de la butte, là où le granit affleurait. Dégager la surface nécessaire à l’implantation de la maison, au chemin d’accès et aux tranchées, éclaircir le bois pour laisser le soleil donner sur la construction, tout en laissant la maison invisible depuis la prairie au nord, et en se protégeant des vents dominants et des pluies du sud-ouest. L’orientation était bonne et la maison en bois massif réagissait bien aux écarts de température, violents dans la région. Au soleil de midi, le thermomètre à l’ombre du porche affichait 17 °C. Cette nuit, quand il était rentré, le givre se déposait sur le sol. La fuste encaissait sans problème et le poêle à bois suffisait largement à chauffer l’habitation ; elle conserverait aussi la fraîcheur en été. La maison craquait le matin en se réchauffant, le soir en se refroidissant. Il aimait l’entendre réagir aux éléments extérieurs.
La Terre Noire avait toujours été une belle parcelle que son père, avant les dernières années, avait bien entretenue. La maison, un carré de huit mètres de côté, était assemblée avec les fûts des Douglas abattus sur place. Les deux hectares de prairie situés au-dessus donnaient toujours du beau fourrage, récolté par le fils Fernin depuis qu’il louait le terrain.
Rémi observait la nouvelle petite clairière dans laquelle il s’était installé, se disant qu’il ne manquait qu’un peu de temps pour effacer les traces des travaux. Juste un emprunt, se disait-il. La beauté de l’endroit, bien mieux que son besoin de confort, justifiait – ou excusait – qu’il en fît usage. La Terre Noire était aussi, bien qu’il se défendît d’y accorder de l’importance, le dernier morceau de la ferme Parrot.
« Je veux vendre », avait dit sa sœur.Rémi avait accepté sans discussion. Sauf pour la Terre Noire.
Martine vivait en ville depuis déjà longtemps quand ils se retrouvèrent sans parents. Ils avaient vendu la propriété comme une carcasse au boucher. Courbier et Messenet les avaient courtisés pendant des semaines, marchandant arpent par arpent le moindre terrain exploitable. La bataille foncière des deux familles, un instant, était passée par les petits-enfants Parrot. Une stratégie de guerre froide, dont il avait fallu se tirer sans devenir otage de l’un ou l’autre camp. La maison de Rémi était à présent une enclave le long de la frontière des deux plus grandes propriétés de la région.
Il étala sur la table ses papiers et ses notes.L’inventaire, avec la harde de cette nuit, était presque terminé. Il rédigea le rapport à transmettre à la préfecture, puis il déplia la carte IGN et prépara, traçant des lignes au crayon, le planning de ses rondes sur la zone du Plateau. Les courbes de niveau et les noms de lieux-dits devinrent flous. Il avala un com-primé avant que la douleur l’empêche de penser. La codéine fit effet en quelques minutes, mais il abandonna la carte, enfila sa veste et se dirigea vers le Toyota. Il souleva la bâche jetée sur le plateau du pick-up, attrapa deux pièges à cage et des collets
pour les ranger dans l’armoire à outils. Les collets étaient en fils de cuivre. De fabrication artisanale et une signature connue. Le cuivre était noirci par les flammes : des fils électriques dont les gaines plastiques avaient été brûlées dans un fût de deux cents litres. La récupération de la ferraille et du cuivre, avec ou sans le consentement des propriétaires, était une spécialité des manouches, par ailleurs et traditionnellement les meilleurs braconniers du coin.Il manœuvra entre les arbres et lança le tout-terrain sur le chemin. Un autre 4x4 arrivait en sens inverse ; un vieux Lada piqué de rouille dont s’échappait, par les fenêtres ouvertes, un magma de guitares électriques et de chant rauque. Rémi braqua vers les arbres et les deux roues avant du Lada dérapèrent dans la terre sèche, soulevant un nuage de poussière brune. Les deux cabines côte à côte, Rémi baissa la vitre de sa portière. Un instant, la musique lui vrilla les tympans, enrayant les effets de la codéine. Il plissa les yeux. La poussière se dissipa dans le vent et la musique s’arrêta.
Salut.
– Salut.
Les deux hommes s’observèrent d’une cabine à l’autre.– T’as cinq minutes ?
– Faut voir.
– C’est tout vu, fais demi-tour. »
Le Lada redémarra jusqu’à la fuste et s’arrêta à côté du tasde bois en vrac. Rémi enclencha la marche arrière.
Jean était assis sur les marches du porche quand il le rejoignit.
« Bière ?
– Demande à un marin s’il veut revoir la mer. »Rémi ressortit de la maison, une bière et une bouteille d’eau pétillante à la main.
Si t’en veux d’autres, faudra que t’ailles en acheter. C’est tout ce que t’as laissé la dernière fois.
– Laisse tomber, faut que je te dise un truc.
– On dirait. »
Jean moucha la bière en trois gorgées.
T’es pas venu à la fête patronale de Sainte-Feyre, hier ? » Rémi esquissa un sourire.
Ben t’aurais dû. Peut-être que t’aurais pu arrêter cette connerie. Ou si on avait été tous les deux.
– Qu’est-ce qui s’est passé ?
– Tout le bled était là. Quand les Courbier paient la tournée, la commune entière se pointe en remerciant. L’après-midi, autant te dire que j’y étais pas. C’étaient les manèges, les mômes en costumes, la chorale de l’école et tout le tremblement. Après, par contre, y’avait le bal de la TechBois.– Sûr que c’est pas très joli à voir, un bal, mais c’est pas non plus un drame.
– Quasiment tous les gars de l’usine étaient là, au début avec les femmes et la marmaille en âge de roter. Passé minuit, y’avait plus que des braves, ça volait plus très haut. Thierry Courbier était là, bien sûr, avec quinze mecs autour de lui qui rigolaient dès qu’il ouvrait la bouche pour bâiller. J’étais avec Tonio, qui sent les ennuis arriver une heure à l’avance, à force d’avoir foutu la merde partout où il passait, ce con. Il m’a dit comme ça : « Je me tire, ça pue. » Y’avait déjà quelques types du camp Valentine qui étaient à l’entrée et qui essayaient de passer. Le service d’ordre de la TechBois était sur les nerfs et voulait pas laisser entrer les manouches. Tonio avait raison, ça sentait pas bon. Mais j’avais la gueule au vin, et j’crois que ça m’avait rendu curieux aussi. J’aurais dû chronométrer.1 heure du mat’, Philippe s’est pointé. Jamais vu dans cet état. Bourré, ouais, d’accord, mais surtout remonté comme un coucou à réaction. Il a foncé direct sur Courbier, en gueulant qu’il voulait voir son père. Il a continué en gueulant encore plus fort qu’il fallait fermer la TechBois, cette usine à merde, etc. Tu connais le refrain quand Philippe se lance là-dedans. Mais bon, quand on est chez toi, c’est une chose, là c’était le bal des Courbier, avec le prince héritier en personne qui se faisait cracher
la gueule devant tous ses fans. Courbier a même pas levé la main. Il a fait un signe de tête, comme un putain de mafieux de cinoche, et trois mecs ont attrapé Philippe. Des bûcherons. J’en connaissais un. On l’appelle le Gros. Mais c’est surtout qu’il fait un mètre quatre-vingt-dix. La graisse, elle est qu’au niveau du cerveau. Ils l’ont traîné derrière la salle des fêtes.
– Qu’est-ce que t’as fait ?
– L’alcool, ça amortit les coups, mais le lendemain ça fait quand même mal. Et puis c’était pas un truc de pochtrons, c’était de la rage. Ici, tout le monde se connaît, mais tout le monde est pas ami. Après, y’a ceux qui s’aiment pas. Y’avait de la haine, Rémi. Si j’avais mis le doigt dedans, j’aurais eu trois autres mecs de la Tech’ rien que pour moi. J’ai fait le tour par les sanitaires. Quand je suis arrivé, Philippe était déjà par terre. Alors j’ai attendu. C’est pas joli, mais y’avait qu’une chance, c’était d’attendre le bon moment, quand les mecs auraient assez cogné pour être contents d’eux, et juste avant qu’un connard balance un coup de pied dans la tête d’un type inconscient. Philippe encaissait encore un peu. Quand les trois ont commencéreprendre leur souffle, j’ai été voir de plus près. Le Gros m’a dit : « Qu’est-ce que tu veux, Jeannot ? Barre-toi. » Je lui ai dit que je voulais rien, à part qu’ils fassent pas une connerie. Je leur ai dit que l’écolo avait son compte et que personne devait finir en taule pour une connerie comme ça un soir de bal. Les mecs m’ont regardé un moment, mais j’avais pas besoin d’autres arguments, vu comment ils avaient déjà chiffonné Philippe. Le Gros m’a parlé en tapant avec son doigt sur ma poitrine, et ça fait quasiment l’effet d’un marteau. Il a dit que j’avais pas intérêt
me mêler de ça, qu’il valait mieux que je ramasse le hippie et que je revienne pas au bar. C’est exactement ce que j’ai fait.
– Comment il va ?
– C’est pas beau, mais y’a rien de grave. Il est costaud, l’écolo. Faudrait juste qu’y fasse pas une déprime ou une connerie quand il tiendra debout.
– Il est chez lui ?
– C’est là que je l’ai laissé ce matin. »
Rémi s’appuya à un poteau du porche et but quelques gorgées au goulot de la bouteille d’eau. Le muscle buccinateur de sa joue gauche, encore mobile, se contracta, soulevant un coin de sa bouche.
« Je passerai le voir. »Jean leva son cul des marches et arpenta le porche, jetant un œil aux menuiseries en mélèze qui commençaient à jaunir sous l’effet des UV.
Faudra que tu lasures si tu veux pas qu’on refasse tout dans dix ans. »
Il se tourna vers Rémi, perdu dans ses pensées.T’en fais pas. Tu sais bien que ça finit toujours comme ça par ici. Avec les Courbier et les Messenet, avec les gars du bois, avec les chasseurs, avec tout le monde. Avec ton uniforme et ta cahute au milieu des bois, c’est juste que t’as perdu l’habitude. Faut pas s’en faire.
– Ouais. On enterre et on laisse pourrir jusqu’à la prochaine cuite et la prochaine bagarre.
– T’es du coin, tu sais ce que c’est de glisser la merde sous le tapis. »
Rémi avait enfilé sa casquette et descendait les marches. Il s’arrêta, une main sur la balustrade.
Je peux savoir de quoi tu parles ?– À ton avis ? »
Rémi baissa la tête, le visage plongé dans l’ombre de savisière.
Elle sait où j’habite. Faut que j’y aille. Tu peux rester si tu veux, mais vu l’état de mon frigo, je suppose que tu vas aller voir ailleurs.
– Tout juste.
– Faudra qu’on voie pour la cabane à outils, le garage est vraiment trop juste. Tu me diras quand tu as du temps.– Bientôt, parce qu’après je crois que je vais me tirer d’ici. Je prends un avion et je vais dans un coin où y’a moins de monde et plus de bêtes. Ou juste un endroit où la différence est plus claire.
– Autre chose. J’ai encore trouvé deux cages et des collets du côté de la pisciculture. Tu diras à Tonio de faire passer le message au camp. Les gars de l’ACCA commencent à être remontés. Les manouches sont pas toujours responsables du braconnage, mais quand les chasseurs leur mettent tout sur le dos, faut avouer qu’ils ont quand même raison une fois sur trois. La prochaine fois, faudra que je fasse un rapport, et y’aura une copie pour la gendarmerie.
– Je passerai le message, au cas où. »
Rémi relança le Hilux sur le chemin, le Lada de Jean colléson pare-chocs. La sonnerie de son portable résonna dans la poche de sa veste. Il décrocha et regarda dans le rétroviseur. Jean à l’autre bout du fil.
Quoi ?– Comme t’avais pas l’air de te décider, j’ai organisé la crémaillère. J’ai invité tout le monde samedi prochain.
– Qui ça, tout le monde ? J’ai pas envie de voir du monde.
– Panique pas. Philippe, ta sœur, son jules et leurs mômes, Bertrand et Marie, Polo, Bertin et sa femme qui viendront aussi avec leur gamine. J’en ai pas parlé à Tonio, mais…
– Laisse tomber.
– On a fait du bon boulot, ça se fête. Je suis passé à la boutique de Michèle, hier, pour lui donner la dernière facture. C’est sympa son magasin. Tu devrais aller t’acheter des bas résille.
– Pourquoi tu me racontes ça ?
– Parce que je l’ai aussi invitée. »
Rémi freina au milieu du chemin.
« Quoi ? »
Le 4 x 4 de Jean fit une embardée dans le fossé et le dépassa sans ralentir.Je lui ai dit que le message venait de toi. Elle a dit qu’elle passerait peut-être. »
3Vingt ans après l’accident,
neuf jours avant la découverte du premier cadavre
Rémi entra en ville sans s’en apercevoir, avant de réaliser au rond-point du pont Neuf qu’il déboulait à quatre-vingts. Il ralentit et prit la mesure de sa nervosité.Depuis combien de temps n’était-il pas venu en ville ? Une semaine ? Deux ? Moins il venait ici, mieux il se portait. Il ralentit, quitta le centre-ville et s’engagea sur la route du Mont qui conduisait à la clinique de la Croix-Bleue, au centre des impôts,
la gendarmerie. Dans le dernier virage, avant de traverser le lotissement et d’arriver à la caserne, la vue s’ouvrait sur R. et ses trois vallées pentues, traversée par la rivière. Les immeubles en granit couverts d’ardoises, serrés les uns contre les autres
flanc de collines, les jardins en terrasse. La tour de l’horloge récemment restaurée, la grand-rue. Les ruines du château qui surplombait la sous-préfecture. En face de la mairie, la nouvelle boutique de Michèle.Dans ces collines, les ados venaient se bécoter, des ivrognes finir la nuit, des jeunes se shooter au milieu des genêts. On avait retrouvé quelques suicidés sur la colline de la tour. Dans les buissons, vivaient des lièvres et des lapins, des grives, des perdrix, des blaireaux, des martres et des fouines. Il y avait deux ou trois passages de cochons. En restant à l’affût quelques heures,
on avait toutes les chances de voir passer des chevreuils. La nuit, les hérissons pullulaient et les gens du camp posaient des collets. Rémi avait passé des heures à observer les oiseaux dans ces bois et ces buissons. Il y avait les mêmes à cent mètres de la ferme, mais il aimait espionner les animaux et entendre en même temps les bruits de la ville.Ils étaient venus un soir à la lune, avec Michèle ; ils devaient avoir quinze ou seize ans. Rémi avait fait la route depuis la ferme en mobylette et il ne se souvenait plus comment elle était arrivée jusque-là, depuis la maison Messenet, de l’autre côté de la vallée de la Gartempe. Peut-être qu’elle avait fait les trois kilomètres à pied à travers bois. C’était le début de l’été, elle en était capable. Quinze ans. Elle devait entrer au lycée à la rentrée suivante. Pour lui, c’était différent. Le proviseur l’avait convoqué avant les grandes vacances. Rémi n’aimait pas aller dans son bureau ; cette impression d’amener une odeur d’étable au milieu des papiers. Ce jour-là, le proviseur ne lui avait pas parlé des bagarres ou de ses absences à cause du travail à la ferme, mais de son avenir et de ses « possibilités ». « Vous devez aller au lycée, Parrot. » C’était ce qu’il avait dit. Comme si c’était aussi simple que ça : « Vous êtes un bon élève, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire plus tard ? » La question l’avait abasourdi. Mais la décision ne dépendait pas de lui. Les foins avaient commencé. À la rentrée, c’était le lycée agricole.
Il avait essayé d’en parler à sa mère, ce soir-là. Elle avait rougi et lui avait dit d’attendre, peut-être, que la fenaison soit finie pour en parler à table. Il n’avait pas eu le temps de le faire.
Avec Michèle, ils avaient passé des heures à regarder la ville d’en haut, en attendant la nuit. Ses yeux noirs fixés sur les premières lumières des rues de R., elle disait déjà qu’elle voulait partir. Quand elle parlait de quitter cette ville pourrie, le cœur de Rémi s’accélérait. Pas de départ pour lui. Les foins et le lycée agricole. La ferme. Il avait voulu prendre sa main dans la sienne, puis avait renoncé. Il ne pouvait pas la retenir. Elle partirait et lui resterait.
Cet adolescent qui découvrait à tâtons les murs qui l’entouraient, il le sentait encore au fond de lui, accroupi dans un buisson, la main serrant du vide. Des poupées russes. Le temps recouvrait étape par étape des morceaux de lui-même qu’il ne serait plus. Plus on remonte dans le temps, moins on est de personnes à la fois, mélangées les unes aux autres. Ce soir-là, c’était l’adolescence, l’âge du discernement entre enfants et adultes, amis et connaissances, imbécillité et intelligence. Dans les cours du collège, on ne jouait plus avec tout le monde, les groupes se formaient par affinités et ressemblances. À R., cela prenait une tournure définitive.
Rémi était le seul garçon d’une famille installée ici depuis seulement trois générations. Un grand-père breton, après guerre, venu profiter des terres que le Gouvernement bradait pour repeupler ce coin vidé par l’exode rural. Mais la légende disait aussi que le grand-père Parrot avait quitté la Bretagne parce qu’il y avait eu trop d’ennuis. Rémi ne l’avait pas connu, mais quelques vieux se souvenaient encore de lui. Parrot, dur à la tâche, alcoolique, violent, pas d’ici. Dans les poupées russes, avant l’adolescent et avant l’enfant, il devait y avoir un grand-père en train de brailler, de picoler et de taper sur sa femme, pour l’enrober ; un père à la gentillesse rougie par le vin, avec sur les épaules une ferme en piteux état. Rémi trimballait en lui cette lignée d’hommes jamais assimilés. Sa vie de reclus et son travail solitaire semblaient à tous une fin logique pour cette dynastie déracinée et sans succès.
Assis au-dessus de la ville cette nuit d’été, il ne voyait aucune autre issue ou possibilité que la ferme, celle qui avait tué son grand-père et s’attaquait maintenant à son père. Il n’y avait que deux enfants Parrot. Lui et sa sœur Martine, en apprentissage dans un salon de coiffure de la ville. C’était son héritage d’homme. À quinze ans, il était assez costaud pour travailler.
Quelques jours plus tard, les médecins allaient déclarer que la solidité de ses os était la seule raison de sa survie. Michèle et Rémi ne savaient encore rien de leurs faiblesses ou de leurs forces.
Le virage déboucha sur la ligne droite du lotissement. Les pavillons crépis commençaient à vieillir. Les tuiles mécaniques avaient foncé et se couvraient de mousse sur les rampants nord, les portails et les barrières en bois peint s’écaillaient. Quand il était au collège, les enfants qui vivaient ici, dans ces maisons neuves dominant la ville, étaient des rois. Comme le bureau du proviseur, un endroit où Rémi n’osait pas venir dans ses vêtements de paysan. Au bout de la rue, il avisa le portail bleu marine de la caserne.
De cette vision instantanée de la ville, balancée par le virage, il ne lui resta que cette impression qu’il avait toujours eue
– peut-être héritée de Michèle – que les trois vallées écrasaient tout ce qui vivait entre elles. Et cette phrase qui tourna dans sa tête jusqu’à ce qu’il gare le Toyota dans la cour de la gendarmerie : « Il n’y avait que deux enfants. »Marsault était à l’accueil. Lorsqu’il leva les yeux vers Rémi Parrot, il eut cette réaction que le garde-chasse avait pris l’habitude d’ignorer : ce flottement du regard qui ne savait pas où se poser sur son visage.
Salut Arnaud.
– Salut Rémi. »
Marsault. Clan Courbier. Adolescent grande gueule et bagarreur, ami d’enfance de Thierry Courbier. Comme presque tous les mômes de R., il en pinçait à l’époque pour Michèle. Marié avec la fille aînée du bistrot Marcy. Un ou deux enfants. Flic. Rémi se demanda s’il était au bal, samedi dernier, quand les bûcherons de la TechBois avaient tabassé Philippe.Rémi n’avait jamais éclairci son rapport avec les flics. Il était assermenté, avait pouvoir de police judiciaire, possédait une paire de menottes, une arme de service, bien qu’il ne la portât que rarement. Dans son domaine, il pouvait enquêter, verbaliser, demander une arrestation. Ces points communs ne lui suffisaient pas à se sentir proche du flic qu’il avait en face de lui. Il travaillait avec eux, parfois, rien de plus. L’expression « police de la nature » lui écorchait les oreilles.
J’amène le plan de battue. L’inventaire est terminé. Tout est dedans. Les parcelles, les postes, les horaires. La liste des tireurs est pas encore bouclée, c’est Valleigeas qui fera la louveterie. »
Marsault prit les papiers et consulta la première page, profitant des documents pour ne plus regarder Parrot en face.
Ouais, il a jamais su se décider, Valleigeas. »
Rémi traduisit facilement. Pour les grandes battues, tout le monde voulait en être. Ça voulait dire d’un côté les Courbier, de l’autre les Messenet. Chacun une ligne de tir et chacun des amis à placer dedans. Valleigeas, garde champêtre de Sainte-Feyre, n’était l’ami d’aucun clan. Depuis deux mois, il devait recevoir des coups de fil et se faire inviter à des apéros où on lui glissait des noms, des conseils ou des menaces déguisées en blagues jaunes. Indécis, Valleigeas, qui essayait comme beaucoup de ne pas se faire plus d’ennemis que nécessaire, sans prendre parti.
Quatre-vingt-cinq bracelets ! Lenoir va plus avoir un seul congélateur à vendre. Dix-huit rabatteurs, vingt-huit tireurs. Il aura plus une seule balle non plus. »
Marsault ne releva pas la tête.
« Tu y seras ?
– Ouais, en sortie. Pas envie de me retrouver entre les lignes quand ça va défourailler. »
Marsault sourit sans y mettre beaucoup de conviction. Il savait aussi à quoi s’en tenir : Parrot n’était ni d’un côté, ni de l’autre.
« Et toi ?
– Non, plus de place. Et je suis de service.
– Tu vois, Valleigeas arrive à se décider de temps en temps. » Marsault fit un effort pour ne pas réagir.« Le commandant a dit qu’il voulait te voir. Il est dans son
bureau. »
Rémi passa derrière le comptoir.Il frappa à la porte et entra. Le commandant avait dû se préparer à son arrivée, car il chercha les yeux de Parrot à toute vitesse pour les fixer sans dévier d’un centimètre pendant toute la conversation.
Il l’invita à prendre un siège, mais le garde-chasse resta debout dans son uniforme kaki.
« Tout est prêt pour la battue ?
– Manque seulement la liste complète des tireurs.– Ah, oui. Les tireurs, toujours les tireurs. Vous pensez qu’ils sont choisis selon quels critères en priorité, monsieur Parrot ?
Leur amour pour la nature, leur amitié pour leurs voisins ou leur habileté au tir ? »
La moitié droite du visage de Rémi sourit.
« Un des trois n’est pas spécialement requis. »Le commandant Vanberten, dont le nom nordiste n’évoquait en rien son physique de négociant bordelais, éclata de rire comme on tousse dans un mouchoir.
« Je ne veux pas savoir lequel. »
S’il vivait ici cent ans, devenait alcoolique et gagnait dix fois le concours du plus gros mangeur de pâté de pommes de terre, jamais Vanberten ne pourrait se faire passer pour un local.Dites-moi, monsieur Parrot, je voulais parler avec vous d’un incident dont j’ai eu vent, au sujet du bal de la société TechBois, samedi dernier. Savez-vous de quoi je veux parler ?
– Vous allez me le dire.
– Philippe Mazenas, garde forestier et agent assermenté de l’Office national des forêts, aurait été sérieusement agressé lors de ces festivités. Nous parlons de la même chose ? Bien. Malgré les efforts qui sont faits dans cette brigade pour que je ne sois pas au courant de tout ce qui se passe le samedi soir, je suis au fait de cet incident. Je suis aussi en mesure de faire la différence entre une soûlerie et un règlement de comptes entre un technicien de l’ONF et des employés de la plus grosse entreprise de sylviculture de la région. Je connais votre position vis-à-vis des partis en cause, et c’est pour cela que j’aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que ce problème pourrait se reproduire ? Ou même s’aggraver ? Vous pouvez parler librement, je m’informe seulement et je ne pense pas encore que le brigadier Marsault colle son oreille à la porte de mon bureau. »Le sourire poli de Vanberten ne cherchait pas à cacher son intelligence, ce n’était qu’un encouragement pour ceux qui étaient plus lents.
Je ne sais pas, commandant. Je n’ai pas encore vu Philippe. Entre lui et les exploitants, ça a toujours été tendu. Il avait bu, j’imagine. Tout le monde devait avoir bu. C’est pas une circonstance atténuante, mais c’est toujours une explication. Je peux rien vous dire de plus, mais je dois passer le voir aujourd’hui. »
Vanberten réfléchit un instant, hésitant à mettre toute sa confiance dans sa réponse.
D’accord, vous n’en savez pas beaucoup plus que moi. Mais si jamais – et ne prenez pas cela comme une sorte de dénonciation ou de trahison – vous appreniez que cela est plus grave qu’une rixe de fin de bal, auriez-vous la gentillesse de m’en faire part, monsieur Parrot ?– Je le ferai, commandant. Si vos hommes ont besoin d’autres renseignements, pour la battue de la semaine prochaine, n’hésitez pas à m’appeler. »
Rémi salua et poussa la porte du bureau. Le commandant le rappela, souriant toujours :
Et vous, monsieur Parrot, êtes-vous bon tireur ? »Rémi se retourna à demi dans le couloir, n’offrant à Vanberten que son profil paralysé, son sourire caché de l’autre côté.
« Ça ne se dit pas, commandant. Mais ça doit se savoir. »
Rémi redescendit du mont en seconde, laissant le frein moteur ralentir sa course jusqu’au centre-ville. Il posa le téléphone portable sur son socle, mit en route le kit mains-libres et fouilla son répertoire. Philippe répondit à la troisième tonalité. Rémi s’excusa de ne pas être passé le voir plus tôt et demanda où il était. Philippe était en plein martelage dans la forêt domaniale de Fénières, à vingt kilomètres de là. Donc, il marchait. Rémi connaissait l’endroit et demanda s’ils pouvaient s’y retrouver dans une heure. Le garde forestier raccrocha et le garde-chasse poursuivit sa route jusqu’à la grand-rue, tourna sur le parking de l’hôtel de ville et s’arrêta sous le passage qui conduisait à l’ancien cinéma.
Jean avait bien bossé. La boutique, ancien salon de soins canins, avait été judicieusement reconvertie en magasin de vêtements et sous-vêtements. Michèle savait toujours ce qu’elle voulait et Jean ce qu’il faisait. La façade et la vitrine étaient réussies, colorées dans les limites de ce que supportait la ville. Le pas-de-porte était idéalement placé à l’endroit le plus passant de la ville, unique chance de faire suffisamment de commerce.
Rémi sourit, caché derrière le reflet du pare-brise, lisant le nom peint en délié rétro : « Les dessous de la ville. »
gauche et à droite de la porte d’entrée, deux vitrines ; l’une de vêtements annonçant l’arrivée de l’été, l’autre de lingeries.
Un cutter à la main, elle coupait les Scotchs d’un carton de livraison. Rémi la regarda déballer des T-shirts roses et blancs. Elle passait entre les mannequins sans tête et les penderies. Elle pliait, empilait, étiquetait les prix et les nouveautés.Pourquoi avait-il mis si longtemps à venir ? Cinq mois. Peut-être pour être sûr qu’elle n’était pas que de passage. Possible, mais pas suffisant pour cacher entièrement sa trouille. De la voir dans le magasin, installée, revenue, Rémi ressentit un soulagement plus grand que ce qu’il avait imaginé. Il ôta sa casquette, secoua ses cheveux, inspira une longue bouffée d’air et mit la main sur la poignée de la portière. Il s’arrêta net en voyant marcher vers la boutique un grand type en veste Barbour, mains dans les poches, patronal de la pointe des Paraboot au sourire de façade. Didier Messenet, héritier du grand maquignon et frère de Michèle, ajoutait à chaque année qui passait une arrogance un peu plus appuyée. Sur ses épaules, malgré ses fringues de chasseur anglais et ses grands airs, la courbure du paysan.
Rémi se rassit sur son siège, attendit qu’il entre dans la boutique et redémarra. Lorsqu’il passa devant le magasin, Didier Messenet s’était retourné et regardait la rue.
Il roula vite sur la nouvelle nationale qui filait au sud vers la chaîne des Puys ; une large chaussée tirée au cordeau, coupant le dessin de l’ancienne route aux virages reconvertis en aires de repos. De chaque côté, sur les collines de plus en plus raides, les hectares de Douglas d’une plantation Courbier qui avait valu
ce nouveau tronçon d’asphalte lisse son surnom de « route Courbier ».
Les travaux d’abattage avaient commencé l’année précédente et, le long de la chaussée, s’empilaient des montagnes de billes. Des tas de dix mètres de haut, longs de cinquante, que les camions de la TechBois venaient charger avant de se lancer sur la nationale qui desservait magnifiquement, quelques kilomètres plus loin, l’usine de sciage, de pâte à papier et de panneaux agglomérés. Libre à chacun de penser que la construction de cette autoroute forestière n’avait rien à voir avec Marquais, président du conseil régional, grand ami de la famille Courbier et actionnaire de la compagnie de TP qui avait réalisé les travaux. Les renvois d’ascenseur entre Courbier et Marquais étaient tels qu’on ne savait plus très bien qui rendait service à qui.L’usine s’agrandissait chaque année. Une nouvelle cheminée, un hangar, un nouveau banc de sciage numérique. Devant les quais de chargement, des semi-remorques aux plaques minéralogiques de toute l’Europe. L’usine employait un tiers des derniers salariés de R. Sans la TechBois, la ville aurait peut-être disparu. Elle avait maintenant un maire et un roi.
Il quitta la nationale après avoir dépassé l’usine et prit la route du Plateau qui montait en serpentant vers la commune de Fénières. Le maire du village faisait figure de résistant, dans le coin, puisqu’il refusait depuis plusieurs années de vendre les sections communales à la TechBois, continuant à mandater l’ONF pour leur entretien et leur exploitation. Cinq pour cent des bois de la région appartenaient encore aux communes. Des quatre-vingt-quinze autres, quatre-vingts appartenaient aux Courbier. La résistance de la mairie de Fénières se comprenait mieux quand on savait que le vieux Messenet avait la moitié du conseil municipal dans sa poche. Philippe s’en fichait et s’acharnait à faire de ce coin préservé un paradis forestier, la plus belle épine dans le pied de la TechBois.
Rémi gara le 4 x 4 de l’ONCFS sur le parking visiteur d’où partait le circuit de promenade, une boucle de deux kilomètres qui passait au sommet de la colline par le site des Pierres Jaumâtres. Il verrouilla le véhicule et se lança sur le parcours à bonnes foulées. Élagage, sélection, sens du paysage et martelage précis, Rémi apprécia tout le long de la montée le travail de Philippe. Il escalada en opposition la faille qui coupait en deux le plus gros des rochers et se percha dessus pour profiter du plus beau panorama de la région. Au sud et à l’est, les Puys encore enneigés. Devant lui, le Plateau, secteur du parc naturel régional qui s’arrêtait sur ce dernier point haut, les Jaumâtres, avant de se transformer en plaines longuement vallonnées au nord et à l’ouest. Les plaines agricoles, le Plateau forestier. Deux territoires.
On appelait le plus haut des rochers Le Dragon, à cause de son arête ronde comme un dos et creusée de petites marmites régulières, qui dessinaient une colonne vertébrale épineuse à ce bloc de granit de onze mètres de haut. Depuis le dos du Dragon, on lisait comme une histoire le cours de la rivière qui avait déplacé, usé et arrondi ces tonnes de pierres que la baisse du niveau des eaux et l’érosion avaient laissées suspendues en l’air, au sommet d’une colline de sept cents mètres d’altitude. Pas mal de prêcheurs, de druides, de vierges et de chèvres sacrifiées étaient passés par là depuis.
Rémi observa la ligne de front avant de redescendre. Les prairies Messenet qui montaient à l’assaut du Plateau ; les futaies et les coupes rases des Courbier qui prenaient la suite jusqu’au parc régional. Fénières sur la ligne. Plus loin, à l’est, la commune de Banize et le parc éolien des Messenet, que Rémi pouvait voir depuis chez lui également, tout en haut de la Terre Noire.
Les Pierres avaient quelque chose de rassurant. À les voir intactes après que des siècles d’intérêts eurent répandu tripes et boyaux à leur pied, les empires provinciaux des Courbier et Messenet donnaient presque envie de rire. Mais Philippe ne rigolait pas de ça. Il se battait pour la nature. Rémi voulait bien le croire, même s’il évitait de gratter trop loin la psychologie du militant. La nature, c’était une idée différente pour un fils de paysan comme lui. Les paysans savent à quelle vitesse leur trace s’efface. La terre est un outil de travail qui donne tant qu’on a la force de le faire. Il reconnaissait que les dégâts mécaniques risquaient de pourrir la vie, mais la nature, avait toujours pensé Rémi, n’avait pas besoin qu’on la défende. Elle nous boufferait tout cru si on lui tournait le dos quelque temps. C’était comme ce documentaire qu’il avait vu, une sorte de perspective scientifique, un scénario dans lequel les hommes disparaissaient du jour au lendemain. En vingt ans, trente, toutes les prairies du coin seraient envahies par la forêt. Les loups qui revenaient par le Massif central pulluleraient en aussi peu de temps. La moitié des animaux échappés des zoos s’adapteraient au climat d’ici et, dans un siècle, des girafes boufferaient les arbres dans les anciennes plaines céréalières des Messenet. Des ours, des loups et des tigres se battraient pour avoir le privilège de s’installer sur les Pierres Jaumâtres, dans des forêts oubliées des Courbier. Les prédateurs seraient au paradis parmi des troupeaux de cerfs et de chevreuils. Les normandes, les charolaises et les limousines s’éteindraient d’elles-mêmes, trop gourmandes, trop sédentaires, à moins qu’elles ne trouvent en hiver des chemins de migration vers le sud. Peut-être que des races plus robustes, venues des Tatras polonaises, traverseraient la Beauce à la fin de l’automne, après que quelques générations d’entre elles seraient mortes à la recherche du passage, au sud et à travers les Pyrénées, menant aux pâturages toujours verts de l’Espagne. Évitant les Alpes, elles passeraient à l’est des Puys, où les attendraient les ours, les loups et des hordes de chiens. Car d’après ces scientifiques, les véritables futurs rois des animaux seraient les rejetons de nos chiens de compagnie. Ni les gros, ni les petits, ni les chiens de race, mais les moyens, les bâtards de vingt ou vingt-cinq kilos. Les chiens régneraient sur l’Europe. Des chiens jaunes en bandes. Dans ce scénario, ils prenaient aussi Tchernobyl en exemple. Des terres interdites aux hommes pour dix mille ans, mais où la nature, après quelques générations tarées, avait repris racine avec vigueur. Faune et flore. Tout ça se voyait bien d’ici, en haut des Pierres, pour un fils de paysan.
Rémi redescendit du Dragon et continua sa marche. Il laissa le chemin balisé pour s’enfoncer dans la forêt et fit un petit détour pour inspecter un coin à girolles qui ne donnait pas encore. Malgré le soleil des derniers jours, il faudrait attendre les saints de glace et la fin des nuits encore froides pour débuter la cueillette.
Il retrouva la piste forestière de Fénières, dépassa la petite Peugeot verte de l’ONF de Philippe, suivit une ligne de chênes de soixante frappés au marteau de l’Office et siffla quand il pensa être à portée de voix. Il attendit silencieusement une réponse. Il se déplaça d’une centaine de pas à droite, signala une nouvelle fois sa présence, avança d’autant et recommença. Puis il lui sembla entendre une voix, lointaine, mais forte. Il se dirigea au son et vit, au bout d’une travée, le téléphone à l’oreille, Philippe en uniforme de travail en train de gueuler dans l’appareil. Quand il entendit Rémi approcher, il se retourna en sursautant et raccrocha, les yeux écarquillés et furieux. Il portait en bandoulière une Remington 750 Woodmaster.
Le visage de Philippe était couvert de marques et d’écorchures. Son œil droit, sous une arcade enflée, était cerclé de noir jusqu’à la pommette. Une coupure traversait ses deux lèvres gonflées. Un bandage protégeait sa main gauche et il boitait. Jean n’avait pas exagéré, Philippe avait reçu des coups sévères. Dans ses cheveux blonds presque rasés, les croûtes d’une plaie pas encore cicatrisée. La barbe de trois jours poussait sur les blessures. Pas de rasoir avant quelque temps sur ce menton abîmé.
Rien qui ne disparaîtrait, mais Rémi fut impressionné par l’état du garde forestier et ce visage boursouflé de haine.
« Salut.
– Qu’est-ce que tu veux ?
– Rien. Voir comment ça allait.
– Ben tu vois, en pleine forme. » Rémi regarda la carabine.
« Tu fais quoi avec ça ? »
Il sourit et s’approcha en tendant la main. Malgré le bandage, la poigne était ferme.« Tu attends de la visite ?
– J’aime bien être au calme quand je travaille, c’est pour éloigner les touristes.
– Jean m’a dit ce qui s’était passé.
– Ouais, j’aurais préféré qu’il arrive un peu plus tôt, mais c’était déjà bien qu’il soit là.
– Qu’est-ce que t’as foutu ? »
Philippe lui tourna le dos et marcha en claudiquant jusqu’à un chêne. De deux coups de hachette, il écorça l’arbre, une fois à un mètre cinquante, une autre près du sol, puis frappa au marteau de forestier. Les deux lettres AF faisaient comme une cicatrice sur la pulpe régurgitant de l’eau.« J’avais picolé.
– Personne n’en doute. »
Philippe leva la tête, regarda les branchages des arbres alentour, évalua la distance qui les séparait, et choisit le prochain chêne à abattre. Deux coups précis du tranchant du marteau administratif. Deux autres pour marquer.Vanberten m’a posé des questions.
– Tu fréquentes trop les flics.
– C’est pas ça qui me rend bavard.
– Y’a quelque chose à comprendre ?
– À toi de voir. C’est pas moi qui me balade avec une arme.Y’a quoi dans le magasin ? »
Philippe avançait d’arbre en arbre, faisant sauter l’écorce et résonner son marteau.
Ça va pas te plaire. Norma 7/64.– Tu chasses le gros ?
– Du genre chemise à carreaux. T’es venu me faire la morale ?– Tu préfères un PV et une amende ? »
Philippe fit glisser la Remington de son épaule, s’assit sur unarbre mort et appuya l’arme près de lui. Plier les genoux et le dos lui arracha une grimace.
« Je préférerais que tu me foutes la paix.
– Encore une fois, c’est pas moi qui suis en guerre. Et je crois que tu vois plus les choses comme elles sont. T’as agressé Courbier sur son territoire et t’as pris une raclée. C’est pas une première. Te balader avec du 7/64, ça ressemble à de l’escalade.
– Comment ça va avec la fille Messenet ? Son frangin t’a donné l’autorisation de lui dire bonjour ? »
Rémi s’assit à côté du forestier, enfonça sa casquette pour protéger les cicatrices d’un rayon de soleil.« Tu m’expliques le rapport ? »
Rémi décrocha sa gourde de sa ceinture et proposa à boirePhilippe.
Tôt ou tard, tu te retrouveras dans la même situation que moi. Les Messenet et les Courbier ont déjà foutu ta vie en l’air.– Je suis pas sûr d’apprécier le tournant que prend cette discussion. »
Philippe regarda Rémi Parrot, la moitié droite de son visage noyée dans une coulée de cicatrices et de greffes. Il but une gorgée d’eau et rendit la gourde au garde-chasse.– Au temps pour moi. »
Rémi se leva en tendant la main vers l’agent de l’ONF. Philippe éjecta le magasin de la semi-automatique, en sortit les trois balles et les déposa dans la paume du garde-chasse.La prochaine fois, prends ton arme de service.
– On en a qu’une au bureau. Christian est parti avec la brigade de Gentioux, sur le coup des débardeurs.
– Ouais, j’en ai entendu parler. Deux machines ?
– Même chose. Acide de batterie dans les réservoirs.
– Tes potes du Plateau vont bien finir par se faire serrer. Tu passes toujours autant de temps avec eux ?
– Ça te pose un problème ? »
Rémi empocha les balles.
Faudra qu’on surveille les voitures des bûcherons. Dans pas longtemps, tout le monde va être armé par ici. »
Philippe se leva, la carabine à la main.
Ouais, possible que ça pète vraiment, un de ces quatre.– Ouais. »
Rémi tourna le dos à Philippe et s’éloigna. Il s’arrêta aprèsune dizaine de pas.
Jean organise une petite fête pour la maison, samedi prochain.
– C’est lui qui organise ta crémaillère ?
– Ouais.
– Il m’a déjà appelé. Je passerai. Hé, Rémi ?
– Quoi ?
– Merci quand même d’être venu. »
Rémi Parrot porta deux doigts à la visière de sa casquette et s’enfonça dans le bois.