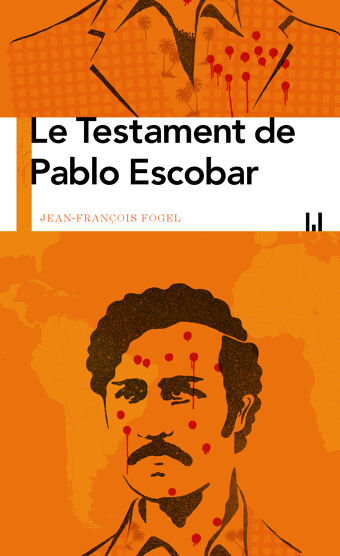
Jean-François Fogel
Le Testament de Pablo Escobar
Pablo Escobar représente la figure incarnée du mal. Le patron du cartel de Medellín a fait fortune en contrôlant la production de cocaïne dans le monde, usant de toutes les violences. Lorsqu’il fut abattu, en décembre 1993, on lui imputait plusieurs milliers de morts.
Ce qu’il possède de monstrueux témoigne d’un désarroi de l’univers hispano-américain. Dans le destin d’un criminel hors pair apparaissent le poids du passé, l’ombre des États-Unis, les difficultés des plus pauvres, l’inertie de la violence, le romanesque des caudillos, l’État fiction. Escobar est un homme qui raconte, comme Bolivar, comme les héros de Gabriel Garcia Marquez, un continent éloigné du monde.
- téléchargez l’extrait
Cette fois, il n’a eu que le temps de mourir. Son unique garde du corps abattu d’entrée au rez-de-chaussée, une cachette hors d’atteinte au premier étage, son seul recours restait une fuite impossible par une fenêtre du deuxième étage. « Pablo ! Pablo ! Va-t’en ! », a crié une femme avant qu’il saute, pieds nus, sur le toit où une rafale de mitraillette l’a cueilli. Pablo Escobar, assassin, trafiquant de drogue, est décédé le 2 décembre 1993, à 15 h 06, dans le quartier La America, à Medellín, de 7 balles tirées par les membres d’un commando de 17 hommes venus l’arrêter plutôt mort que vif.
« Pour les Européens, affirme un personnage du romancier Gabriel Garcia Marquez, l’Amérique latine, c’est un homme avec une moustache, une guitare et un revolver. » Jusqu’au bout, Escobar a servi ce portrait-robot du bandit inspiré et violent ; l’ajout d’une barbe, l’absence de la guitare – il n’avait qu’un revolver 9 mm en main –, à l’instant de son dernier soupir, sont dus aux difficultés endurées par un prisonnier évadé depuis quatre cent quatre-vingt-dix-huit jours et contraint de se protéger avec un déguisement et des armes. Quant au reste, les photos de son cadavre ensanglanté montrent l’expression distante et sereine qui l’habita durant la décennie où il tint le rôle le plus en vue dans la plus cruelle des organisations criminelles, le « cartel de Medellín », producteur et distributeur de l’essentiel de la cocaïne dans le monde.
Telle une publicité, son visage revenait sans cesse sur les écrans de la télévision colombienne : des yeux noirs, petits, rapprochés, un regard minéral sur un nez droit et des lèvres minces. Un physique si commun – taille moyenne, chevelure sombre – qu’il était impossible de citer le moindre signe particulier aux Colombiens invités à le dénoncer. « On recherche Pablo Emilio Escobar Gaviria, demandé par la justice. À quiconque fournit un renseignement permettant sa capture, le gouvernement national offre comme récompense… » ; le temps aidant, ce montant atteint un milliard de pesos (7,8 millions de dollars), soit, nota un implacable observateur, cent cinquante et une années de traitement du Président du pays.
Pour valoir autant, il ne suffit pas de produire et d’acheminer de la cocaïne – même par centaines de tonnes. Et la pratique de l’assassinat ne suffit pas davantage à provoquer un tel intérêt – bien qu’en ce domaine il faille compter les victimes par milliers. Non, ce qui a fait le prix d’Escobar, au sens où se fait la cote d’une action, à la bourse du crime, c’est la brutalité qu’il finit par mettre dans tout ce qu’il entreprenait. Cet autocrate de la pire des mafias, ce capitaine d’industrie, chef d’armée, stratège géopolitique et desperado au service de sa seule cause, était avant tout un praticien de la violence. Un aventurier cynique dans l’action et capable d’une indifférence résolue à l’heure d’endurer des coups. Sa carrière et sa vie se sont fondues dans un déferlement de meurtres et d’actes de terrorisme hors de proportion avec toute destinée. Cela m’était apparu avec une sorte de férocité lumineuse, un matin de janvier 1988, en découvrant le désordre du quartier de Sainte-Marie-des-Anges, à El Poblado, où une voiture piégée – la première de l’histoire de Medellín – venait d’exploser devant un de ses domiciles.
C’était un immeuble sobre, blanc avec des balcons cernant chacun des huit étages : le Monaco. L’attentat en avait fait l’équivalent d’un séchoir à maïs ouvert à tous vents avec, pareille à un drapeau flottant au plus haut, la toile déchirée d’une escarpolette. Les huisseries de plus d’un demi-millier de villas à l’entour étaient descellées ; les tuiles romaines chahutaient sur tous les toits jusqu’à cinq cents mètres du cratère creusé par l’explosion. Des feuilles d’arbres hachées menu et des aiguilles de pin arrachées par le souffle formaient un tapis continu sur le sol des rues. Dans ce faubourg cossu de Medellín, ce désordre était, plus encore qu’un attentat, la proclamation d’un excès. Il y avait trop d’explosif utilisé contre une seule personne pour qu’elle-même ne soit pas trop puissante, trop riche, trop dangereuse.
La police estimait la charge à vingt kilos de dynamite, soit cinq fois moins que ce que contenait le camion piégé utilisé pour l’attentat contre le quotidien El Espectador à Bogotá. Là, c’était en septembre 1989, et depuis le hublot de l’avion qui, à ce moment précis, m’emmenait prendre des nouvelles d’Escobar, on voyait à travers la nuée de poussière que le grand bâtiment industriel, abritant rédaction, administration et imprimerie, n’était plus d’équerre. Les rouleaux de papier pour les rotatives restaient stockés à ciel ouvert. La façade était éventrée. Les abords, persillés de débris, ressemblaient à une plage de galets. Pénétrant dans le journal le lendemain, j’avais regardé, par habitude, la petite presse à main exposée à l’entrée, un bijou, aussi beau que les vieilles machines à coudre à pédale, et qui imprima le premier numéro du quotidien. Nappée d’une poussière blanche, fine comme le talc, elle faisait songer au premier débarquement de l’homme sur la lune, à cette poudre où Armstrong laissait des empreintes à chaque pas. La lutte que menait Escobar ne semblait plus toucher terre.
Moins de trois mois plus tard, j’étais confronté au spectacle de la guerre au siège du Département administratif de sécurité (DAS), qui regroupe l’élite de la police criminelle et certains services secrets colombiens. Il ne restait qu’une carcasse de l’énorme édifice de onze niveaux, soufflé par l’explosion d’une demi-tonne de dynamite gélatineuse. L’explosif avait été placé dans un autobus dont les restes gisaient sur le toit de sa cible, à près de trente mètres du sol. Tout autour, vingt-trois pâtés de maisons du quartier de Paloquemao ne valaient pas mieux. Arbres arrachés, automobiles chiffonnées, ruines méconnaissables avec, sortant de leurs murs comme de monstrueux moignons, des poutrelles métalliques tordues. Quelques minutes après l’attentat, en dépit du sang partout répandu, l’ampleur du bilan qui déjà se laissait deviner – une soixantaine de morts, sept cents blessés – impressionnait moins que l’ambition du metteur en scène anonyme qui s’efforçait de camper un paysage de cité bombardée dans une capitale amorçant sa journée de travail.
Là encore, l’attentat était excessif : trop énorme, trop achevé, trop minutieux pour être tout à fait vrai. On était passé de la voiture au camion, puis à l’autobus piégé. L’avion figurait dans cette escalade, mais, en un pays où tout n’est pas forcément ordonné, il avait devancé de deux jours l’autobus. J’ai toujours près de moi au moment où j’écris la une du quotidien péruvien El Comercio, dont la lecture m’avait fait revenir de Lima vers Bogotá : « 107 personnes meurent dans l’explosion d’un avion en Colombie ». Il n’y eut pas un seul survivant à bord du Boeing de la compagnie Avianca qui venait de décoller pour Cali, dans le sud-ouest du pays.
À cette époque, j’écrivais pour les journaux des articles qui traitaient parfois de la Colombie. Mais je n’avais eu ni flair ni talent pour me trouver trois fois sur quatre au bon endroit dans la tourmente entourant Escobar. En Colombie, être dans cette tourmente était la chose la plus naturelle qui soit. Tout le pays s’y trouvait plongé, et souvent rassemblé par une entraide nullement feinte qui maintenait l’équité entre une part de douleur et une autre d’humanité.
Toute évocation de la Colombie au temps de Pablo Escobar est injuste. Elle fait la part trop belle aux attentats aveugles, aux meurtres à façon. C’était une violence atroce bien sûr, mais tout le monde trouvait à s’en accommoder si bien qu’on remarquait plutôt à quel point les trépas, la violence, la guerre sont des heures chargées de fraternité – souvenons-nous de l’enthousiasme joyeux de Fabrice rencontrant la cantinière à Waterloo. Il n’y a pas que Stendhal pour exposer ce mélange de la mort et d’une complicité délicieuse. Tolstoï, Babel, Hemingway, Herr, Soljénitsyne ont dit des choses définitives sur ce point. Leurs arguments valent pour la Colombie au point que le décès d’Escobar me souffle, plutôt que le ressouvenir de scènes d’une violence routinière, la nostalgie d’une journée de beauté agreste où un homme me fît entendre, pour la première fois, le surnom que ses subalternes donnaient à ce criminel hors pair : « El Patron ».
Ce jour-là, une petite jeep grise avec la statue d’un petit cheval gris à l’avant du capot m’avait emmené à travers un paysage rempli de fleurs aux couleurs exaltées. C’était un cheval calme, avec une patte à peine levée et un air de soumission. La jeep était usée jusqu’au châssis. On voyait la poussière jaune de la route à travers le plancher. Une image collée sur le tableau de bord affirmait que le voyage se plaçait sous la double protection des lubrifiants Dyna et de la Vierge du Carmen. Le chauffeur croyait davantage aux premiers qu’à la seconde car, aussitôt après m’avoir éveillé, sans attendre d’avaler sa première tasse de café, il avait placé un énorme bidon d’huile derrière son siège.
Plus tard, au cours d’une panne où il fut contraint de démonter le système d’injection, je vis qu’il n’utilisait que la moitié d’un carburateur double corps prélevé sur une voiture de sport. Une des admissions d’air était bouchée par un chiffon gras ficelé avec minutie. Le moteur tournait avec un bruit de maugrément qu’on imaginait adressé à ce bricolage. À dire vrai, on avançait à peine. Cela laissait du temps pour détailler des visages encore endormis sur les bas-côtés. Des hommes veillant à ne pas tourner la tête, tandis que leurs yeux sombres nous suivaient jusqu’au prochain virage. Des femmes chargées de seaux, de sacs et, pour l’une d’elles, d’un énorme dindon aux pattes entravées. Il y avait aussi des enfants qui, vus de loin, semblaient jouer à faire des pâtés ; en approchant, on voyait qu’ils travaillaient à empoter des plants de café.
La jeep a dû s’arrêter au sortir d’un virage. Une cordelette était fixée en travers de la route, reliée à une bouteille vide placée dans la main d’un épouvantail assis contre un talus. « Borracho » (ivrogne), crièrent deux gamins cachés dans le fossé et qui tiraient sur la cordelette en riant. Elle s’était prise dans le pare-chocs. L’un d’eux alla la détacher. Cela ne nous ralentissait guère, et il y avait au fond peu de chances que nos noms figurant sur l’un des monuments (en général, une image de la Vierge cernée de phares d’automobiles) que les Colombiens érigent à l’endroit où des voyageurs sont décédés dans un accident de la circulation.
Mon conducteur était un petit homme maigre, calme, avec des joues creuses, des yeux charbonneux et un trait de moustache. La veille, il n’avait pas lâché trois phrases avant de s’assoupir sur un des bat-flanc couverts d’un matelas de mousse sentant le moisi, que la tenancière de cet « hotelito » s’acharnait à appeler un lit. Quand la route est devenue un chemin, et même un chemin épouvantable où la jeep gîtait comme un rafiot, il n’a pas été plus loquace. Il a manipulé son volant avec précision pour sauter d’une ornière à l’autre, éviter les trous trop grands, choisir les pierres les plus rondes afin d’y engager ses pneus, et retarder l’avarie qui paraissait inéluctable. Le paysage de petites fermes aux toits de tôle ondulée se laissait envahir par une végétation tropicale de plus en plus fournie. La route montait sans cesse parmi des maisons devenues rares où des fleurs roses, jaunes, orange, mauves explosaient en massifs. Les plus belles, écarlates, étaient celles du platanillo, le faux bananier qui ressemble au vrai comme un frère, mais ne donne pas de fruits comestibles.
On s’est arrêté, encore, pour déboucher le seul gicleur en service du carburateur et prendre le casse-croûte de la matinée dans une auberge, une longue bâtisse aux murs de boue séchée, enlaidie de publicités rouillées pour des sodas. Agrippé à un perchoir de métal, un grand perroquet jaune et bleu se dévorait la peau des doigts avec méthode. Il s’interrompit pour hocher la tête en signe d’assentiment au moment où nous le frôlions dans l’étroite véranda menant à la grand-salle. Une femme ordonna à son fils de nous céder la table centrale. Dès qu’on fut assis, elle amena en silence un cœur de vache, placé sur une assiette blanche. Elle se disait fière de sa cuisson. Mon faible enthousiasme la poussa à proposer plutôt un reste de manioc. Les petites crêpes de maïs, immanquables à cette heure, brûlaient les doigts, avant de laisser sur le palais un goût de bonheur domestique mêlé de cendre. Sucré comme un sirop, le café avait quelque chose de doré, semblable à la douce lumière saturant l’ouverture de la porte. Le chauffeur allait et venait de la jeep à la table du petit-déjeuner. Il a fini par se lever pour de bon, cracher et faire pénétrer sa salive dans le sol de terre battue avec la semelle de son pied gauche. On est reparti pour très peu de temps. Deux mules attendaient, à guère plus d’un kilomètre de là. Je n’ai pas cru au prénom dont s’affublait celui qui désormais me conduisait.
J’ai préféré marcher. Et même aller en tête, en tenant derrière moi la bride passée par-dessus l’encolure de ma monture. Une sente, clairement marquée par une pelade continue dans l’herbe, grimpait par à-coups entre de grands arbres couvrant des caféiers de leur ombre. « Café caturra », a précisé mon nouveau guide. Lui voulait parler, mais il nous était impossible d’avancer côte à côte. Les racines des arbres fragmentaient la pente en de minuscules espaliers emplis de terre où les mules posaient leur sabot avec la prudence d’un chat tâtant l’herbe humide. On avançait sur une voie de moins en moins dessinée. Quelques pierres et une traînée de sable laissée par la pluie, un brusque effondrement du sol ou une énorme branche tombée depuis peu, déjà en pleine putréfaction et garnie d’une végétation parasite, indiquaient qu’on atteignait la frontière d’un empire végétal reculant devant l’homme avec réticence. Lumière tamisée et reflétée par le feuillage vernissé, cimes invisibles des arbres, chants d’oiseaux entrevus : c’était l’incommunicable exaltation de toute avancée à pied dans une sierra d’Amérique latine. « Les nouveaux mondes doivent être vécus plutôt qu’expliqués », écrit le romancier cubain Alejo Carpentier.
Rendu hors d’haleine par la pente, occupé à trouver le meilleur endroit, je cherchais à prendre appui de la main sur ce qui devenait un escarpement lorsque j’ai vu, à un mètre de moi, la jante chromée d’une voiture tout-terrain Nissan. Impossible de déterminer, dans l’ombre du feuillage, si sa peinture était d’un vermillon rare ou d’un rouge dégradé en orangé par le soleil. Germán, le capo que je venais rencontrer, se tenait debout, appuyé sur une aile. C’était un homme un peu rond, au sourire ample et figé, avec une barbe à l’implantation irrégulière. Il avait une curieuse façon de rouler de l’épaule droite, comme s’il replaçait sans cesse une besace pesante et invisible. Sa petite main fut la seule chose glacée que je touchai dans cette journée d’air andin et de soleil.
Bien sûr, il ne se nomme pas Germán et il n’a jamais accepté de me donner ouvertement rendez-vous, mais compte tenu d’un service que j’avais rendu à un membre de sa famille, il savait que j’étais averti de son activité. S’il avait mis en scène cette rencontre impromptue avec un étranger désireux de voir des « cafeteros » installés à l’écart, c’était parce que les autres capos, ses confrères, ne pourraient comprendre un manquement délibéré à la règle du silence. Et puisque, miracle, il vit encore, des années après avoir ainsi feint de se trouver par hasard sur mon chemin, le plus simple reste de l’appeler Germán.
Trois hommes l’accompagnaient. Ils se tenaient avec une sorte de pudeur, les bras collés au corps, qui interdisait de voir au premier coup d’œil les revolvers plaqués contre leur cuisse. Je vis aussi des fusils et même, sembla-t-il, une mitraillette dans la voiture. L’un des trois hommes avait le blanc d’un œil entièrement marbré de rouge par un coup. « J’ai pris un courant d’air », m’expliqua-t-il. Le trio imposait une présence un peu lourde, toujours à mi-distance, jamais détendu, avec des regards dépourvus, je ne dis pas de tendresse, ce serait trop attendre des représentants d’une espèce dont le système nerveux central est en permanence branché sur une gâchette, mais il n’existait pas même avec ces trois hommes la connivence qu’aurait dû provoquer une promenade dans un sous-bois où les gouttes de rosée non évaporées sur les feuilles avaient l’éclat de vif-argent d’une larme tombée sur un tapis de feutre vert.
Germán n’en a pas trop fait dans le rôle du propriétaire visitant ses fincas de café. Son chapeau, son langage, sa façon de rouler une feuille pliée entre ses doigts pour en mesurer la sécheresse révélaient des manières de paysan. Il était intelligent, réaliste, attaché à ne pas trop en dire. Il avait démarré à la fin des années soixante-dix, tout au nord du pays, dans la Sierra Nevada de Santa Marta, un massif montagneux dominant la mer des Caraïbes, où pousse la meilleure marijuana du monde. La Golden Santa Marta se cultivait alors exclusivement sur brûlis, dans des champs arrachés à la forêt tropicale. Commencée à la hache et à la tronçonneuse, une saison se terminait en arrimant deux sacs d’herbe sur chaque mule descendant vers les plages où des bateaux attendaient au mouillage. La route du littoral n’était qu’une mauvaise piste, peu fréquentée la nuit. L’endroit était sûr, d’autant que policiers et agents du service de répression du trafic de drogue assuraient la protection des trafiquants. « Je m’occupais des cultures. On les surveillait par nous-mêmes », dit Germán avant de s’abîmer dans une typologie sur la façon de charger les mules. « Les gens de la côte installent une petite selle faite de morceaux de bois entrecroisés avec de la paille par-dessous ; nous, dans les sierras de l’intérieur du pays, on pose une sorte de gros sac mou couvert d’une toile imperméable et on pose la charge en équilibre de part et d’autre, liée avec une seule corde. »
Je savais qu’il avait tué un policier la seule fois où il avait pris la responsabilité d’un transfert de marijuana. L’homme protégeait le départ d’un bateau et refusait de participer, comme le prévoyait l’accord passé dans un bar de Barranquilla, au chargement des sacs à bord. Un esclandre bruyant, devant les meneurs de mules et l’équipage du bateau, faisait craindre un règlement de comptes ultérieur. Germán, en position de force avec ses complices, avait abattu son opposant et quitté la région le lendemain. Contraint de partir, auparavant, de la moyenne vallée du Magdalena, dans le centre de la Colombie, après avoir, en état d’ébriété, tué un homme au couteau dans la beuverie brutale d’une cantina, il y était donc revenu après cet autre meurtre. Il était plus dur, plus résolu. Lui, qui ne connaissait autrefois que le département d’Antioquia, « travaillait » désormais aussi dans ceux de Santander et de Boyacá. Peu de temps avant notre rencontre, il était sorti blessé mais vivant d’une embuscade tendue par des guérilleros auxquels l’opposait un différend sur le montant à verser pour la protection d’un laboratoire clandestin de cocaïne.
Son monde s’était élargi en passant de la marijuana à la cocaïne. L’expérience acquise, lorsqu’il débroussaillait la forêt et gérait les cultures, faisait de lui un homme idéal au service de la logistique des laboratoires. Comment acheminer en pleine forêt les fûts des produits nécessaires : éther, acide chlorhydrique, kérosène, acétone ?
Comment alimenter en électricité la batterie de lampes à infrarouge destinée au séchage de la poudre ? Comment approvisionner le réfectoire des employés ? Comment s’établir le plus loin possible de l’indispensable cours d’eau le long duquel avions ou hélicoptères des services de lutte contre la drogue mènent leur mission de repérage des laboratoires ? Germán donnait posément les réponses à ces questions, sans dissimuler un certain orgueil professionnel. Il parlait des arbres qu’il laissait intacts pour masquer les installations, ce qui allait de soi, et du meilleur moyen pour acquérir la bienveillance des voisins, ce qui m’étonna bien plus ; je croyais les laboratoires à l’écart de tout.
« Même à l’écart de tout, on a des voisins, dit Germán. Il faut qu’ils ne voient rien chez toi, mais qu’ils te disent ce que tu ne vois pas. »
On marchait sur une sente élargie par le passage des mules. Un véhicule tout-terrain aurait pu y forcer sa route avec le risque de briser un essieu. Germán s’interrompait pour saluer les familles travaillant sur ses terres qui sortaient à son passage. Il les avait installées lui-même, pourvoyant à leur établissement ou rachetant un lopin déjà défriché. Quelquefois, le père était là, il s’avançait avec les enfants les plus âgés. La mère restait en arrière avec la marmaille. Des sourires, quelques mots. La musique criarde d’un transistor se faisait entendre. D’ailleurs, il y avait toujours sur le sol des piles électriques usagées et, toujours aussi, des douilles de balles. Chaque famille vivait dans des maisons faites avec rien, avec du bois, du torchis, le fer-blanc de bidons ouverts et martelés. Chaque demeure était flanquée d’une aire de ciment destinée au séchage des grains au soleil après leur passage dans le « moulin à café » qui est en fait une bicoque abritant une dépulpeuse sur laquelle coule un filet d’eau. Le café dans cette sierra est lavé, séché, trié à la main. Toute la famille se met à l’ouvrage.
« Le meilleur café, précisait Germán, est celui qui montre un grain entier, de la blancheur de l’ivoire. Ici, on dit : le blanc de l’os. » Je lui ai fait remarquer que c’est exactement l’inverse de la cocaïne : le café finit sombre alors qu’il est blanc au départ, la cocaïne est une poudre blanche mais la pâte qui sert à sa fabrication est plutôt sombre.
Cette remarque sembla le dérouter profondément. « Il s’agit de poisons différents », jugea-t-il après un long silence. Il dressa ensuite une manière de parallèle entre les hommes (qui ont besoin d’un toit sur la tête) et les jeunes plants de café (que l’on protège du soleil avec des feuilles de palmiers). Parlait-il ainsi de la puissance de la nature si extraordinaire autour de nous ? Je n’ai pas eu le temps de le lui demander car l’entretien se terminait : la même Nissan était sur notre chemin, ce qui ne laissait pas de m’étonner. Les trois gardes du corps ne nous avaient pas quittés. Qui s’était chargé de déplacer la voiture pour qu’elle se trouve sur notre parcours?
Plus professionnel, plus orgueilleux encore, Germán corrigea : ses gardes du corps étaient si nombreux qu’il avait fallu plusieurs voitures pour les amener. Il m’en montra certains, à peine visibles et pourtant proches. Il ne se déplaçait pas sans une protection formant plusieurs cercles autour de lui. Et quel risque lui faisait courir cet entretien ? Aucun, puisqu’il avait eu tout le temps de s’éloigner s’il l’avait voulu : il m’avait suivi à chaque instant tandis que je venais vers lui. Il s’amusa à me dire où j’avais pris mon petit-déjeuner. Il en avait été informé, dit-il - je pensais au garçonnet chassé par sa mère au moment de notre arrivée dans l’auberge. Depuis hier, il savait que j’étais en route - là, je pensai au conducteur du taxi qui m’avait mené vers le chauffeur de la jeep au petit cheval. Germán était aussi averti de ma nuit à l’hôtel, du vieux véhicule, de l’itinéraire emprunté. Les regards appuyés des gens rencontrés me semblaient alors expliqués, tout comme ce barrage de militaires où un sergent insistait afin que je lui lise mon nom sur mon passeport.
Parce que Germán parlait plus qu’il ne l’avait voulu, parce que la nature ne faisait pas la part dans ce coin de montagne entre une forêt intacte et des petits champs de caféiers établis comme des chapelles sous la voûte des grands arbres, parce que nous savions tous deux que ce serait notre ultime rencontre – ce qui ne fut pas le cas – et que la discrétion s’imposerait – ce qui se vérifia, jusqu’ici –, je posai la question interdisant une réponse sincère : qui régente une organisation aussi ample ?
« Moi », dit-il.
Je n’en doutais pas, il était responsable de sa propre sécurité, mais lui-même, qui avait commencé en gérant un laboratoire, avant d’en aménager de nombreux autres, avait un commanditaire dépendant à son tour de quelqu’un plus haut placé et ainsi de suite. Qui se trouvait au sommet ? Germán était assis sur le marchepied de sa voiture, lorsqu’il répondit en baissant la voix avec une expression tout à fait neuve et dont je ne saurais décrire la prudence, disons une sorte de déférence chargée de crainte, une admiration distante et malgré tout avertie :
« Il y a, dit Germán, " El Patron". »
Je connaissais Escobar, les journaux ne parlaient que de lui, mais j’ignorais ce surnom, et plus encore le respect avec lequel il était prononcé et qui montrait qu’ El Patron couronnait un ordre naturel du monde où la patrouille de militaires, le gamin délateur, les cultures de caféiers poussant dans l’ombre, les laboratoires, les gardes du corps et jusqu’à l’enthousiaste paysage parcouru ce jour-là occupaient leur place.
La mort d’Escobar elle-même participe de cette maîtrise : El Patron n’avait cessé de répéter : « Je préfère une tombe en Colombie à une prison aux États-Unis. » Mais prévoyait-il d’être comblé avec une telle célérité ? Vingt-trois heures ont suffi pour qu’il soit tué, enterré par les médias du monde entier et enfin inhumé pour de bon avec des adieux bâclés., Mettons de côté les milliers de petites gens et quelques moyens truands venus dans la brume du petit jour se regrouper autour du cimetière Montesacro, à Itagûi, tout près de Medellín. Pour eux, Escobar était « Pablito », auteur de largesses ou lointain dirigeant du trafic de la cocaïne. Ils lui ont offert un ultime salut qu’il n’assura jamais à ceux qu’il a assassinés de sa main, ordonné de tuer, ou dont il a simplement provoqué la mort par le climat de violence où se déroulaient ses activités. D’une certaine façon, il s’agit là de la famille élargie, rassemblée autour des sœurs et de la mère du défunt. Mais au-delà de ce premier cercle, la sortie reste escamotée. À croire qu’il fallait en finir au plus vite, de crainte d’apercevoir dans un moment d’émotion ce qu’étaient cet homme, son pays, et aussi son continent.
L’Amérique latine ne produit pas tant de héros que cela. Ôtons le pilote Ayrton Senna que sa fin tragique a propulsé dans le mythe. Il ne reste, dans les dernières décennies, que deux figures de notoriété, connues du monde entier. Il y a Diego Armando Maradona, footballeur argentin sorti d’un quartier de misère de Bue nos Aires avec un pied gauche aussi habile qu’une main. Et il y a Escobar, Colombien né sur un contrefort de la chaîne occidentale des Andes, et qui a donné au crime le visage de la démesure.
(Une parenthèse afin de noter que Maradona a été suspendu par les autorités du football pour usage de cocaïne et qu’un soupçon pèse sur son séjour au club de Naples qui aurait été réglé par la Camorra. Les deux héros issus récemment du monde hispano-américain ont donc été associés à la cocaïne et au concept de mafia. Mais qui attend autre chose de ce continent que des libertadores, des caudillos, des bandits et des chanteurs grattant leur guitare ?)
El Patron n’obtiendra jamais un juste traitement de l’Histoire. Sa légende à tête de Janus chemine déjà. D’un côté, il y a « Pablito » dont la photo voisine celle de la Vierge dans certaines maisons de Medellín ; de l’autre, les comptes sont faits pour l’essentiel : on lui reproche la mort de plus de six cents policiers, un ministre de la Justice en exercice et deux ex-ministres, un procureur général, trois candidats à la présidence, des dizaines de journalistes, plus de deux cents juges, des centaines d’associés ou de rivaux, des centaines d’innocents…
Impossible, si l’on s’en tient à ces deux visages, de mesurer à quel point l’aventure d’Escobar témoigne avec éloquence d’un continent. Elle agit pourtant comme un révélateur parce qu’elle se trouve au point de concours de deux univers qui s’ignorent d’ordinaire : la représentation populaire et le discours officiel. Durant quelques années, Escobar a même occupé une situation sans équivalent : devenu un mythe pour ceux qui le dénoncent ou le célèbrent, il est en même temps une cible désignée par les institutions. Providence du romanesque, il déploie une violence sans précédent, avec du Mandrin pour la cruauté, du Robin des Bois pour ce qui a trait à l’ironie, du Bakounine dans la rage destructrice, de l’Ai Capone par l’ampleur de la criminalité. Mais tout cela en plus riche, en plus sanglant, en plus grand surtout. Même la saga du crime au temps de la prohibition aux États-Unis ne peut être comparée. Il s’agissait, au mieux, d’une partie de gendarmes et de voleurs. Avec Escobar, c’est l’Amérique latine et sa peine à vivre qui est mise à nu. Tout se trouve dans son aventure : le poids de la violence et celui de la corruption, la faiblesse de l’État et la puissance du dollar, l’immensité de la nature, l’inépuisable rémanence du passé, le fatalisme guetté par le tragique, la conviction que le monde appartient toujours à autrui, que l’Histoire est faite au bénéfice des autres, que ceux qui gagneront sont ceux qui ont déjà gagné.
C’est entendu, Escobar appartient à la pire race de meurtriers. Ses crimes ne sont pas ceux d’un psychopathe, que sa maladie excuse, ou d’un monstre, comme tel impossible à juger. « C’est seulement quand l’assassin est un homme vertueux, remarquait Graham Greene, qu’il peut être considéré comme un monstre. » Escobar ignora toujours la vertu. Tuant sur un simple soupçon ses gardes du corps les plus proches, il en vint, vers la fin de sa fuite, à l’assassinat préalable au soupçon, ainsi celui des maçons bâtissant des caches dans ses refuges. Ses postures, ses propos n’ont jamais eu la flamberge, le cœur des hors-la-loi généreux. Lui-même, par ses qualités essentielles, son intelligence froide, son esprit de méthode, sa maîtrise de la communication, ne cherchait pas la sympathie mais plutôt l’obéissance à son endroit. Son élimination et son inhumation fulgurantes n’en relèvent pas moins de la prestidigitation politique, d’un tour de passe-passe médiatique. C’est une sortie qui tombe à point, celle d’un Billy the Kid, d’un Dillinger. La fin d’un ennemi universel, prophète du désordre et qui n’a que des ennemis : ex-associés, rivaux en affaires, policiers, soldats, juges, journalistes, et fonctionnaires ou gouvernants américains – à commencer par le président des États-Unis qui a salué dans sa mort un « travail courageux et efficace ».
Tous souhaitaient trancher sa trop longue trajectoire faisant d’un petit criminel le patron d’une mafia, puis un tueur en perdition, et d’un élu parlementaire l’auteur d’une déclaration de « guerre totale » aux dirigeants de l’État, devenu ensuite un détenu rebelle. Un tel parcours criminalo-politique jette pourtant une lumière crue sur une terre et sur une époque. L’homme a régné. Ce seul verbe suppose la distribution d’avantages, la coexistence avec d’autres pouvoirs, des réseaux et des complicités, la capacité à imposer un ordre, à incarner une aspiration partagée. Escobar, c’est autant la jonchée des morts qui garantissait sa propre fin que ce Germán enrichi par la cocaïne et qui, considérant ses terres, ses caféiers, sa garde rapprochée, respirait sur un autre rythme pour prononcer le surnom d’El Patron.
Même escamoté en vingt-trois heures, Escobar laisse un testament derrière lui. Non pas celui que, peut-être, il écrivit et qui, s’il devait être ouvert, fera trembler plus d’une autorité au-delà de la Colombie, mais celui qu’on peut lire dans son destin de héros satanisé, condamné à mourir en étant montré du doigt, pour que les hommes évitent de chercher dans sa mort les raisons de leur propre solitude.
