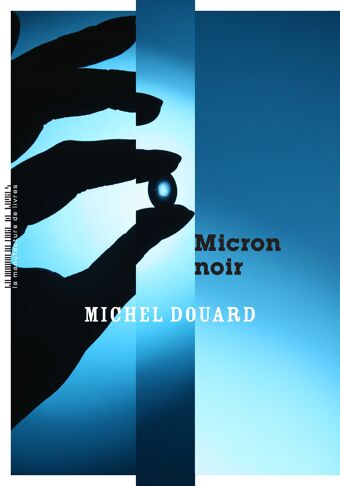
Michel Douard
Micron noir
2048. Les guerres ont été remplacées par des combats à l’allure de jeux du cirque dans des arènes encerclées de caméras. Hypermédiatisées, ces luttes entre nations ont donné naissance à une caste de soldats-stars, nouveaux héros richissimes qui mettent leur vie en jeu à chaque combat. Afin de dépasser leur peur et de décupler leurs forces, ces hommes consomment une drogue de synthèse surpuissante : le micron noir. Mais les coulisses de cette Guerre Nouvelle ne sont pas à l’abri des trafics. Et quand le plus célèbre des soldats et son meilleur ami se trouvent impliqués dans un vol de microns, leur popularité ne les préserve pas des gangs de mafieux. C’est hors de l’arène qu’il leur faudra mener ce combat-là…
Sorte de western futuriste décapant, Micron noir combine l’inventivité des romans d’anticipation et le rythme effréné des meilleurs polars.
Ce livre a été réédité dans le cadre de l’opération “10 ans, 10 livres” de La Manufacture de livres.
- Immense coup de cœur. Derrière un roman hybride génial de SF se cache aussi un sacré polar qui cogne. Bravo.
- téléchargez l’extrait
Nous sommes sur le point d’émerger du long tunnel qui relie notre vestiaire au champ de bataille quand on nous ordonne de stopper.
Au loin, montent de puissantes clameurs. Le public s’impatiente dans les tribunes sécurisées. Ceux qui peuvent se payer le billet pour les combats « live » ne sont pas les premiers venus. Des actrices qui se protègent du soleil avec des ombrelles, de grands capitaines d’industrie en tenues décontractées, des artistes à lunettes noires. Face à un écran de plus de deux-cents mètres de large, les nantis venus du monde entier vont suivre la rencontre avec explosions en toile de fond. Le privilège de dire « j’y étais ». Le grand frisson sportif. D’autres patientent en grignotant des aliments riches en graisses saturées au fond de leurs canapés. La grande majorité est plantée devant les écrans de rue, dans un calme relatif.
On interrompt la diffusion de notre hymne.
Le speaker annonce que les Vénézuéliens ne sont pas prêts.
Une vague d’impatience passe sur le public huppé.
Gros Luc retire son casque et égrène un chapelet d’injures à l’attention de nos adversaires du jour, « ces putains de gominés, ces brèles de latinos » qui, d’après lui, manquent de la plus élémentaire correction. Je n’abonde pas dans son sens. Je considère cet ami de deux mètres seize et cent quarante-cinq kilos avec la même curiosité que lorsque nous étions enfants. J’ai toujours le sentiment qu’il n’a pas une nature différente de la mienne, mais qu’il appartient plutôt à une autre classe de vertébrés. Je lui demande pour la troisième fois aujourd’hui pourquoi il est parmi nous. N’est-il pas censé être en permission ? Pour la troisième fois, il hausse les épaules, avale un deuxième micron, daigne répondre.
— Tu seras bien content de me trouver tout à l’heure.
Gros Luc est sous mes ordres, mais surtout, Gros Luc est depuis deux mois le numéro Un. Une position qu’il est difficile de tenir bien longtemps dans notre discipline.
Derrière nous, un soldat crie, exaspéré :
— Putain ! Laissez-nous y aller, merde !
D’autres renchérissent, sifflent. Les chefs de section les rappellent à l’ordre. Moi, je laisse gueuler. Aujourd’hui, c’est notre troisième rencontre de l’année. Et le motif du conflit m’échappe. Je cherche. Je ne me souviens plus pourquoi je suis là. C’est sans doute l’émotion. Ou la dope. Putain, pourquoi on est là ? Concentre-toi. Le tunnel vibre d’une peur agressive et pue la sueur acide. Nous sommes contraints à un surplace glaçant. Trois cents paires de chaussures de combat piétinent le béton. À travers la cloison, dans le couloir parallèle, on perçoit le grondement de nos blindés, eux aussi au point mort. Je sais l’angoisse de leurs occupants engoncés dans l’acier. Je me tourne vers l’arrière de notre colonne. Les hommes sont de plus en plus agités, yeux rougis, pupilles dilatées. Nombreux sont ceux qui gobent un micron de plus ou qui se tracent une ligne de war dust sur la crosse de leur arme.
Un lieutenant hurle à s’en déchirer la gorge :
— Gardez la haine !
Et puis, c’est le bouquet, un nouveau contretemps va retarder notre sortie de près d’une demi-heure.
Des manifestants anti-Guerre Nouvelle ont paraît-il envahi le terrain. Gros Luc préconise qu’on y aille quand même, « qu’aux premières balles au ras des oreilles, ces pacifistes de merde vont rentrer chez eux avec le froc trempé ».
J’ai hâte d’y aller aussi. Qu’on en finisse pour aujourd’hui, ou pour toujours. Cette attente claustrophobe est tuante.
Et puis notre Général lâche enfin sa formule rituelle via les haut-parleurs plaqués aux parois du tunnel, « Il va y avoir du sport ! ». Une ovation sauvage lui répond.
***
Dehors, nous découvrons les Vénézuéliens déjà alignés face aux caméras, le menton à l’horizontal. Avec des aboiements hystériques, leurs chefs de section les exhortent à se dépasser et à jouer collectif. À ne pas se laisser impressionner par une bande de pédales surpayées. À nous massacrer sans crainte.
Et dès le premier coup de sirène, c’est ce qu’ils font.
Ce sont des blocs compacts qui défoncent nos lignes, et leurs blindés légers surgissent derrière nous sans que je comprenne comment, nous coupant toute retraite, lâchant dans l’air des nuées de balles traçantes grosses et bruissantes comme des sauterelles africaines.
En moins d’une heure, nous perdons une centaine d’hommes, tués ou hors de combat.
Lors d’une accalmie de coups de feu, des sifflets et huées nourris me parviennent des tribunes.
Et puis nous bougeons d’une position à l’autre, au gré des ordres radio, sans qu’on nous prenne pour cible. Je ne traîne plus alors que trois équipiers avec moi. Gros Luc, sourire dingue aux lèvres, Franck, un type cruel auquel je ne me fie pas, et Baptiste, un Guadeloupéen très agité qui peste et jure, parce que c’est son île natale qui est en jeu aujourd’hui, et qu’il y a une forte probabilité pour que sa langue officielle soit bientôt l’Espagnol.
Je me souviens pourquoi on se bat.
Nous manœuvrons sans essuyer un tir pendant encore une demi-heure.
Jusqu’à ce petit bois où nous sommes censés nous regrouper avec ce qu’il reste de quatre autres sections. Nous n’avons pas le temps de nous compter que nous sommes pris entre deux feux. Entre les rafales des Vénézuéliens et les tirs de notre propre artillerie qui pilonne le secteur au petit bonheur la chance.
Un sifflement grave, un éclair blanc, un craquement surpuissant, et un fracas enflammé se propage à hauteur d’homme sur cent mètres. Le souffle d’un dragon. En quelques secondes, les fougères sont réduites en une poussière brûlante, les troncs des chênes et des bouleaux sont transformés en allumettes géantes et tordues. Nous avons la chance de nous trouver au centre d’une petite clairière. À plat ventre, encore vivants, après une courte visite en enfer. L’air est saturé d’une odeur d’homme rôti. Je crie aux trois autres de me suivre et ma voix atteint des aigus dont je ne la soupçonnais pas capable. Mon petit groupe jaillit du bois incendié à travers un couloir de végétation miraculeusement épargné, et plonge dans un cratère d’obus boueux. Mon visage et mes bras sont lacérés. En lisière du petit bois, je peux voir une équipe de Global qui filme des fantassins embrasés.
À l’Est, la 2e division blindée vénézuélienne prend position pour passer à l’offensive finale sur notre QG.
Échec et mat.
On prend la branlée de la saison.
Je me dis qu’on est aussi bien au fond d’un trou. D’autant qu’à y regarder de plus près, je me rends compte que Franck a la main gauche arrachée. Il a perdu connaissance. Baptiste, l’Antillais, lui a fait un garrot. Il lui administre un shoot d’adrénaline dans le thorax, lui colle des claques. Franck rouvre un œil, et replonge.
— Et nos avions, ils sont où ? s’étonne Gros Luc en se hissant prudemment à mes côtés, hors de terre.
Je l’informe qu’il ne faut pas compter dessus dans l’immédiat. Nos deux derniers jets ont écopé d’une pénalité de vingt minutes pour refus de combat.
Gros Luc se laisse glisser en arrière sur le ventre. Moi aussi.
J’estime que Franck est mort maintenant. Baptiste me scande des trucs en créole à quelques centimètres du visage. Je crois voir les crocs d’un chien claquer. Il perd la tête. À tous les coups, il a mal dosé sa dope. C’est un art de doser, de ne pas céder à la gourmandise. Mais quoi qu’il en soit, on ne peut pas être soumis aux mêmes règles qu’un haltérophile ou un sprinter. De tout temps, les troufions sont montés à l’assaut chargés comme des mulets, ou avec un flingue dans le dos pour les convaincre de se montrer braves. Mais tout le monde ne tient pas la dope comme Gros Luc. Baptiste a trop forcé sur le stimulateur de bravoure. Il tente maintenant de s’arracher le peu de cheveux crépus qu’il a sur le crâne en gémissant comme un damné. Gros Luc lui demande de la fermer. Il ne la ferme pas. Gros Luc l’agrippe par le col, presse son front contre le sien et lui murmure quelque chose. L’Antillais finit par se taire.
Je m’apprête à lancer un appel radio pour savoir si l’on peut être évacués quand ça crachote dans mon casque.
— sec…2, répon… Ici QG, …ion 2…
— Section 2 à QG. Je vous reçois 1 sur 5. Sommes coincés à environ deux kilomètre à l’ouest de chez vous. Plus de matériel puissant, trois hommes seulement avec moi, dont un blessé grave. On reste à couvert jusqu’au coup de sirène.
— Négatif sec..on 2, vous ret…nez au bois.
— Pourquoi ? Putain, non !
— On a besoin de 15 …utes de diversion avec les blindés. Les images de Canal Global nous signalent la …sence d’armes antichars abandonnées sur place, et vous êtes à 300 mètres maxi…
— Je ne vous entends plus QG.
— Fous-toi .. ma gueule, et tu vas pas être déçus des sanctions.
Gros Luc chantonne une comptine dans laquelle il est question de loup et de forêt.
Je ne vois personne entre nous et le bois calciné. Les blindés sont loin.
Je dis à Gros Luc que c’est maintenant ou jamais. Nous sortons comme deux fous, abandonnant Roger et Franck au fond du trou.
Arrivés sur place, nous cherchons fébrilement les fameuses armes, pliés en deux comme si ça limitait les risques de se ramasser un projectile.
Un drone de Global sort de nulle part et bourdonne au-dessus de nos têtes, ses caméras braquées comme des mitrailleuses. Cette saloperie risque d’attirer l’attention de l’ennemi. Du coup, nous rampons carrément. Et puis, aux côtés d’un type brûlé à un degré tel qu’il est difficile d’imaginer qu’il ait pu courir jusque ici, je mets la main sur un tube anti-char. Je le regrette aussitôt. Nous sommes à découvert, sans appui. Est-ce bien malin de se manifester ? Nous restons à plat ventre un moment, mais je finis par abaisser le cran de sécurité et j’ajuste un blindé dans la mire électronique en me disant que je tremble trop, et qu’il est trop loin pour que je tape dedans.
Le mini-missile fuse pourtant à mille deux cents mètres par seconde selon une trajectoire parfaite.
En plein dans le mille.
Un court silence, une respiration, et le véhicule et tous ses occupants volent en éclats. La densité de l’uranium a frappé pile au bon endroit.
Dans mes jumelles, je vois les autres blindés qui font volte-face et envoient une volée de gros pruneaux dans notre direction. Ils ne nous ont pas encore précisément localisés et les obus s’abattent à une cinquantaine de mètres. Nous ne bougeons pas une oreille sous la lourde pluie de boue et de cailloux.
Deux tanks se détachent du groupe et avancent vers l’endroit où nous tentons vainement de nous enfoncer dans le sol. Mes testicules sont réduits à deux raisins secs.
La puissante sirène de fin de partie retentit alors.
Notre QG vient de se rendre.
Nous nous relevons, levons les bras.
Les chars grincent en s’immobilisant.
Les tankistes Vénézuéliens descendent et nous échangeons nos casques en nous tapant dans le dos.
Nous sommes tous très heureux de rentrer aux vestiaires, et de prendre une bonne douche.


