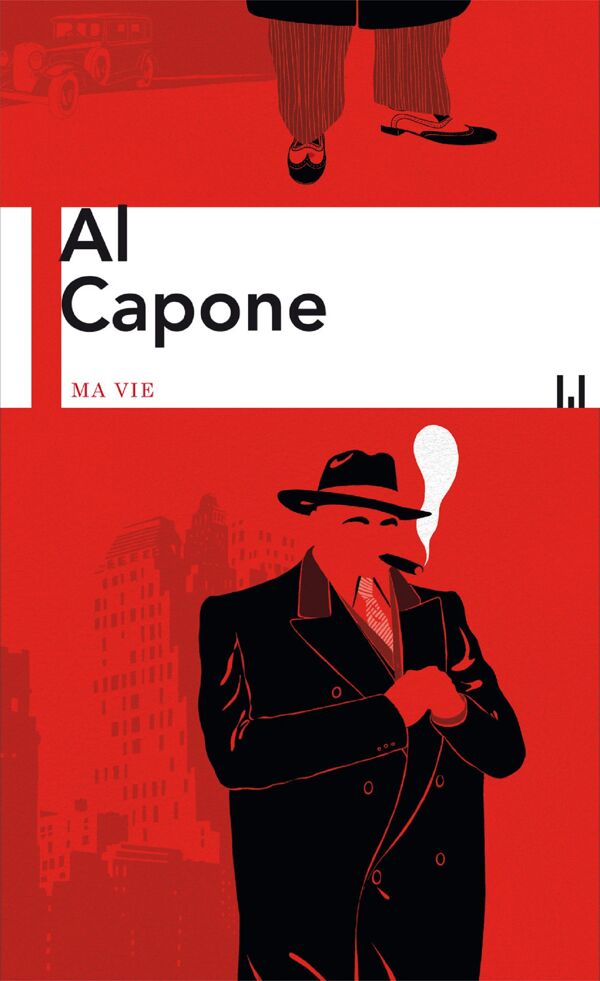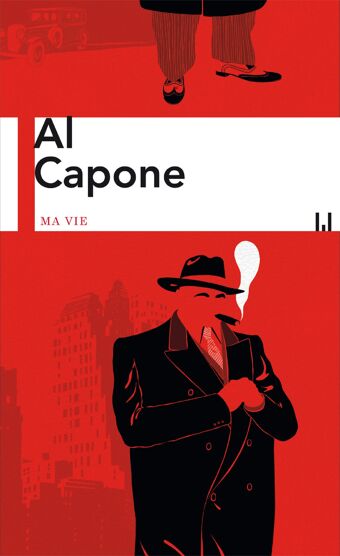
Al Capone
Ma vie
En 1939, un journaliste est engagé pour écrire l’autobiographie d’Al Capone à partir d’une série d’entretiens. Au fil des rendez-vous, l’auteur réalise que le grand Al Capone livre de son existence une version fantaisiste. Incapacable de discerner le vrai du faux, usé par ces interviews, le journaliste abandonnera son projet. Mais ses notes seront publiées dans la presse pulp américaine, puis reprises et rassemblées sous la forme d’un récit.
Ma vie d’Al Capone est ce texte inspiré de la légende d’Al Capone, telle que le célèbre gangster a choisi de la raconter au moment de livrer ses mémoires.
Cette autobiographie fantasque d’Al Capone par Al Capone est accompagnée d’une postface de Stéphane Quéré, criminologue et professeur à Paris II.
Une édition entièrement révisée par Marie-Anne Lenoir.
- Revue de presseUn texte inspiré de la légende d’Al Capone, telle que le célèbre gangster a choisi de la raconter.
Ma propriété de Palm Island, en Floride ? C’est la perle de toute la côte. Si j’ai voulu la faire construire sur une île en face de Miami, c’est parce que je me méfie des gens, je ne tiens pas à ce qu’on me surveille. Cette maison est vraiment d’une beauté incroyable. Elle m’a coûté plus de deux millions de dollars [1]. Dans le jardin, près de la grande grille d’entrée, il y a une immense piscine en marbre dans laquelle je nage tous les jours. Juste à côté, j’ai fait installer un stand de tir où je m’exerce tous les matins. J’ai beaucoup d’ennemis, je le sais. Mais je les ai toujours considérés comme des minables.
Mon seul vice, c’est d’avoir offert à mes proches tout le confort et tout le luxe que je pouvais. C’est vrai, j’ai tiré huit ans à Alcatraz. Mais si je tiens aujourd’hui à dire toute la vérité sur la vie de « Scarface », c’est bien parce que j’ai toujours été honnête. Parfaitement honnête.
Avant de commencer ce qu’on pourrait appeler « mes confessions », je dois préciser quelque chose. Je n’ai pas toujours été en règle avec la loi, pour une seule et unique raison : parce que les hommes qui ont croisé mon chemin voulaient m’imposer la leur.
Je l’avoue, j’aime jouir de la vie. Trop, peut-être. J’ai toujours détesté les bourgeois et les bien-pensants. Les millionnaires de Miami se sont affolés à mon arrivée, toutes ces demi-portions, ces rois de la camelote, du chewing-gum bon marché et du caoutchouc synthétique, tous ces escrocs de Wall Street. Pourtant, ils ont tous beaucoup apprécié les fêtes somptueuses que j’ai données ici, ces braves et honnêtes citoyens.
Je crois pouvoir dire qu’on a vu chez moi les plus jolies femmes du monde. Et aussi des écrivains comme Sinclair Lewis [2], des artistes comme Charlie Chaplin, des savants, des hommes politiques, des acteurs, des industriels.
C’est vrai, j’ai été le roi de Chicago, et même le personnage le plus puissant d’Amérique. À côté de moi, Monsieur Herbert Hoover, le locataire de la Maison-Blanche, faisait figure de petit garçon.
On a dit de moi que j’étais le chef des bandes d’assassins les plus dangereux du monde. Je dirais que j’ai seulement été un peu plus malin que les autres.
Je suis avant tout un bon père de famille qui aime jouer avec son petit garçon, et un homme qui aime sa femme avec passion. Ma plus grande joie dans la vie, c’est de cuisiner des spaghettis à la napolitaine pour mes amis - ils sont rares. Je prépare mes pâtes moi-même, dans la cuisine de cette maison qui fait tant de jaloux et qui est vraiment la plus belle de toute la Floride.
C’est vrai, je suis un homme riche, craint et respecté. Je le serai jusqu’à ma mort.
Je vais vous raconter ce qu’a été ma vie. Au fond, on connaît peu de choses sur moi. On a dit que j’étais le plus grand des gangsters et l’ennemi public numéro un ; que j’avais quarante-cinq domestiques, douze gardes du corps, un château qui valait des centaines de millions. On a dit aussi que j’avais à mon service un des cuisiniers les plus célèbres de Paris, Dusseigneur, à qui je donnais chaque mois mille dollars d’appointements ; ou encore que je possédais dans Prairie Avenue, à Chicago, une maison pleine d’objets d’art qui valaient des millions ; que je jetais l’argent par les fenêtres quand j’allais voir ma soeur, à Pâques et à Noël, dans son pensionnat, avec des automobiles remplies de cadeaux de toutes sortes. On m’a attribué onze maîtresses officielles, un compte faramineux à la First National Bank, et une voiture blindée qui serait devenue, plus tard, celle du président Roosevelt.
Pourtant, tout ça n’est pas ma vraie vie. Il faut que je commence par le commencement.
J’ai grandi à New York. J’ai toujours détesté cette ville. Gamin, il ne m’a pas fallu longtemps avant de comprendre ce que voulait dire « gagner sa vie ». Ca voulait dire être fort, puissant et inspirer le respect. Le problème, c’est que moi, j’habitais à Five Points une vieille bicoque aux trois quarts pourrie. Je payais pour ça un dollar par mois à une ancienne pute reconvertie en logeuse, une certaine Lily qui avait fait fortune dans l’Ouest grâce à la traite des femmes.
Five Points, c’était mon quartier général. J’en sortais rarement, et quand par hasard j’allais jusqu’à Time Square, j’avais l’impression d’aller au bout du monde.
J’ai commencé à fréquenter les bars du Bowery - j’avais une petite amie italienne. J’y retrouvais chaque soir les rôdeurs de Manhattan et du Bronx. Il fallait bien que je me débrouille, alors je me suis mis à m’exercer à la passe. Au bout de six mois, j’étais devenu un champion et quand ils me voyaient, tous les truands de Five Points s’écriaient :
- Tiens, voilà le beau Al, le roi de la passe !
Je peux bien l’admettre aujourd’hui : je trichais. Et voilà comment je m’y prenais. J’avais un complice, un « baron[3] » qui allait recruter des joueurs et qui les amenait « chez Fred », un bouge infect. Je les plumais en moins d’un quart d’heure. Parfois, je plantais un couteau au milieu de la table ou bien je gardais un fusil à portée de main, ça me permettait d’être plus convaincant.
Assez vite, je me suis aperçu que ce job ne me rapporterait pas plus de quatre ou cinq dollars par jour. Il fallait absolument que je trouve quelque chose de mieux, de quoi faire, en gros, trente dollars par jour. On était en 1917, c’était plutôt difficile. C’est alors que ma logeuse, la vieille Lily, m’a dit un matin :
- Tu devrais aller voir Saddie « the Goat [4]». Il contrôle tout le quartier de Dead Rabbits. Il a cinq cents types sous ses ordres. C’est le genre de gars qui pourrait t’aider à te tirer d’affaire.
Dans ma petite cervelle de jeune homme, Saddie « the Goat » était l’as des as, le roi des rois. Je me souviendrai toute ma vie du jour où je suis allé me présenter chez ce tueur irlandais. C’était un dimanche dans un bar de la 4e rue. En arrivant au comptoir, j’ai demandé au garçon où je pouvais trouver Saddie.
- Qu’est-ce que tu lui veux ? m’a rétorqué le serveur.
J’ai hésité quelques secondes avant de répondre :
- Lui proposer mes services.
L’autre alors a ricané :
- Te casse pas la tête, rien qu’à ta dégaine, on voit bien que tu ferais pas de mal à une mouche.
Blessé dans mon amour-propre, et pour prouver que j’étais un homme, j’ai attrapé une bouteille de whisky qui traînait sur le comptoir et je l’ai lancée en plein sur sa face de fouine.
Deux coups de feu ont éclaté dans la salle. C’est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. Arrivait droit sur moi un homme terrible. Une véritable brute. Imaginez un gaillard velu comme un orang-outang, aux sourcils épais, à la mâchoire qui avance. Il portait à la ceinture deux revolvers. Une vraie terreur. Il a marché vers moi, m’a flanqué une retentissante paire de gifles et a déclaré :
- Tu me plais, toi !
Il m’a emmené dans l’arrière-salle et a finalement proposé de me prendre sous ses ordres pour un salaire de cinquante dollars par semaine. Je n’ai pas hésité une minute. C’était un job royal et j’étais fier de faire partie de la bande à Saddie.
Aujourd’hui encore, j’aime décrire ce qu’était la vie dans ces quartiers lépreux du New York de 1917. Il y avait deux bandes : celle de Gyp the Blood et la nôtre. On se partageait le contrôle des bars ; mais comme dans toute affaire qui se respecte et où il y a deux concurrents, on ne s’est pas entendus très longtemps. Assez vite, ça s’est gâté. Un jour, nos deux bandes se sont rencontrées. Je ne suis pas prêt d’oublier ce qui s’est passé.
J’ai déjà décrit mon chef, qu’on appelait entre nous « le Bouc ». Eh bien, le chef de la bande adverse, Gyp the Blood, se vantait de pouvoir casser une colonne vertébrale sur son genou ; rien que pour s’amuser, pour un pari à deux dollars, il était capable de casser les reins du premier type venu.
- L’explication » a eu lieu dans un bar fréquenté par toute la racaille de Dead Rabbits. Sept ou huit hommes sont entrés dans l’établissement, ils ont sorti leurs armes et ont commencé à tirer dans les miroirs, les lampes, le plafond. C’était un règlement de comptes exactement dans le style de Gyp the Blood. Mais nous, on était là. On a commencé à cogner. Les deux caïds, notre chef et celui de la bande adverse, s’amusaient à tabasser tous ceux qui leur tombaient entre les mains, et à écraser à coups de bottes ferrées les visages des blessés. Un vrai combat de sauvages en furie.
[1] Soit l’équivalent de vingt millions de dollars aujourd’hui. (Toutes les notes sont du traducteur)
[2] Harry Sinclair Lewis est un très célèbre de l’entre-deux guerres. En 1930, il fut le premier américain à recevoir prix Nobel de littérature.
[3] En français dans le texte.
[4] Saddie « la Chèvre ».