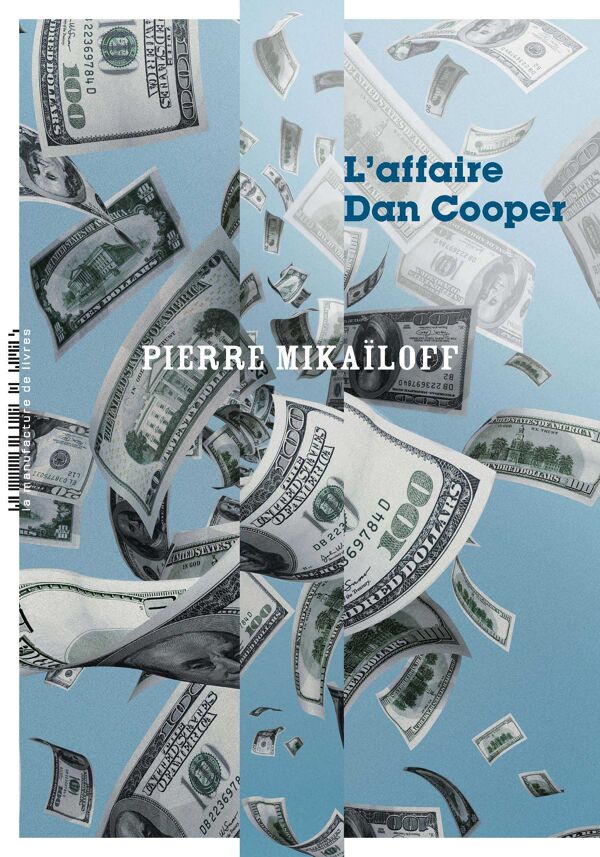Pierre Mikaïloff
L’Affaire Dan Cooper
Novembre 1971. Dan Cooper devient le plus mystérieux des pirates de l’air. Après avoir détourné un Boeing, il saute en parachute au-dessus des forêts de Portland et disparaît à tout jamais avec sa rançon. Pour le journaliste Mark Anderson, cette affaire est une obsession : pendant 45 ans, il a mené l’enquête, essayé de doubler la police, épluché les rapports… Et alors que le FBI décide de classer l’affaire, Anderson entend parler d’un nouveau témoin essentiel. L’occasion de replonger dans ses notes et de revenir sur les interrogatoires de ceux qui, chacun à leur manière, racontent le mystère Cooper et réinventent le mythe du hors-la-loi.
Dans ce roman, Pierre Mikaïloff s’approprie l’une des plus légendaires affaires criminelles américaines. À travers la vie de quelques anonymes, il nous dresse en creux un portrait de l’Amérique, de ses chercheurs d’or contemporains, de ses monstres et de ses doutes.
- Revue de presseUne subtile galerie de personnages et une affaire mythique.À travers une subtile galerie de personnages liés à l’une des affaires criminelles américaines parmi les plus légendaires, Pierre Mikaïloff dresse en creux un portrait de l’Amérique contemporaine et de ses travers.Roman à la fois drôle et glaçant qui témoigne d’une Amérique profonde faite d’injustices et d’inégalités.Sans surprise, ce bouquin incroyablement divertissant se lit en moins de temps qu’il n’en a fallu à Cooper pour enfiler son parachute.Rebondissement du mystère ? C’est ce que nous raconte Pierre Mikaïloff dans un roman noir rondement mené.
Retrouvez ici la chronique complèteRoman riche, à la fois noir et social, L’affaire Dan Cooper offre son lot de surprises et elles sont bonnes, voire très bonnes ! - téléchargez l’extrait
Si vous ne trouvez pas de boulot parce qu’ils vous croient cinglé
Si vos plus belles années sont parties en fuméeSi vous vous réveillez le matin
Avec pour seule compagnie une douleur lancinante
C’est que le moment est venu de prendre l’avion
LA CONFESSION DE D.C.
Je flotte dans le ciel
Jamais eu l’ambition d’apprendre à voler
Je serai heureux quand ce sera finiEt que je serai sur le point d’atterrir
Un sac plein de fric à la main
Ne cherchez pas mon nom dans l’annuaire, il n’y figure pas et n’y a jamais figuré. Pour les plus jeunes d’entre vous, il n’évoque rien, pour ceux qui étaient en âge de lire les journaux au début des années soixante-dix, il reste associé à un fait divers célèbre. J’ai inspiré des dizaines de personnages de fiction, j’apparais dans des séries télé, des films, des romans, des documentaires, des chansons, des bandes dessinées… Dans le hameau d’Ariel, la patronne d’une taverne a même créé un D. Cooper Day en mon honneur. Tout ça, parce que depuis cinquante ans, je demeure une putain d’énigme !
Le moment est venu de raconter mon aventure telle que je l’ai vécue, et non telle que les journalistes et autres fouineurs l’ont écrite. Quand elle commence, le 24 novembre 1971, je suis un mâle américain au faîte de sa productivité, un vrai cliché publicitaire. Cheveux courts, costume-cravate, attaché case : je corresponds tellement au stéréotype du cadre trentenaire de race blanche que je me fonds dans le décor.
En cette veille de Thanksgiving, un pâle soleil éclaire le parking du Portland International Airport où j’abandonne ma vieille Ford. Après avoir extrait mon unique bagage du coffre, je jette le ticket de parking – je n’en aurai plus besoin – et me dirige vers le hall d’embarquement. Je cherche des yeux le comptoir de la Northern Airlines. Une charmante hôtesse m’annonce que le Vol 505 décollera à l’heure.
À l’époque, le contrôle des passagers est une simple formalité : vous pouvez introduire un bazooka dans un jet du moment que vous n’êtes pas en surpoids. C’est tout juste si la fille qui vérifie les billets accorde un regard à la mallette que je demande à garder en cabine. J’ai beau avoir répété l’opération des dizaines de fois dans ses moindres détails, je suis un peu ému en gravissant les marches qui mènent à la cabine. Vous conviendrez que ce n’est pas tous les jours qu’on détourne un Boeing 727.
12 JUILLET 2016
Mark Anderson était assis devant sa vielle machine à écrire IBM, dans sa pièce préférée, le bureau qu’il avait aménagé dans le sous-sol de sa maison. Il y passait ses journées, parfois ses nuits, depuis le décès de Norma, à classer ses archives, quarante-quatre ans de chroniques judiciaires. C’est en vain qu’elle lui avait suggéré de libérer une partie des étagères qui pliaient sous le poids de dossiers gonflés de pages dactylographiées, de photocopies, de photos jaunies par le temps. Au moins quelques-unes, plaidait-elle, pour y ranger les confitures et les conserves qu’elle préparait pour l’hiver. Mais il demeurait inflexible. Et maintenant qu’elle n’était plus là, la préservation de ces documents constituait sa seule raison de vivre, car ils n’avaient pas procréé, ses spermatozoïdes étaient trop fainéants selon les médecins. Il projetait, si sa santé lui en laissait le temps, d’écrire un livre qui rassemblerait les affaires les plus retentissantes couvertes au cours de sa carrière. Pour l’instant, il en était à la cent-cinquantième version de l’avant-propos. La corbeille à papier débordait.
Il relut le paragraphe qu’il venait de rédiger, estima que cela ne valait pas un pet de lapin et en fit une nouvelle boulette. Son regard erra un instant sur le fouillis qui encombrait la vaste table sur laquelle il était installé, puis s’arrêta sur l’édition du jour de l’Oregonian qu’il n’avait pas encore ouverte. Comme tous les anciens du quotidien de Portland, depuis son départ en retraite, il bénéficiait d’un abonnement gratuit.
Il accorda peu d’attention à la une que se partageaient une alerte à la pollution sur le littoral, l’inauguration d’un centre commercial et la fermeture d’une aciérie, pour aller directement à la rubrique judiciaire. Son successeur, Richard Kaminski, bien que fraîchement sorti d’une école de journalisme et vierge de toute expérience professionnelle, hormis quelques stages ici et là, s’avérait très capable. Malgré leur différence d’âge, au cours des quelques mois pendant lesquels il lui avait passé le relais, leur relation avait pris un tour amical. Se gardant de tout paternalisme, Anderson lui avait enseigné les ficelles du métier et présenté les huiles du comté en matière de maintien de l’ordre et de justice. Souvent, en fin de journée, ils décompressaient autour d’une bière, un rituel auquel se plie volontiers la population de la « ville aux quatre-vingt-cinq brasseries », comme le rappellent les sites des agences de voyage. Dick, comme il l’appelait familièrement, semblait prendre un réel intérêt à l’écouter ressasser ses souvenirs d’une époque où la salle de rédaction ressemblait à un fumoir, où les journalistes passaient leurs appels depuis un téléphone fixe et manipulaient de volumineuses encyclopédies lorsqu’ils voulaient vérifier la date de naissance de Lee Harvey Oswald ou les statistiques de la criminalité à Chicago en 1974.
Il lisait toujours avec intérêt les articles de Dick et résistait à la tentation de l’appeler pour rectifier un détail ou exprimer un point de vue divergent. Mais son papier du jour, intitulé « LE FBI CLÔT LE DOSSIER DAN COOPER, AUTEUR D’UN DÉTOURNEMENT D’AVION RESTÉ DANS LES MÉMOIRES », le fit bondir. Il avait consacré la plus grande partie de sa vie professionnelle à cette affaire. Même quand il n’était pas censé travailler dessus, il le faisait à ses heures perdues, le soir ou le week-end, ce qui désespérait Norma.
Après avoir lu l’article une première fois, il recommença lentement, pesant chaque mot. Kaminski citait d’abord un porte-parole du FBI : « Après l’une des enquêtes les plus longues et les plus approfondies de notre histoire, nous avons décidé de réorienter les ressources consacrées au cas Dan Cooper vers d’autres priorités. Chaque fois que le FBI évalue de nouveaux indices liés au Vol 505, des ressources en moyens et en personnel sont détournées de programmes plus urgents. Des centaines, sinon plus, de détectives amateurs continuent de nous harceler avec leurs soi-disant pistes. Nous espérons à l’avenir nous épargner les appels irritants, e-mails loufoques et autres témoignages fantaisistes.J’ajouterai que l’enquête était au point mort depuis des années. »Très exactement depuis quarante-cinq ans, c’est-à-dire depuis le premier jour, corrigea Anderson.
Plus loin, Kaminski égratignait le mythe Cooper, citant Toscanini qui avait dirigé l’enquête dans les premiers temps et l’avait qualifié d’« escroc miteux ». Il évoquait aussi les déboires des collègues qui lui avaient succédé : Lewis et Miles, deux brutes épaisses qui considéraient l’intimidation comme le fin du fin en matière de technique d’investigation ; Ravel et Powell, qui s’étaient pris pour Truman Capote et avaient publié un livre relevant de la plus haute fantaisie – Cooper y était notamment dépeint comme un soudard illettré, ce qui allait à l’encontre de ce que l’on sait du personnage – ; ou encore l’agent Noonan, arrivé à un moment où ce dossier n’intéressait plus qu’une poignée d’agents proches de la retraite et de journalistes nostalgiques. Noonan avait tout repris à zéro, traquant le détail oublié, le témoignage négligé, quitte à y laisser sa santé et sa raison, mais il se battait sur deux fronts. Entre deux investigations, il mendiait des rallonges budgétaires, pleurait pour utiliser un labo, et tapait des mémos épais comme des T-bone steaks pour que le Bureau ne classe pas l’affaire. En fin de compte, il n’avait rien découvert de neuf. Après son départ, Coleman était entré en scène. Zélé, mais naïf, ce taurillon avait foncé tête baissée sur le chiffon rouge qu’un collègue facétieux agitait devant lui, avant de tomber dans le piège qui guette tous les flics qu’on pousse vers une voie de garage : la gnôle.
Kaminski énumérait rapidement les moyens mis en œuvre pour tenter de coincer Cooper : les huit cents témoins auditionnés, les dizaines de suspects cuisinés... Mais comment traquer une ombre, sinon en faisant appel à S.O.S. Fantômes ? Parce que ce type n’avait pas plus d’existence physique qu’un ectoplasme. Dick ne le mentionnait pas dans son article, mais Anderson se souvint que le FBI avait passé au peigne fin tous les cas de disparitions signalés autour du 24 novembre 1971 sur le territoire des États-Unis. Un paquet de citoyens manquait à l’appel et avait ses raisons pour cela : époux modèles partis avec leur secrétaire, représentants de commerce envolés avec une provision de chèques au porteur, appelés qui n’avaient pas rejoint leur unité après Thanksgiving… Aucun n’était Cooper. Au cours de ces décennies d’enquête, le Bureau avait étudié plus particulièrement une dizaine de profils pouvant prétendre au titre de suspect idéal. Il existait un million de bonnes raisons d’envoyer ces criminels à l’ombre, voire sur la chaise électrique pour certains, mais aucun n’avait pris place à bord du Vol 505.
Il manquait autre chose dans ce papier : la prise en compte de l’érosion monétaire. Si Kaminski mentionnait bien la rançon de 200 000 dollars qu’avait empochée Cooper, il omettait de préciser qu’en 2016, cette somme équivalait à un pouvoir d’achat d’un million deux cent mille dollars.
Anderson avait reposé le journal. Il n’en fallait pas davantage pour le replonger dans son passe-temps favori : percer le mystère de l’identité du pirate de l’air. Par le passé, il avait tenté de brosser son portrait psychologique. Et il fallait bien reconnaître que le personnage n’apparaissait guère reluisant : ni Robin des Bois ni Jesse James, loin du cliché du bandit chevaleresque flanqué de complices dévoués, il avait agi en solitaire, froidement, pour son seul bénéfice, et n’avait accompagné son crime d’aucune revendication sociale ou politique.
L’article de Kaminski le chiffonnait aussi par sa taille : à peine trois petits paragraphes pour résumer une affaire de cette importance. Cette fois, il était complètement passé à côté du sujet. Sans doute était-il trop jeune pour mesurer l’impact que ce crime avait eu sur le public. À force de ruminer, il finit par mettre un nom sur ce qu’il éprouvait : injustice ! Dan Cooper et les bataillons d’enquêteurs qui s’étaient succédé pour le retrouver méritaient mieux que trois malheureux paragraphes. D’autant plus que, selon un informateur qui s’était manifesté récemment, il y avait peut-être du nouveau. De cela aussi, il voulait s’entretenir avec son jeune collègue. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de la rédaction.
LE MESSAGE
Malgré une soudaine détérioration de la météo, le décollage s’effectue sans problème. Pour me détendre, je commande un whisky-coca et allume une cigarette – oui, une cigarette, on est en 1971 ! Et je la savoure, cette Mapleton. Je me détends un peu. Mon plan est infaillible, pourquoi s’inquiéter ? Le vol est censé durer une demi-heure. Il n’est que temps d’attirer l’attention de l’hôtesse qui s’occupe de ma rangée et de lui remettre le message que j’ai rédigé à l’avance. Le badge accroché à sa poitrine indique qu’elle se prénomme Rose. Elle m’accorde un demi-regard et le range sans le lire – plus tard, elle justifiera sa réaction en expliquant qu’elle avait cru à une invitation à prendre un verre de la part d’un homme d’affaires esseulé. Je la rappelle et prononce cette phrase que tous les journaux reproduiront :
- Mademoiselle, vous feriez mieux de lire cette note. Il se trouve que j’ai une bombe.
Après l’avoir parcourue, elle m’examine d’un air soupçonneux. Elle n’a pas encore éliminé la possibilité qu’il s’agisse d’un plan drague un peu tordu, ce ne serait pas la première fois. Elle s’approche et, d’une voix froide et professionnelle, demande à voir les explosifs. Pas de problème ma jolie ! J’entrouvre la mallette, juste assez pour qu’elle se rende compte que je ne rigole pas. Cette fois, elle accepte de transmettre mes instructions au commandant de bord : il devra atterrir comme prévu à Seattle, où le directeur de l’aéroport me remettra en personne une rançon de 200 000 dollars en coupures de vingt. Je réclame aussi quatre parachutes et un plein de kérosène. Si je tiens à ce que le directeur de l’aéroport se charge de la livraison, c’est parce que je connais son visage. S’ils envoient un flic, je le saurai tout de suite.