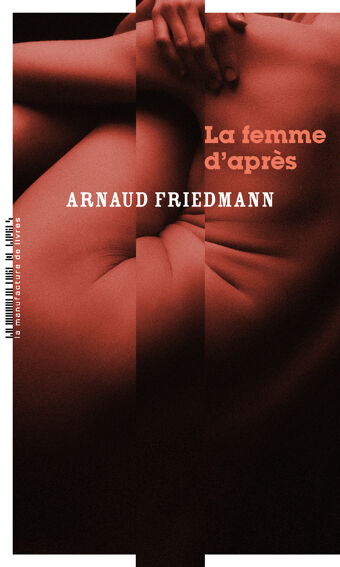
Arnaud Friedmann
La Femme d’après
Dans la nuit, elle regagne son hôtel après ce dîner avec un amour de jeunesse, retrouvé vingt ans plus tard. Elle se sent légère, grisée par la promesse de cette nouvelle aventure. Mais quatre hommes s’arrêtent soudain devant elle. Des mots échangés, une insulte, un regard qui refuse de se baisser. Ils repartent. On pourrait dire que rien ne s’est passé et pourtant demeure en elle une angoisse sourde. Son trouble grandit quand le corps d’une jeune fille est retrouvé le lendemain dans le même quartier. Pourquoi se sent-elle coupable de cette mort ? Qu’y a-t-il en elle qui dissuade ? Pourquoi lui trotte dans la tête le soupçon indigne de n’avoir pas été assez désirable ?
La Femme d’après nous conte la mécanique implacable d’une agression qui aux yeux de tous passera inaperçue. En écho à cette scène, avec finesse et sensibilité, Arnaud Friedmann explore les blessures et les désirs qui marquent la vie d’une femme tandis que le temps passe.
- Revue de presseUn texte perturbant qui m’a troublé et obligé à relire plusieurs fois la fin. Vous verrez…
Retrouvez ici l’intégralité de cette chronique“Je voulais que chaque lecteur puisse projeter sur ce personnage sa propre représentation, et je voulais que la couverture garde cet aspect un peu mystérieux.”
Retrouvez ici l’intégralité de cette interviewBeaucoup de choses dont parle l’auteur sont vraies, sont endurées ou ressenties chaque jour par des millions de femmes ayant dépassé la quarantaine dans le monde.Tout au long du roman, on est dans la tête de cette femme entre deux âges, sur une ligne de crête à la fois sensible, captivante et qui évite toute caricature.Cette histoire est comme dans un véritable labyrinthe ; elle est en effet « prisonnière » d’enchevêtrements les plus divers ; elle avance au gré des réflexions et des rencontres du personnage central de l’histoire.Un roman absolument bouleversant.Un roman risqué et réussi.J’ai passé un vrai moment de lecture parce qu’Arnaud Friedmann écrit bien. Foutrement bien.
Retrouvez ici l’intégralité de cette chroniqueUn roman noir, psychologique, très tendu, qui marche vraiment bien.
Retrouvez ici l’intégralité de cette chroniqueUne fin sidérante.Il me faut un sujet sur lequel j’ai envie de travailler. Par exemple, pour La Femme d’après, il y a cette question du corps qui change, du temps qui passe, du désir qui devient un peu différent…Un récit envoûtant qui nous absorbe dans les angoisses et les désirs de cette femme.Une très fine description des mécanismes qui se mettent en place après une agression et un portrait de femme saisissant.Un roman d’une sensibilité à fleur de peau sur la vie qui passe.Un texte qui aborde des thématiques tabous avec beaucoup de finesse psychologique et une plume précise et percutante.
Retrouvez ici l’intégralité de cette chroniqueUn roman psychologique qui aborde les ambiguïtés des questions que l’on se pose après la quarantaine en y appliquant le filtre d’un drame non vécu… mais qui aurait pu. Glaçant !L’héroïne sait à travers la plume délicate d’Arnaud Friedmann captiver son lecteur jusqu’au bout, avec une tension presque palpable physiquement, dévoilant une fragilité qui confine à la folie.C’est un très beau roman, c’est un très beau coup de cœur, c’est un roman qu’on n’oublie pas.
Retrouvez ici l’intégralité de cette chroniqueLes émotions qui émaillent ce monologue entrecoupé de dialogues tendent à l’universel.La femme d’après, réflexion sans concession sur le vieillissement, les désillusions, la peur de la folie.Un angoissant voyage pour un roman noir dérangeant.On reste parfois subjugué par la profondeur de certains romans. C’est le cas de celui-ci. - La Femme d’après d’Arnaud Friedmann fait partie de ces romans marquants, qui vous secouent et ne peuvent vous laisser indifférents.Un roman original où le personnage principal étonne par son ambivalence, son ambiguïté.Il y a parfois, quand un auteur se met dans la peau d’une femme, un numéro d’équilibriste audacieux dont Arnaud Friedmann se tire sans faux-pas.
- téléchargez l’extrait
Il y a l’air tiède du milieu de la nuit, quelques moteurs en écho, le bourdonnement des télévisions à l’intérieur des immeubles, puis soudain, des voix. Je ne m’y attendais pas. Je pensais avoir le trajet pour moi. J’avais fantasmé ce retour solitaire jusqu’à ma voiture, dix minutes pour infuser la soirée, ses promesses. Il n’y a pas loin, de l’appartement au parking, le quartier est excentré ; cubes neufs, habitations cossues ; malgré l’été je n’avais pas prévu ça : croiser des gens.
Je ne ressens pas d’appréhension. Juste le dépit d’autres silhouettes que la mienne dans les rues, et l’ennui des politesses auxquelles il faudra se soumettre.
Ils s’approchent, ils parlent fort. Je les entends, même si je ne distingue pas les mots. Ils ont l’accent d’ici, du Sud, ou de plus au sud ; des voix d’hommes jeunes. Je souris. Je revois la silhouette de Jacques à côté de la mienne sur le balcon, nos corps animés par la même attraction que vingt ans plus tôt, les gestes vigilants qui étaient les nôtres pour trinquer et nous dévoiler sans l’urgence des premières fois.
Ils avancent vers moi sans le savoir, sans savoir qu’à la prochaine intersection ils me croiseront, moi que leur jeunesse attendrit. Leurs voix s’imposent à la nuit, des promesses les attendent, plus entières que les miennes, moins sereines. Je m’ouvre à eux avant de les avoir vus, malgré mon envie d’avoir la ville pour moi seule.
Depuis combien d’années ne me suis-je pas sentie légère à cause d’un homme ? Du commencement possible d’une histoire – de sa répétition dans le cas présent ?
Maintenant, je les vois. Ils m’ont vue, eux aussi. Ils cessent de parler, continuent d’avancer dans ma direction. Une angoisse, d’un coup. Elle chasse mes rêves de romance répétée avec Jacques, m’assène que je ne devrais pas être là, à marcher dans les rues de Montpellier le visage allumé d’un espoir anachronique, avec mes rêves de promenades dans la nuit pareilles à celles de mon adolescence.
Ils sont quatre, trois derrière, un qui se tient devant, qui met le cap sur moi comme si je n’existais pas. Ou que si, justement. Comme si j’existais trop.
- C’est pas prudent de se balader toute seule, comme ça, la nuit, Madame.
Derrière, les comparses ne ricanent pas. Je me serais attendue à ce qu’ils ricanent, ça aurait correspondu à mes codes, j’aurais identifié l’agression, au moins reconnu ça, ça m’aurait tranquillisée.
Celui qui se tient devant est tout près de moi. Les autres à quelques pas, indistincts. Je sens l’odeur de son haleine, un relent de chewing-gum à la menthe, décalé. C’est ce qui m’affole le plus, de reconnaître dans sa bouche les effluves de mes premières amours, de Jacques à la sortie de notre premier cinéma ensemble, il y a presque vingt ans. Opening Night.
- T’as entendu ce que j’ai dit ? C’est pas prudent, ce que tu fais.
L’affiche du film rechigne à s’estomper, derrière la vitre sale de la rue Gambetta. L’obtuse pâleur de Gena Rowlands et la force qui se dégageait d’elle. Je t’imagine comme elle, plus tard, m’avait chuchoté Jacques pendant qu’on s’approchait de la caisse ; je l’avais mal pris.
Le silence me contraint à regarder celui qui vient de parler, le silence et l’immobilité soudaine de notre décor. Aucun de ses traits n’adhère à ma mémoire. Je me concentre sur sa voix, y déniche des intonations qui pourraient plaire aux filles s’il les modulait différemment, à la manière d’un acteur américain. Les autres continuent de se taire. Je n’avais pas l’impression, avant d’apparaître dans leur champ de vision, que leur conversation rendait un son grégaire. L’idée me traverse, je me hais pour cette idée, l’idée me traverse que je ne devrais pas être là, pas avoir traversé la France pour retrouver Jacques vingt ans après notre séparation, me mettre en travers du chemin de ces types, les contraindre à m’agresser. À laisser leur chef rouler ces mots menaçants, jouer la partition attendue.
Au moins j’aurais dû rester chez Jacques jusqu’à la fin de la nuit, accomplir ce que j’étais venue chercher, plutôt que m’offrir cette liberté dans les rues, le film de la soirée dansant dans la tête jusqu’au parking, jusqu’à l’hôtel. La possibilité de croire que j’avais encore le pouvoir d’en rester là, rentrer chez moi, juste l’avoir revu et désiré autant qu’il y a vingt ans.
- Tu me réponds, connasse ?
J’enregistre qu’il ne m’a pas traitée de salope. J’en tire un courage inouï, déplacé, une absence de peur absolue. Salope, oui, l’histoire aurait été différente. Les comparses aussi sont déçus. Il n’y pas de temps à perdre pour garder l’avantage.
- Je me promène.
- Toute seule ?
Il va ajouter quelque chose. La phrase est déjà prête, elle contient le mot qui déclenchera ce qui est écrit, qui scellera mon destin. Je le refuse. J’improvise une réponse pour que le mot ne soit pas dit, qu’il me reste une chance d’atteindre ma voiture, de ne pas finir en fait divers.
- Vous êtes de Montpellier ?
Ça le déstabilise. Le mot n’est pas sorti. Je sors de mon sac le paquet de cigarettes entamé avec Jacques, lui en tends une. Pas aux autres.
- Je fume pas.
Je range mon paquet, comme si ça ne se faisait pas, de s’en griller une devant un non-fumeur. Même si le non-fumeur est l’agresseur. Je l’ai énoncé, mentalement : l’agresseur. Ça devient réel, du coup, la situation. Plus de place pour Opening Night, les souvenirs d’il y a vingt ans, la douceur de la nuit, le bras de Jacques autour de mes épaules quand on avait quitté la salle de cinéma. Le passage qui nous ramenait à la rue Gambetta, à la vitre battue de quelques gouttes devant laquelle nous étions restés enlacés, une dizaine de minutes, à fixer l’affiche comme pour prolonger les impressions du film. Le même regard tout à l’heure quand j’ai quitté son appartement.
Quatre types, dont un à moins d’un mètre de moi ; des paroles menaçantes. La suite, je la connais. C’est comme si on me l’avait racontée, la scène que je vais vivre, exactement, l’absence d’issue. Pourtant, il n’y a pas de peur, juste le sprint de mon cerveau pour dénicher des phrases qui pourraient me sauver.
- Je viens de Besançon. J’ai deux filles.
Je cherche dans mon sac, mes mains ne tremblent pas. J’aurais eu les mêmes gestes pour une amie perdue de vue croisée à la sortie d’un hypermarché. La grande est mon portrait craché, du moins c’est que tout le monde prétend. Moi je suis incapable de trouver des ressemblances aux visages. Du porte-monnaie j’extrais les photos de Zoé et de Clara. Clara, mon portrait craché, paraît-il. Je tends les clichés en direction du type, bras replié. Ne pas le toucher, surtout ne pas le toucher.
Il chasse l’air devant les images, ne me touche pas non plus. Il n’est pas passé loin de ma main. S’il l’avait frôlée, la suite se serait enclenchée, la suite à laquelle je ne vais pas parvenir à échapper, ou peut-être que si, sûrement que si, j’ai l’espoir imbécile d’y échapper, pas pour retrouver la douceur de ma rêverie sur Jacques, ni même le souvenir de mes filles. Non, juste mes pas comme avant ; juste mes pas sans la menace d’inconnus, dans le milieu de la nuit montpelliéraine, la possibilité de me remémorer une soirée d’il y a vingt ans, l’attente dans la file d’un cinéma de province avant la découverte de ce qui deviendrait mon film préféré, la bouche de Jacques. Le lendemain la télévision tournait en boucle sur trois syllabes, Tchernobyl, mon père monologuait pour rassurer la famille, une exagération de journalistes, ça n’aura pas de conséquences pour nous. Je pensais aux baisers de Jacques. Des mots nouveaux survolaient la table : radioactivité, fission, réacteur, tandis que j’échouais à me rappeler la forme deson nez, les dimensions de son front, l’épaisseur de ses lèvres.
- Je m’en fous, de tes filles.
- Pas moi.
‘Pas moi’, j’ai dit. J’ai envie de pleurer tout à coup. Il faut congédier Zoé et Clara, ce soir je ne peux compter que sur moi. Parler, pour qu’il ne me traite pas de salope, ou de pute, pour que ne s’enclenche pas ce à quoi il aspire, ce que guettent ses trois comparses en arc-de-cercle. Parler comme mon père devant sa télévision pour conjurer une inquiétude confuse.
- Vasy, te laisse pas embrouiller.
Le meneur fait un geste, l’autre se tait. Il me regarde, je comprends que j’ai gagné, pas un muscle de mon visage ne l’indique, toute ma concentration monte à mes yeux, pour les vider de toute expression, ne pas les détourner de lui et dans le même temps lui dénier tout prétexte de conflit, d’étincelle.
- Pourquoi t’as parlé de tes gosses ?
Il sait aussi qu’il a perdu. Il gagne du temps, pour les trois autres, derrière. Je manque de hausser les épaules, la sueur me saisit le dos, la nuque, hausser les épaules, non, surtout pas
- L’aînée a dix ans. Zoé. La plus petite sept. Clara.
- T’as pas de mari ?
Il pourrait ajouter la phrase qui contiendrait le mot, celui qui déclencherait le scénario. Je me grise du risque de lui en laisser la possibilité. L’emballement que ça me procure, tout proche du sentiment que j’avais en sortant de chez Jacques.
L’âge réel de mes filles, je ne peux pas l’avouer. Dix ans et sept ans, c’est doux, ça se dépose comme un baume sur les violences prêtes à surgir. L’âge qu’elles ont sur les photos dans mon porte-monnaie.
Non, je réponds.
C’est lui qui hausse les épaules. Je me dis qu’il voit ce que ça fait. Ça ne m’apporte aucun sentiment de victoire, ni de vengeance.
- Tu devrais pas te balader toute seule, la nuit.
À nouveau, il me fixe dans les yeux. L’odeur de menthe passe, mêlée à celle des arbres sous lesquels on s’est arrêtés. Il y a les phares d’une voiture, à la perpendiculaire du boulevard, dans notre direction.
- On se casse.
- Mais…
- On se casse, j’ai dit.
Ils se cassent.
Je les laisse passer à côté de moi, les quatre, je ne me retourne pas, je ne frissonne pas quand ils me frôlent. Les phares de la voiture s’approchent, je compte qu’il leur faudra cinq secondes pour être à ma hauteur, j’enclenche le compte à rebours, un effort incroyable pour maîtriser chaque pore de mon visage. Le bruit du moteur efface les pas des types qui s’éloignent, ou se planquent derrière un mur pour revenir après le passage du véhicule.
Je ne cours pas.
Je ne lève pas la main quand la voiture me dépasse.
Je reste immobile, les yeux dardés sur le reste du chemin à parcourir jusqu’au parking. Deux cents mètres de trottoir, le boulevard à traverser, la première rue à gauche. Sept minutes.
J’attends. Il n’y a que ma main droite qui tremble, un tremblement incontrôlé. Je ne pourrais pas m’allumer de cigarette s’il m’en prenait l’envie.
Plus tard, quand ma main s’est calmée, je déplace ma jambe gauche. Je fais un pas. Mon corps se trouve à l’équilibre entre l’écart figé de mes pieds, une seconde, deux secondes, puis la jambe droite à son tour obéit, avance. Je marche. Est-il possible que je retrouve dans l’air des traces de l’odeur de menthe ? Ou est-ce l’écho du vent dans les feuilles ?
Je marche. Le ciel est sans nuage, les étoiles atténuées par le halo des lumières de la ville. Je parcours les deux cents mètres du boulevard. Le feu piéton est rouge, je m’engage quand même, je traverse. Je tourne à gauche. Encore cinq cents mètres, et je vois ma voiture. Je ne me suis pas retournée.
Je glisse la clef dans la serrure.
S’il m’avait suivie jusqu’ici… La sensation de sa paume contre ma nuque se fait si réelle que ma peau se contracte. Je pourrais vomir, m’évanouir, mais il n’y a rien, pas de peau étrangère contre ma peau, pas de caresse hostile, pas de couteau contre ma colonne. Je m’installe au volant, avant de démarrer je me permets une dose de larmes, quelques secondes, pas plus ; comme un dû à ce qui vient de se passer. De ne pas se passer. Je ne jette aucun coup d’œil par la vitre conducteur. S’ils m’ont suivie, ils peuvent me voir pleurer. De ça, je me vengerai. Plus tard. Pour l’instant, je leur échappe. Je leur ai échappé. Je verrouille la portière.
J’aurais la force de démarrer et de les écraser s’il leur plaisait de se presser contre l’habitacle.
L’idée surgit dans la nuit. Jusqu’à elle, il y avait eu les sensations attendues : les moindres replis des draps comme une contrainte intolérable, les frissons sous la peau, d’autres larmes, plus lentes ; l’insomnie, bien sûr.
Ai-je sacrifié mes filles pour sauver ma peau ?
J’ai un mouvement de repli dans le lit, comme si je voulais m’enfouir d’avoir pensé ça, m’enfuir de moi, de cette ville où je n’aurais pas dû revenir traquer mon amour de jeunesse. L’idée n’a fait que passer, pourtant je sais qu’elle reviendra, que je l’envisagerai comme une hypothèse. Même s’il ne le faut pas. S’il ne le faut absolument pas.
Je me lève, extrais du porte-monnaie la photo de mes filles. Je les fixe, incapable d’être émue par l’image qu’elles me renvoient. Ce pourraient être n’importe quels enfants.
Je pose la photo sur la table de chevet, éteins la lumière.
Demain, je devrai dresser un portrait robot, et j’en suis incapable. Les visages n’impriment pas dans ma mémoire, je n’en retiens pas les caractéristiques. Pour ma mère, cette incapacité provient de ce que je ne sais pas prêter attention à autrui. Elle l’a dit à une de ses amies, un jour que je pouvais l’entendre. Comme son père.
J’essaie de me concentrer sur les traits du type, mais rien ne vient, à part sa démarche, sa manière de reculer la tête quand j’ai tendu vers lui la photo de mes filles, la densité de son regard.
Qu’est-ce qu’ils vous ont fait ?
Qu’est-ce qu’ils m’ont fait ? Des mises en garde, des propos vagues. Connasse, c’est vrai, mais est-ce qu’on porte plainte parce qu’on s’est fait traiter de connasse ? Une expression du Sud, qu’on balance à la fin de toutes les phrases, une ponctuation sonore. Où est la menace ? Je me figure l’expression du flic, les doigts suspendus au-dessus de sa machine, attendant que ça commence. Que commence ce qui justifierait qu’il tape ma déposition sur sa feuille vierge.
C’est tout ?
Je tends le bras pour atteindre l’interrupteur, mes doigts ne reconnaissent pas la géographie de la table de chevet, renversent une tasse qui claque au sol, ne semble pas s’être brisée. Pendant la chute, j’ai senti le contact du sachet de tisane contre le dos de ma main, le sachet encore chaud qui m’a brûlée. J’allume, ça n’a qu’à peine l’effet escompté, ça n’estompe rien, ma respiration ne s’allège pas. La photo se gondole, déforme les traits de mes filles.
Au moins, la tasse est intacte au sol. Je la ramasse. Les projections des restes du liquide tracent sur la moquette une forme sans signification qui dans un film aurait fait l’objet d’un plan fixe, sans musique. Ou peut-être que non. Je n’ai aucun talent pour imaginer ce qui dans ma vie vaudrait la peine d’être filmé, mis en valeur, zoomé.
Et vous pouvez nous le décrire ?
Non.
Je ne peux pas.
Je n’ai pas le courage de me lever pour essuyer les taches, demain elles se seront incrustées dans la moquette, elles attesteront de la longueur de cette nuit.
Pour cette raison je me lève ; pour qu’il n’y ait pas de traces de cette nuit sur la moquette. Je passe devant le miroir, m’immobilise. Caleçon, tee-shirt informe, des jambes qui m’ont valu les compliments d’anciens amants. Jacques aussi aimait mes jambes, le premier à les avoir caressées, la semaine où le nuage de Tchernobyl s’approchait de la France.
Est-ce que le scénario aurait été différent si je n’avais pas interposé les images de mes filles entre les types et moi ?
Ont-elles senti, dans leur lit à Besançon où sans doute elles dormaient à l’instant où je me servais d’elles, la trahison de la mère ? L’une des deux, plutôt Clara qui me ressemble et me devine toujours, s’est-elle réveillée en hurlant comme prise par un cauchemar ?
À quatre pattes, pour essuyer les traces au sol, pour ramasser le sachet de tisane. Ma posture a quelque chose d’indécent. Je contracte mes fesses, mon entrejambe, la honte monte. Je m’assieds. Le souffle coupé. J’ai entendu le mot, dans ma chambre, avec l’exacte intonation du type, le meneur.
Salope.
Sa voix, je la reconnais. Pourtant demain je serai incapable de la décrire aux policiers, d’en traduire les sonorités par des mots. Ils pourraient avoir à mon corps défendant des connotations racistes, ces mots. Je ne veux pas de la complicité frontiste des types qui m’écouteront.
Pourtant il suffirait que je laisse planer un doute sur l’origine des agresseurs pour qu’ils me prennent au sérieux.
Ce serait pire.
Salope, ils auraient eu raison de le dire.
Je me force à aller jusqu’au miroir. Des cernes sous les yeux. Les sclères rougies d’avoir chialé.
Encore belle. Séduisante.
J’en ai eu la confirmation dans les regards de Jacques.
Je continue de plaire aux bourgeois blancs qui ont raté leur vie sentimentale, qui sont disposés à accueillir sans questions ni conditions le retour de leur premier amour. Des types bien conservés qui vivent dans des appartements luxueux avec vue sur la ville, quartier tranquille, cinquante mètres carrés de terrasse, bacs rouge sang à chaque angle avec quatre variétés de palmiers ; des ingénieurs en biologie qui servent du Pouilly-Fuissé dans des verres disproportionnés et un limoncello aux citrons AOC de la côte amalfitaine en digestif. Qui n’ont pas un mot de trop pour tenter de retenir la femme qui dit qu’elle va rentrer à son hôtel, alors que toutes ses attitudes montraient qu’elle était venue pour passer la nuit.
Les types ont-ils senti dans mon haleine les marqueurs de l’alcool ? Leur ai-je semblé, pour cette raison, impure ? Impropre à assouvir leurs pulsions ? Est-ce que ce serait pire, si le type m’avait épargnée à cause de ma consommation de limoncello ? Qu’il ait ricané, plus tard, avec ses potes, la gueule de la vieille avec son coup dans le nez ? Et la photo de ses filles qu’elle nous a montrée ?
Je pourrais appeler Jacques, le réveiller, lui demander si j’avais l’air saoul quand je l’ai quitté.
Je n’ai pas pensé à l’appeler, jusqu’à cette minute. Ni à retourner chez lui.
Je tire la peau de mon visage, devant la glace. Que reste-t-il de la femme qui lui a plu, vingt ans plus tôt ? M’a-t-il seulement reconnue ? Aucun grand cru ne pourra remédier à la disparition de celle que j’ai été pendant le printemps de Tchernobyl, aucun sourire sur la terrasse, aucune attirance des corps. Je retourne sous les draps, ils sont froids, la présence de Jacques n’y aurait rien changé.
J’essaie de me le représenter à mes côtés, dans cette chambre d’hôtel. Ce serait plus intolérable encore que de ne partager mon angoisse avec personne. Il aurait des mots manqués pour me consoler, des mensonges sur l’héroïsme dont il aurait été capable, s’il avait été là.
Pourtant, s’il avait été là, je n’aurais pas sorti la photo de mes filles pour l’interposer entre l’agresseur et moi.
Je m’éveille d’un cauchemar où la voix du meneur ricanait. Il ne t’est rien arrivé. C’est comme ça que je le désigne, au moment du réveil affolé : le meneur.
Le mot m’exaspère, il renvoie à des soumissions de cour d’école aux dictats des caïds.
J’écarte les rideaux, lève les volets roulants avec l’espoir que l’air de la nuit m’aidera, l’air vierge des pollutions de la chambre ; avec l’espoir que l’accomplissement d’un geste, quel qu’il soit, écarter les rideaux, ouvrir la fenêtre, m’apportera un soulagement.
Dès que je pose la main contre le tissu rêche, je comprends que ce sera inutile. Pourtant le geste se poursuit de lui-même.
Il y a devant moi le rectangle frais de la nuit, l’angle supérieur droit mordu par une avancée du toit, et à la verticale, la lune. Je ne l’avais pas remarquée si pleine, en sortant de chez Jacques. Peut-être est-ce elle qui a éveillé les instincts belliqueux des types, poussé le meneur à m’insulter ?
Connasse.
Je me retourne. Dans la chambre, il n’y a personne. Pourtant, la voix a résonné.
Dans la chambre, il n’y a personne, la forme blanche de la couette mal rabattue sur le lit dans l’angle supérieur droit, comme un écho au paysage dévoilé par la fenêtre, démasque l’endroit où ma tête a cherché le sommeil, ne l’a trouvé que pour y puiser une errance russe, pas même une consolation.
J’avance jusqu’à la porte, fais jouer la poignée. Fermée. Je vérifie qu’il n’y a personne dans la salle de bain, derrière le rideau de douche, aucune crainte du ridicule. Aucun sentiment de sécurité supérieure, après. Connasse. Le mot a résonné dans la pièce, investi les lieux, il cogne à mon crâne. Des deux mains j’étire la peau de mes joues, enfonce les doigts sous les os zygomatiques, me déforme. Le reflet du miroir me renvoie une image qui n’est ni plus ni moins moi qu’avant cette déformation.
Je retourne à la fenêtre. Il me semble qu’à la surface de la lune aussi il y a une ablation, une morsure pareille à celle du ciel et de mon lit. J’aurais dû m’arracher un morceau de peau pour m’intégrer au dérèglement du monde.
J’essaie de me reprendre, de ne pas perdre pied. La lune n’a pas pu s’effacer, même en partie. Je la fixe. Pourtant, c’est indéniable, une zone d’ombre la grignote. Si une éclipse avait été annoncée, Jacques m’en aurait parlé. Il m’aurait retenue jusqu’à son avènement, en aurait profité pour m’enlacer sur son balcon, comme il l’avait fait vingt ans plus tôt à la sortie du Plazza. À l’angle de sa rue, cinq cents mètres plus bas, quatre types seraient passés à minuit, n’auraient croisé personne, le meneur n’aurait lancé son connasse à la gueule d’aucune femme, ni sous-entendu qu’il n’était pas prudent de marcher seule, la nuit, lorsque l’on est une femme de mon âge.
Un papillon de nuit vient battre la fenêtre à côté de moi. Il repart, hésitant, blessé ? Ses ailes bruyantes se dispersent dans l’obscurité, bientôt il ne sera plus visible. Il disparaît dans la masse du bâtiment d’en face ; je remarque un type à sa fenêtre, qui traque la lune avec une longue-vue. Il ne m’a pas repérée, je suis soulagée de ne pas avoir allumé la lumière. En détaillant mieux la façade, je me rends compte qu’une fenêtre sur trois est ouverte, peuplée de silhouettes orientées dans la même direction. C’est leur présence qui a causé mon malaise, même si je ne m’en étais pas rendu compte. Je bats en retraite, je ne supporterais pas que l’un deux me dévisage, me hèle, me sourie.
L’écran de mon portable découpe un carré phosphorescent dans la nuit de la chambre, les deux notes d’accueil familières ont ce soir une tonalité différente… De l’extérieur, pour ceux d’en face, ma fenêtre s’est colorée d’une lumière bleutée, les plus curieux peuvent deviner qu’un client a allumé son ordinateur, ou la télévision. Ils ne savent pas que c’est moi. Ils ne peuvent plus me voir.
Il est trop tôt pour appeler mes filles.
Mon téléphone me confirme qu’il y a bien, cette nuit, une éclipse de lune. Je lis l’intégralité de l’article, sans en comprendre un mot.
J’ai envie de m’avancer vers la fenêtre, de contempler le spectacle comme les autres, mais il y a les troncs anonymes qui dépassent des fenêtres, les bras qui se tendent, des couples enlacés qui seront sans doute séparés à la prochaine occurrence du phénomène (dans combien d’années ? je l’ai lu il y a moins d’une minute, impossible de m’en souvenir) qui feignent de ne pas s’en douter. Jacques avait peut-être prévu d’évoquer le sujet, si je n’étais pas partie si vite, de me réserver la surprise à l’occasion d’un passage sur sa terrasse. Il faudra que je lui demande, demain.
Ou ce soir ? Il aurait été normal que je l’appelle en arrivant à l’hôtel. Mais maintenant ? En pleine nuit ? Répondrait-il ?
J’éteins le téléphone, m’approche de la fenêtre en longeant le mur, clandestine. Entre le rideau et la vitre, un interstice de quelques millimètres offre à mon regard une bande verticale d’appartements. Huit étages. Sur chacun d’eux, quatre fenêtres entrent dans mon champ de vision, une cinquième se floute sous les mouvements imperceptibles du tissu. Je recense seize fenêtres allumées, vingt-trois silhouettes tournées vers la lune. Sept couples, dont quatre enlacés. Ils ne bougent pas, neuf braises de cigarettes par intermittence s’embrasent, composent sur la façade de l’immeuble des dialogues clignotants, des communications aux règles inaccessibles. Ils n’ont pas conscience d’être si nombreux, encore moins d’être observés. Aucun d’eux n’a eu à subir plus tôt dans la soirée les menaces d’inconnus rencontrés dans la rue, ils se sont endormis le réveil réglé sur l’horaire de l’éclipse, ou ont veillé jusqu’à l’effacement programmé de la lune. Maintenant, ils regardent, se demandent s’ils seront encore vivants quand le phénomène se reproduira. Bientôt ils retourneront se coucher, s’endormiront ou feront l’amour ; je resterai cachée à fixer les ouvertures sans vie de leur immeuble.
Tout à coup, au sommet de l’interstice entre la fenêtre et le rideau, une clarté, puis la lune. Je la laisse pénétrer tout entière dans le rectangle effilé de mon champ de vision, ça dure, je ne suis pas pressée. Lorsqu’elle disparaît, l’ombre de l’éclipse l’a presque abandonnée.
Les coups contre la porte me font bondir. La poignée s’abaisse trois fois, trois mouvements de métronome, déshumanisés. Il y a une clef glissée dans la serrure, qui fait sourdre dans mon dos une terreur instantanée. Je hurle.
Le visage de la femme de chambre répercute ma terreur, elle se jette en arrière en hurlant elle aussi des excuses, ou des insultes, claque la porte. Ses pas décroissent dans le couloir, saccadés, comme si j’en avais brisé la mécanique. Je devine son cœur battre aussi vite que le mien, sa haine des clientes qui ne quittent pas leur chambre à l’heure du nettoyage. Si elle s’était fait harceler par quatre inconnus, elle n’en serait pas sortie indemne.
11h04.
J’ai dormi.
La chaleur s’engouffre dans la chambre par la fenêtre restée ouverte, se déploie sur la blancheur de la couette, la nudité des murs, le vide de la journée qui m’attend. Je n’ai pas envie d’aller à la plage, pas envie de contacter Jacques à midi comme je lui ai promis. Peur d’entendre la voix de mes filles, qu’elles perçoivent dans la mienne ce qui m’est arrivé hier, le rôle que je leur ai fait jouer, dont je dois les préserver.
Je me douche. M’habille. La femme de chambre, à nouveau, frappe à ma porte. Je lui ouvre, m’excuse, nous ne sourions pas de notre double terreur, ne sympathisons pas, notre conversation n’a pas de consistance, nos mots ne nous servent à rien.
Je marche dans les rues. Je reconnais les abords de la gare, pénètre dans le hall, circule parmi les passagers, me laisse porter par les escalators. Des quais, des destinations, des annonces au micro. Je m’installe à la table d’un bistro sous un couloir couvert, commande un café que je bois en regardant défiler les inconnus qui traînent leurs valises, transpirent, sortent des trains heureux de trouver l’été, le soleil, les promesses des vacances. Trois heures s’enchaînent sans que je bouge de mon tabouret.
Mon téléphone sonne, je ne réponds pas, le poids des gestes à accomplir pour décrocher, me lever, commander un autre café, s’avère insurmontable. Plus tard, je marche dans Montpellier. Les intersections des rues sont emplies d’autochtones, de touristes, d’individus dont la présence interdit aux meneurs de se mettre en travers du chemin des femmes, de les traiter de connasse et de disparaître. Je marche, mes pas ne permettent pas de me réapproprier ma liberté, de me reconstituer une insouciance.
Je pourrais tomber sur eux, dans la clarté du soleil d’août. Sentir dans l’air l’haleine mentholée du meneur. Depuis hier, je n’ai pas pensé qu’ils ont continué à exister après mon agression. Je les ai figés dans la centaine de secondes de notre confrontation, de l’instant où j’ai entendu leurs voix à celui où leurs pas se sont éteints dans mon dos.
Je ne peux plus avancer. Des corps me bousculent, je devine des commentaires, accepte les colères que mon immobilité fait éclore. Ils existent, les trois restés groupés à l’arrière du meneur. Il existe, lui à qui j’ai parlé de mes filles. Dans son doigt qui s’est pointé vers moi, le sang circule. Ils existent et je serais incapable de les identifier s’ils se matérialisaient devant moi.
Il y a un commissariat, à quelques mètres de moi. Mes pieds refusent de m’y porter, au contraire ils m’en éloignent. Je n’ai jamais eu cette sensation d’être emportée sans savoir où j’allais, de ne plus me conduire. Je suis accélérée, je me précipite dans les rues de Montpellier, c’est moi qui heurte des inconnus, bouscule des types qui téléphonent, qui sont peut-être mes agresseurs d’hier. Je reconnais la terrasse d’un restaurant où j’ai dîné avec Jacques, en 1986, une boutique de vêtements où je me suis arrêtée avec mes filles une quinzaine d’années plus tard. Une guêpe se cogne contre ma lèvre, bourdonne en s’éloignant, je suis la trajectoire incurvée de son vol, porte une main à ma bouche. Elle ne m’a pas piquée.
Je regagne mon hôtel. L’écran de mon portable affiche neuf appels en absence, six de Jacques, trois de Clara. Aucun message. Les fenêtres de l’immeuble d’en face sont toutes fermées, volets, stores, rideaux, pour refouler à l’extérieur la chaleur de la fin de journée. Impossible de croire que la nuit dernière des couples s’y accoudaient, des silhouettes s’y massaient pour scruter la disparition de la lune. Impossible que les nuits se succèdent désormais.
Je m’allonge, habillée, sur le lit. Des étages supérieurs de l’immeuble, on peut me voir. Une femme entre deux âges, encore séduisante. Un pervers pourrait se branler en me regardant. Formuler mentalement que je suis bien conservée.
Je pense à me lever pour tirer les rideaux, renonce.
Jusqu’à minuit, je résiste à l’endormissement pour contenir cette journée, l’étirer jusqu’à l’absurde, les yeux fixés sur mon réveil. Aux dernières secondes avant minuit, une panique, puis minuit, et rien.
Arnaud Friedmann présente La femme d’après
- Nos autrices et auteurs au Festival des littératures policières noires et sociales Le 17 mai 2025
Serena Gentilhomme, Jean-Hugues Oppel et Arnaud Friedmann seront au Festival des littératures policières noires et sociales de Besançon les 17 et 18 mai.
Actualités- Arnaud Friedmann dans la sélection 2024 du prix Marcel-Aymé
Nous sommes ravis d’annoncer qu’Arnaud Friedmann et son Invention d’un père font partie de la sélection 2024 du prix littéraire Marcel-Aymé, décerné par l’Association du livre et des auteurs comtois pour récompenser un ouvrage en rapport avec la Franche-Comté.
Documents à téléchargerDocuments à télécharger
- Arnaud Friedmann dans la sélection 2024 du prix Marcel-Aymé

Crédits
© 2025 la manufacture de livres. Tous droits réservés.
Le site est entièrement réalisé à la main par Cédric Scandella
Les textes sont tous écrits par l'équipe de la Manufacture de Livres
Mentions légales
https://www.lamanufacturedelivres.com/SL Publications
Représentant légal et directeur de la publication : Pierre Fourniaud
101 rue de Sèvres
75006 Paris
33 1 45 66 90 08
Siren : 505 303 065 RCS paris
Siret : 505 303 065 000 13
VAT FR94505303065
SARL au capital de 10 000 euros créée le 8 juillet 2008
Droits d’auteur et de propriété intellectuelle
Tous les contenus de ce site Internet textes, photographies, illustrations, etc. sont protégés par les lois françaises et internationales du droit d’auteur. Toute reproduction de ces contenus est interdite hors utilisation promotionnelle et médiatique des visuels de couvertures, photos d’auteur et visuels des éléments promotionnels à télécharger (mention du copyright obligatoire).
Hébergeur du site
Scaleway
Liens hypertextes
La Manufacture de livres décline toute responsabilité quant au contenu des informations ou services fournis sur les sites activés par les liens hypertextes et quant aux difficultés que l’internaute pourrait rencontrer pour y accéder.
Loi Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à La Manufacture de livres. L’éditeur s’engage à ne pas transmettre à des tiers les données personnelles que vous lui communiquez via le site Internet, qui seront utilisées uniquement afin de communiquer avec vous suite à votre demande.
Google Analytics
Ce site n’utilise pas Google Analytics. Point barre.
Données personnelles
Nos engagements
Vos données sont utilisées uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées en lien avec notre activité,
Seules les données qui nous sont utiles sont collectées.
Nous ne conservons pas vos données au-delà de la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées, ou de celles prévues par les normes et autorisations de la CNIL ou par la loi (prescriptions légales).
La Manufacture de livres s’engage par ailleurs à respecter et défendre la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité.
Utilisation de vos données
Les informations et données personnelles sont recueillies de manière sécurisée et cryptée pour les finalités suivantes :
- envoi de newsletter
- échange dans le cadre de la relation commerciale
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée réglementaire :
- Prospection : 3 ans à compter de leur collecte.
- Gestion commerciale/fichier client : Le temps nécessaire pour la gestion commerciale.
- Gestion de prospection/fichier client : 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale.
Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée par une disposition légale ou réglementaire. Vous pouvez exercer, dans les conditions prévues ci-après, lun des droits qui vous sont reconnus par la législation.
Vos droits
Droit daccès et de rectification
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit :
- d’accès,
- de rectification,
- de portabilité et d’effacement des données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant La Manufacture de livres - 101 rue de Sèvres - 75006 Paris
Le responsable de traitement des informations personnelles est lamanufacturedelivres.com contact@lamanufacturedelivres.com
Vous êtes encore là ?


