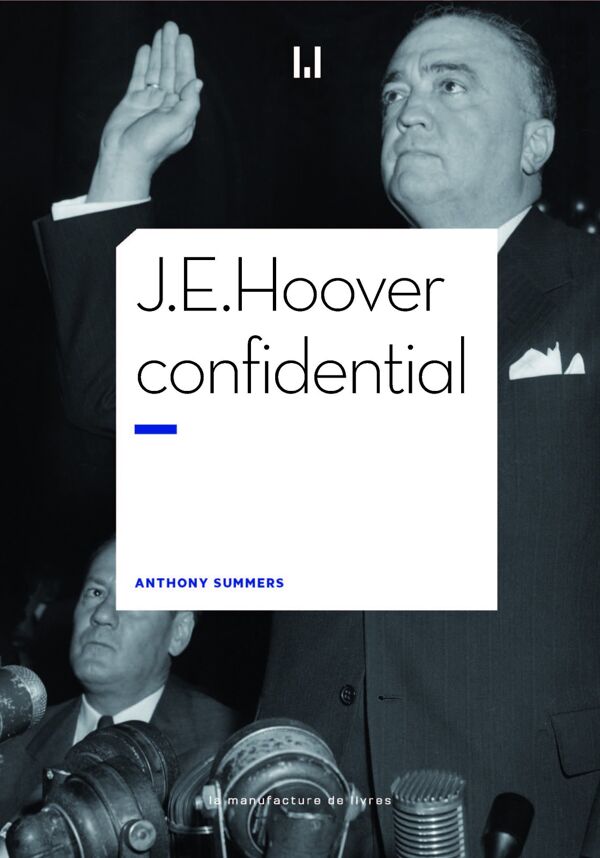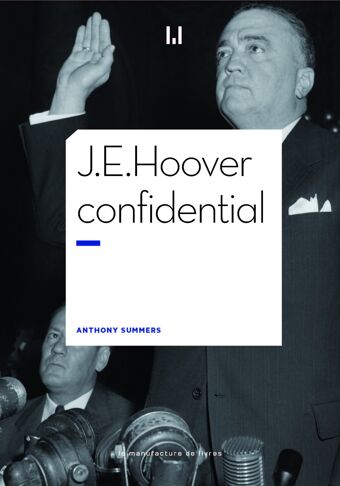
Anthony Summers
J.E. Hoover Confidential
Puritain conservateur, acharné de la chasse aux « Rouges », raciste décomplexé, antisémite, J.E. Hoover sera le patron du FBI de 1924 à 1972. La montée de la criminalité pendant la crise de 29 fera sa légende. Il transformera peu à peu le FBI en police politique archivant, grâce aux progrès de la technologie, les écoutes, données privées et empreintes digitales de quelque 159 millions d’individus. Il a traqué toutes les « sorcières » possibles et imaginables, privilégiant les cibles en vue et ne négligeant aucun recoin de leur vie privée. Craint de huit présidents qui essayeront de le démettre ou de l’éloigner, Hoover se passionnait pour les déviances idéologiques ou intimes, mais il combattait fort peu le crime organisé. Ce puritain conservateur cachait un homosexuel honteux. À sa mort, les dossiers de l’homme qui avait passé sa vie à espionner l’Amérique ont disparu. Pouvait naître la légende de ce personnage digne des romans de James Ellroy et qui a été incarné à l’écran par Leonardo Di Caprio.
- téléchargez l’extrait
Prologue : le mythe
8 octobre 1971, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.
Le président des États-Unis, son ministre de la Justice et ses principaux conseillers débattent d’un problème complexe concernant un vieil homme, dont le chef d’État a peur :
RICHARD NIXON : Pour un tas de raisons, il faut qu’il démissionne… Il doit foutre le camp d’ici… Peut-être que… mais j’en doute… peut-être que si je l’appelle et lui dis de démissionner… Ça pose des problèmes… S’il s’en va, il faut que ce soit de sa propre volonté… C’est pour ça qu’on est dans la merde… Je pense qu’il va rester jusqu’à ce qu’il soit centenaire.
JOHN MITCHELL : Il va rester jusqu’à ce qu’on l’enterre ici. L’immortalité…
RICHARD NIXON : Je crois que nous devons éviter qu’il s’en aille sur un éclat… Nous avons sur les bras un homme qui peut faire écrouler le temple avec lui… y compris moi… Ça va être un problème.
Sept mois plus tard, le 2 mai 1972, le « problème » du président est résolu avec le décès de J. Edgar Hoover, directeur du FBI, mort en service à l’âge de soixante-dix-sept ans.
Le gardien aurait trouvé le corps étendu à côté du lit à colonnes de sa maison de Washington : à première vue, il s’agissait d’une simple attaque cardiaque survenue pendant la nuit. On ne fit pas d’autopsie.
Cependant, dans la capitale fédérale, quelqu’un de puissant se sentait menacé par Hoover, même mort. Lorsque les employés des pompes funèbres arrivèrent sur les lieux pour emporter le corps, un spectacle extraordinaire les attendait. En haut des marches, un vieil homme assis dans un fauteuil regardait dans le vide. Tout autour de lui des jeunes gens allaient et venaient, sortaient et entraient dans les pièces, se livrant à de mystérieuses occupations. Quatre heures à peine après la découverte du cadavre, ces individus fouillaient la maison de fond en comble. Ils pillaient les tiroirs, enlevaient un à un les livres des étagères, les feuilletaient puis se les passaient. Le vieil homme dans son fauteuil, le plus proche ami du défunt – son amant, disaient certains – semblait inconscient de ce remue-ménage.
Le lendemain, le corps de J. Edgar Hoover fut transporté en grande pompe au Capitole et placé sur le catafalque noir qui avait servi dans le passé pour Abraham Lincoln et huit autres présidents. A l’intérieur, les citoyens défilèrent pour présenter leurs derniers hommages, au rythme d’un millier par heure. A l’extérieur, quelques centaines de manifestants scandaient la « litanie de guerre » : la liste des noms des 48 000 Américains tués au Viêt-nam. Mêlés à la foule, dix hommes de Nixon étaient chargés de provoquer des incidents pour dissoudre le rassemblement. Parmi eux se trouvaient des exilés cubains impliqués dans de précédents rassemblements et qui devaient bientôt être pris en flagrant délit dans l’affaire du Watergate. Tandis qu’ils attendaient ce soir-là à quelques mètres du Capitole où il reposait, deux d’entre eux parlèrent du défunt. L’un d’eux étonna son camarade. Selon lui, la maison de Hoover avait été la cible d’un récent cambriolage à l’instigation de la Maison-Blanche. Puis il se tut. En dire plus, avoua-t-il, aurait été « dangereux ».
La veille, dans le bureau ovale, le président Nixon aurait accueilli la nouvelle de la mort de Hoover par un long silence, puis il aurait dit : « Nom de Dieu ! Ce vieil enculé ! » Un de ses assistants se souvient qu’à l’exception de cette exclamation le président n’avait fait preuve d’aucune émotion.
Officiellement, Nixon honora la dépouille de Hoover comme celle d’un héros américain. Il ordonna que les honneurs lui soient rendus au Capitole, une distinction dont n’avait jamais bénéficié jusque-là un fonctionnaire civil. Il fit son éloge : « Un des géants… un symbole national de courage, de patriotisme, d’une honnêteté et d’une intégrité à toute épreuve. »
Pour des millions d’Américains, Hoover était effectivement un héros. Au cours des années vingt, il avait créé le FBI, pour en faire une brillante organisation. Il était ainsi devenu le « flic numéro 1 », le pourfendeur des bandits du Midwest, Dillinger, Kelly la Mitraillette et bien d’autres. Plus tard, Hoover était devenu bien plus que le premier des justiciers. Chargé par le président Roosevelt de protéger la sécurité interne des États-Unis, il s’était dressé en champion de la nation contre ses adversaires les plus insidieux : d’abord les nazis, puis ses ennemis personnels, les communistes, ainsi que tous ceux qui osaient exprimer leur désaccord politique.
Une campagne de publicité ininterrompue avait fait de Hoover une icône vivante comblée d’honneurs. Le président Truman lui avait accordé la médaille du Mérite pour « services exceptionnels ». Le président Eisenhower l’avait choisi comme premier titulaire de la Distinction civile fédérale. Son nom était devenu synonyme de la sécurité de la nation, des valeurs fondamentales de la société américaine, et aussi (mais peu se seraient risqués à le reconnaître ouvertement)… de la peur. Comme la plupart des huit présidents qu’avait servis Hoover, Richard Nixon avait éprouvé cette crainte. Ses relations avec le directeur du FBI étaient anciennes. En effet, lorsqu’il n’était qu’un jeune homme dégingandé, il avait posé en vain sa candidature auprès des services de Hoover. Il s’était alors lancé dans la politique et, lorsqu’il avait été élu membre du Congrès, il s’était engagé avec succès dans la croisade contre la gauche que Hoover avait largement inspirée. Il avait gagné ses faveurs et son aide, et avait souvent dîné avec lui dans ses restaurants favoris. Nixon et le vieil homme avaient les mêmes ennemis, partageaient les mêmes secrets et la même avidité du pouvoir. Quand finalement le plus jeune des deux avait accédé à la présidence, cette fonction suprême à laquelle Hoover avait lui-même aspiré, les deux hommes semblaient être des alliés naturels.
Mais le président Nixon aussi était entré en conflit avec Hoover. Le temps passant, le vieux directeur était devenu impossible à vivre. Il avait coupé tout lien avec les autres organismes de renseignements. Plus pour se protéger lui-même que par principe, il avait saboté le plan de lutte du président contre les militants de gauche. Il avait exaspéré Nixon en freinant l’enquête sur Daniel Ellsberg, qui avait détourné des documents confidentiels du Pentagone sur la guerre du Viêt-nam et les avaient communiqués au New York Times pour être publiés. Son comportement capricieux était devenu une gêne pour le gouvernement. Mais, en dépit de tout, Richard Nixon n’avait jamais osé le révoquer. Il avait cependant essayé à plusieurs reprises. A l’automne de 1971, on crut que le sort de Hoover allait être réglé. Il n’en fut rien. Bien que Nixon n’eût jamais voulu l’admettre, le vieil homme détenait l’arme la plus sûre : le renseignement.
Les archives de la Maison-Blanche récemment divulguées montrent que le président et ses collaborateurs étaient inquiets des dégâts que Hoover était susceptible de faire. A l’instigation de Nixon, ils se mirent fébrilement en quête des documents prouvant que le président avait donné l’ordre de placer certains journalistes sur écoute. Mais ce n’est pas tout. Il semble que Hoover ait été informé de quelques délits de la Maison-Blanche avant l’affaire du Watergate. Il aurait eu également des informations personnelles sur Nixon et sur un éventuel scandale impliquant une femme.
Nixon n’était pas le seul dont le directeur du FBI connaissait les péchés secrets. Lorsque Hoover mourut, ce fut la panique générale à la pensée des informations que pouvait receler son bureau. Le directeur de cabinet de la Maison-Blanche griffonna une note sèche : « … Trouvez ce qu’il y a, de qui cela dépend et quels sont les cadavres. »
Au Congrès, de nombreux sénateurs et représentants vivaient dans la terreur des dossiers que Hoover détenait sur eux. Maintenant que la loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act) est en vigueur, on se rend compte que leurs craintes étaient justifiées. De nouveaux documents prouvent que les agents du FBI faisaient régulièrement des rapports détaillés sur la vie sexuelle des hommes politiques, qu’ils fussent hétérosexuels ou homosexuels. Un témoignage indique qu’un sénateur célèbre eut si peur en prenant connaissance de son dossier au FBI qu’il en fut réduit à l’inaction.
Un des plus proches collègues de Hoover, William Sullivan, le décrivit après sa mort comme un « maître chanteur ». Mais ce n’est qu’un des aspects de l’individu. On sait maintenant que cet homme tout-puissant souffrait d’un trouble secret. Après une enfance pénible auprès d’un père malade mental et d’une mère dominatrice, sa vie d’adulte avait été gâchée par des problèmes émotionnels et un profond désarroi sexuel. L’homme qui pendant des années avait prêché la rectitude morale à l’Amérique avait des relations homosexuelles, allant jusqu’à se déguiser en travesti.
Hoover lui-même ne cessait d’alerter l’opinion sur les homosexuels, plus vulnérables au chantage, et donc les cibles préférées des services de renseignements ennemis, en particulier de sa bête noire : l’Union soviétique. Le directeur du FBI était si tourmenté par sa propre faille secrète qu’il avait consulté un psychiatre de Washington.
Et si le maître chanteur avait été lui aussi victime d’un chantage ? Nombreux sont ceux qui s’étonnent que Hoover se soit si longtemps abstenu de traquer l’organisation criminelle la plus insidieuse de toutes : la Mafia ! Plusieurs de ses membres affirment maintenant que Hoover n’était pas une menace pour elle. Entre lui et les caïds, il y avait un « arrangement ». Dès le début de sa carrière, Hoover avait été piégé par son homosexualité. Le gangster Meyer Lansky, expert dans l’utilisation d’informations pour manipuler les personnalités influentes, aurait disposé contre lui de preuves compromettantes, probablement des photos. En tout cas, jusqu’à ce que les frères Kennedy s’attaquent au crime organisé, Lansky se vantait en privé d’avoir Hoover « dans sa poche ». Il est maintenant évident que, derrière son masque public de moraliste puritain, ce héros américain était un être corrompu. Il vivait comme un potentat oriental et puisait dans la caisse du FBI pour son profit personnel. Pour être à l’abri d’enquêtes judiciaires, des hommes riches s’attiraient ses faveurs et son amitié grâce à leurs largesses et leur hospitalité… et en lui communiquant des tuyaux judicieux pour jouer à la Bourse.
La répression par le FBI des militants des droits civiques et des libéraux était le révélateur de la haine venimeuse que leur portait Hoover. Sa rage contre l’attribution du prix Nobel de la paix à Martin Luther King fut d’autant plus grande qu’il estimait le mériter lui-même. Un public averti aurait dû comprendre à l’époque que son image était trop belle pour être vraie. Mais il n’en fut rien, surtout à cause de la pusillanimité de la presse. Un téléspectateur écrivit à la chaîne NBC peu de temps avant la mort du grand homme : « Si nous n’avions pas Mr Hoover et le FBI, je ne sais comment vous et moi pourrions exister. » La plupart des citoyens pensaient de même. Quelques-uns cependant étaient d’un autre avis. Pour le romancier Norman Mailer, le FBI était le « temple de la médiocrité ».
Le Dr Benjamin Spock déclara en apprenant la mort de Hoover : « C’est un soulagement que soit réduit au silence cet homme qui n’avait rien compris à la philosophie profonde de notre gouvernement ou des droits de l’homme, un individu qui disposait d’un pouvoir aussi considérable qu’il utilisait pour harceler ceux qui n’étaient pas de la même opinion politique que lui et qui a intimidé des millions d’Américains en les privant de leur droit de juger par eux-mêmes de la valeur des diverses tendances politiques. »
Qu’un homme au psychisme si instable et capable du pire soit devenu le symbole du Bien est un des paradoxes de notre temps. Dans un hommage rendu après sa mort, un membre de la Cour suprême déclara que Hoover avait été « l’incarnation du rêve américain ». En revanche, des psychiatres de renom considèrent qu’il aurait été parfaitement à sa place à un poste élevé dans l’Allemagne nazie !
De telles contradictions méritent que l’on remonte le cours de notre siècle, cette période de tromperies et d’illusions sur nos valeurs, nos libertés et nos héros. Si la vie de Hoover s’est déroulée pendant que le rêve américain était aussi dangereusement mensonger, comprendre l’homme peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes.
Pour lui donner la dimension d’un mortel, nous appellerons souvent J. Edgar Hoover – l’enfant et l’adulte – « Edgar » dans cet ouvrage.
L’histoire d’« Edgar » commence par une froide matinée de Nouvel An, il y a près de cent ans…
1
Dans le giron de sa mère
« Le dimanche 1er janvier 1895 , à 7 h 30 du matin, est né J. Edgar Hoover de mon père et de ma mère. Le temps était froid et neigeux mais clair. Le docteur s’appelait Mallan. Je suis né au 413 Seward Square, Washington DC… »
Dès son enfance, celui qui devait devenir le policier le plus célèbre du monde a tenu à jour son propre dossier. L’annonce de sa naissance remplit une page entière d’un carnet relié en cuir portant l’inscription d’une écriture enfantine : « Mr Edgar Hoover. Personnel. » Il se trouve maintenant dans un fouillis de mémoires, papiers et photos jaunis, conservés à la Maison du Temple, siège du Conseil suprême des francs-maçons de Washington. Il nous ramène dans l’univers du XIXe siècle.
Edgar est né alors que la Guerre civile était encore présente dans les souvenirs et que l’assassinat d’Abraham Lincoln n’était pas plus loin dans les mémoires que l’est dans la nôtre la mort du président Kennedy. L’Union que Lincoln avait mise en place ne comportait que quarante-cinq États. En 1895, on parlait de guerre avec l’Angleterre à propos des territoires d’Amérique latine. Bientôt ce serait le conflit avec l’Espagne, qui aboutirait à la conquête des Philippines par les États-Unis. Quatre ans seulement avant la naissance d’Edgar, la lutte de l’homme blanc contre les Indiens s’était terminée par le massacre de Wounded Knee.
Edgar, qui devait mourir à l’ère du jumbo-jet, est né alors que les deux inventions d’Edison, le phonographe sur cylindre de cire et le kinétoscope, n’étaient encore que des merveilles de la science. Le téléphone était réservé aux personnalités officielles et aux riches. On ne trouvait guère plus de deux cents kilomètres de routes pavées dans tout le pays pour quelques milliers de voitures. Dans les villes, les bicyclettes de tous formats et de tous styles étaient les engins à la mode. Les cités américaines étaient déjà surpeuplées, bien que la grande vague de l’urbanisation n’eût pas encore commencé. Les premiers migrants noirs étaient à nouveau en proie aux persécutions tandis que les États du Sud renforçaient les lois de ségrégation raciale. Le matin de la naissance de Hoover, un Noir fut lynché par une foule de Sudistes, événement banal à l’époque.
La maison en bois peint où est né Edgar, à un kilomètre de la Maison-Blanche, était à l’abri de ces violences. Le père, Dickerson Hoover, âgé de trente-huit ans à la naissance de son fils, descendait de colons qui avaient immigré à Washington au début du siècle. Plus tard, les services de propagande du FBI ont précisé que Dickerson avait fait « carrière au service du gouvernement ». C’est exact, mais il y occupait un poste très subalterne. Comme son père avant lui, il était imprimeur au service de la cartographie.
La mère d’Edgar, Anna, ou « Annie » pour les intimes, âgée de trente-quatre ans, était d’origine plus distinguée. Ses aïeux, notables du village suisse de Klosters, étaient fiers de leurs armoiries ancestrales et de leur belle maison jouxtant l’église locale. Un membre de la famille était même devenu évêque. Le grand-père d’Annie avait été le premier consul général de Suisse aux États-Unis. La grand-mère, qui avait eu treize enfants, était elle-même célèbre. Infirmière diplômée, connue sous le nom de « Mère Hitz », elle avait été la Florence Nightingale des soldats blessés de l’Union pendant la Guerre civile. Anna, la mère, avait reçu une éducation privilégiée à l’école Sainte-Cécile de Washington puis dans un couvent en Suisse. Sa petite-fille qui l’a le mieux connue, Dorothy Davy, évoque une « véritable dame, à l’intéressante personnalité. Elle était très affectueuse, mais également très fière. Grand-père était aimable et gentil, mais c’était elle qui menait la maison ».
Sur une photographie de famille, le père d’Edgar donne l’image d’un membre de la classe cléricale victorienne, peu à son aise, engoncé dans un costume conventionnel avec un grand col dur, un chapeau melon sur les genoux. Sa femme se tient derrière lui, l’air sévère dans la blouse qui lui serre le cou, les cheveux en chignon au sommet de la tête, les lèvres pincées, esquissant un sourire gêné. L’union du couple, quinze ans avant la naissance d’Edgar, est restée dans la famille comme « le plus grand mariage qui ait eu lieu sur Capitol Hill », ce qu’Annie devait considérer comme normal. Mais pour Dickerson, d’origine modeste, l’événement dut être exceptionnel.
Edgar était le dernier de quatre enfants. L’aîné, Dickerson Jr, naquit en 1880, suivi de deux sœurs, Lillian et Sadie. Quand Edgar fut conçu, ses parents étaient encore affligés par la mort de Sadie à l’âge de trois ans, victime de la diphtérie. Les premières photos d’Edgar montrent un petit garçon renfrogné à côté de ses parents, dans une veste aux boutons de cuivre rehaussée d’une chaîne de montre et des culottes bouffantes. On raconte qu’il était « nerveux, maladif et très craintif, cramponné au giron de sa mère chaque fois qu’il le pouvait ». Il entra à six ans à l’école élémentaire de Brent en 1901, alors que Theodore Roosevelt allait devenir président. Il fut toujours un élève modèle.
« Dès la première année, j’étais cinquième de ma classe avec une moyenne de 93,8 », a écrit Hoover dans son carnet de cuir. Les rapports de l’école le confirment. De la troisième à la huitième, il fut noté « excellent plus » ou au minimum « bon » en arithmétique et algèbre, grammaire et orthographe. De son côté, il notait également ses maîtres : « Miss Hinkle, en quatrième, m’a appris la discipline… Miss Snowden m’a développé dans l’intellectuel (sic)… Miss Dalton, en huitième, m’a formé moralement. »
Quand il fut assez grand, Edgar Hoover partait à pied à travers les rues de Washington, sans danger à l’époque, pour aller retrouver son père à son bureau. Il semble que Dickerson Sr ait misé sur son cadet. Son affection pour lui ainsi que ses origines modestes transparaissent dans le style d’une lettre qu’il lui écrivit de Saint-Louis en 1904 et que Hoover a conservée : « Mon petit vieux. Je voudrais que tu es (sic) là pour que je me batte avec toi le matin. Maman pense que tu n’es pas fort, mais laisse-la essayer de se battre avec toi, et elle verra… Sois un bon garçon. Gros bisous. Papa. »
Lorsque le père écrivait : « Ne travaille pas trop dur », Annie était d’un avis différent : « Étudie bien tes leçons et ta musique, et essaie d’être un bon garçon. J’ai été très contente d’apprendre que tu avais été parfait en orthographe et en arithmétique. Prends bien soin de tout et ne vas pas courir les rues. » Annie était très stricte, mais, de l’avis de Dorothy Davis, la nièce d’Edgar, « de tous ses enfants, Edgar fut le plus gâté ».
En 1906, lorsqu’il eut onze ans, Edgar Hoover commença à publier un hebdomadaire qu’il persuada son frère aîné, alors âgé de vingt-six ans, d’imprimer. Chaque semaine, il rassemblait deux pages d’informations. Cette Revue de la semaine était vendue un cent à la famille et aux amis. On trouvait dans la Revue des échos, des nouvelles familiales, ainsi que des articles sur Abraham Lincoln et Benjamin Franklin. L’un d’eux raconte le mariage de la fille du président, Alice Roosevelt, une femme belle, courageuse et non conformiste qui était la coqueluche du moment.
En 1908, à l’âge de treize ans, Edgar tenait son journal intime dans lequel il notait chaque jour la température et le temps qu’il faisait, les événements familiaux, ce que lui rapportaient ses menus travaux occasionnels, et même la taille de ses chapeaux, de ses chaussettes et de ses cols. « Toute la famille, dit Dorothy, avait la hantise de l’organisation. Chaque chose devait être à sa place, cataloguée, et chaque tableau bien aligné sur le mur. Toujours. Cela semble stupide, mais nous étions tous comme cela. »
Le dimanche soir, un vieil homme à la longue barbe blanche venait dîner. La visite chez les Hoover de John Hitz, ce grand-oncle de la famille d’Annie, se traduisait toujours par une séance solennelle de lecture de la Bible. Toute la famille se mettait à genoux lorsque priait l’oncle John, un fervent calviniste. Mais, contrairement aux apparences, aucun des parents d’Edgar n’était particulièrement pieux. Le père se considérait comme luthérien. Annie le suivait, quoique, selon Dorothy Davy, « elle fût plutôt catholique. La mère d’Edgar avait fréquenté des écoles catholiques et elle devait mourir avec un crucifix dans la main ». Le neveu de Hoover, Fred Robinette, confirme qu’Annie n’était pas une « fanatique de la Bible ». D’ailleurs, ni elle ni son mari n’allaient régulièrement à l’église.
Cet amalgame religieux engendra l’inquiétude et la confusion. Plus tard, la sœur d’Edgar, Lillian, devait un jour jeter la bible familiale dans le feu. Hoover, qui s’affirmait publiquement presbytérien, n’en consultait pas moins souvent des prêtres catholiques. Lui aussi devait ultérieurement dénigrer la Bible. Mais, durant sa jeunesse, il suivit les traces pieuses de son frère aîné. Dickerson Jr était d’une piété sincère, et l’Église lui offrait plus qu’une simple consolation spirituelle. Elle constituait la clé de voûte de toute la société des Blancs, dont dépendaient les relations sociales et professionnelles. C’est dans la congrégation luthérienne que Dickerson se trouva une femme.
Le jeune Edgar suivait avec enthousiasme. Il servit comme enfant de chœur, chanta comme soprano dans la chorale de l’église, et, à treize ans, fut baptisé par le pasteur luthérien qui avait marié son frère. Il nota dans son journal qu’il assista à un spectacle sur la Passion, qu’il suivait le catéchisme et qu’il participa à l’activité d’un groupe d’études chrétiennes. Il écrivit un jour : « Ai lu un peu de L’Évangile de Judas Iscariote, un grand bouquin. » Il s’agissait d’une fiction écrite du point de vue de celui qui trahit le Christ. La symbolique de Judas devait marquer à jamais l’esprit d’Edgar, au point que, plus tard, il allait demander à des agents du FBI de vérifier pour lui les détails de l’histoire biblique, obsédé qu’il était par la possibilité d’être lui-même trahi, par des êtres réels ou imaginaires.
Les documents sur l’enfance d’Edgar Hoover montrent qu’il s’amusait comme les autres petits garçons. Il jubile en mentionnant que, le jour des poissons d’avril, il a « mystifié beaucoup de gens ». Il prétendra aussi des années plus tard, avec moins de crédibilité, que lorsqu’il jouait aux gendarmes et aux voleurs, il « voulait toujours être dans le camp des voleurs ». Edgar était fasciné par l’aviation naissante et il construisit des modèles d’aéroplanes avec un ami. En 1909, à l’âge de quatorze ans, il assista au vol d’Orville Wright de Washington à Alexandria et retour. Dans son journal, il mentionna avec orgueil qu’il avait été « le premier profane à serrer la main d’Orville ».
A l’automne de 1909, Edgar entra dans une nouvelle école, située à plus de quatre kilomètres de chez lui, qu’il faisait à pied matin et soir. Ce furent ses premiers pas vers la réussite et la puissance. Car il ne s’agissait plus du petit établissement scolaire local qu’avaient fréquenté son frère et sa sœur. « Sa mère, dit Dorothy, ne l’estimait pas assez bon pour lui. Alors elle l’envoya au Central College. »
Cette institution était le centre de formation de l’élite de Washington, un véritable tremplin vers le succès. Elle était comparable aux meilleures écoles anglaises et, comme elles, attachait une grande importance au sport. Alors qu’Edgar y était élève, l’équipe de football, qui comprenait un futur général et un futur président de la chambre de commerce de Washington, étonna tout le monde en écrasant l’université du Maryland par 14 à 0. Mais Edgar, lui, n’était pas très sportif. « J’ai toujours voulu être un athlète, a-t-il dit avec amertume, mais je ne pesais que 60 kilos. » Pour prouver qu’en dépit de cela il avait du cran, Edgar prétendait que son célèbre profil de bulldog était dû à une blessure au cours d’un match. Une balle perdue lui aurait écrasé le nez pendant une partie de base-ball. Mais, selon sa nièce Margaret Fennell, son nez écrasé était la conséquence d’un furoncle mal soigné.
Edgar Hoover avait un profond respect pour les hommes bien bâtis. En particulier Lawrence « Biff » Jones, qui devait devenir le brillant capitaine de l’équipe de football de West Point. « Nous étions copains et passions tout notre temps ensemble, dit Edgar, ce qui faisait bien rire nos amis à la vue de ce grand gaillard de “Biff” accompagné de ce jeunot qui n’avait que la moitié de sa taille. » Hoover se lança à fond dans une autre activité : le corps des cadets. Son école envoyait régulièrement des diplômés à l’école militaire de West Point : dans la génération d’Edgar, ce furent le célèbre « Biff » et de nombreux futurs généraux.
Edgar était connu sous le surnom de « Rapide » qui devait lui rester pendant très longtemps. Sa biographie officielle suggère, ce qui est fort improbable, que ce terme avait trait à son adresse au football. Hoover, lui, prétendait que cela remontait à son enfance, quand il se faisait de l’argent de poche en portant les paquets des clients du magasin local, parce qu’il courait alors très vite. Aucune de ces explications n’est valable selon Francis Gray, un de ses camarades de classe : « Nous l’appelions Hoover le Rapide parce qu’il parlait très vite. » Son élocution extrêmement rapide devait être son signe distinctif. « Mitraillette », « staccato », « sec comme le coup de fouet d’un charretier »…, tels sont les termes utilisés pour la décrire. « Je peux suivre deux cents mots à la minute, se plaignit un correspondant judiciaire, mais cet homme doit bien en sortir quatre cents ! » William Sullivan , un directeur adjoint du FBI qui devait servir trente ans sous Hoover puis rompit avec lui, propose une autre explication, moins bienveillante : « Il ne voulait pas que quelqu’un lui pose de questions. Alors il n’arrêtait pas de parler à toute vitesse, puis arrêtait brusquement l’interview, serrait la main de son interlocuteur et partait aussitôt. » De nombreux journalistes font écho à l’explication de Sullivan. Hoover, le directeur du FBI, ne parlait pas avec les gens, il parlait aux gens.
Dès son adolescence, Edgar était préoccupé par les questions qui allaient dominer son époque. Avec le recul, ses prises de position au cours des débats des étudiants sont révélatrices. Cuba, qui constituait alors un problème politique aussi sérieux qu’aujourd’hui, était un thème d’actualité. Edgar fit approuver la motion : « Cuba devrait être annexé aux États-Unis. » En marge de la proposition d’abolition de la peine de mort, il écrivit « Neg » (pour « négatif »). Il raisonnait ainsi : 1) La Bible est favorable à la peine capitale. 2) Toutes les nations chrétiennes l’appliquent. 3) L’abolition aurait un effet déplorable sur le pays. Hoover devait rester toute sa vie un partisan de la peine de mort. Au cours des débats, il réussit également à prendre position avec violence contre les revendications des femmes, et en particulier le droit de vote.
A dix-sept ans, sa réussite scolaire ne faiblissait pas. Il était noté « excellent » dans presque toutes les matières, avec une moyenne minimale de 90 sur 100. Il ne manqua l’école que quatre fois en quatre ans. Edgar Hoover ne pouvait pas supporter de n’être que deuxième. Un de ses camarades se souvient de sa réaction alors qu’il était capitaine d’une unité de cadets et que sa compagnie ne réussit pas à l’emporter au cours d’une épreuve de manœuvres : « Lorsque nous sortîmes du terrain d’exercices, je me demandais si Edgar pleurait parce qu’il était furieux ou était furieux parce qu’il pleurait. »
En mars 1913, le capitaine des cadets J. Edgar Hoover descendit à la tête de sa compagnie Pennsylvania Avenue lors de la parade inaugurale pour l’élection du président démocrate Wilson. Seize ans de gouvernement du parti républicain prenaient fin et l’Amérique entrait dans une période de bouleversements. Tandis que la révolution accablait la Russie et la guerre l’Europe, les troubles sociaux étaient la préoccupation majeure des États-Unis. Près de la moitié de la population laborieuse était soumise à des horaires excessifs et des conditions de travail déplorables, et logeait dans des taudis minables. Les États-Unis allaient connaître une vague de grèves tandis qu’un million de socialistes américains réclameraient le renversement du capitalisme.
Bientôt les unités de la Garde nationale iraient mitrailler les travailleurs de l’Ohio. Des membres du syndicat des métallurgistes seraient lynchés, d’autres jetés en prison. Leur droit de protester serait remis en question par ceux qui prétendaient qu’eux, et eux seuls, étaient « 100 % américains ».
Pendant ce temps, la vie poursuivait son cours au college. Pour leur dix-huit ans, Edgar Hoover et ses camarades se préparèrent aux rites et au cérémonial de remise des diplômes. Dans leur superbe uniforme bleu et blanc, ils se rendirent à l’hôtel du Caire pour le bal des cadets. « Nous n’étions pas des danseurs émérites, se souvient l’un d’eux. Nous portions tous nos sabres qui bringuebalaient dans nos jambes. » A l’époque, un bal se déroulait suivant un cérémonial établi. Chaque jeune homme devait tenir son carnet, sur lequel il inscrivait les noms de ses partenaires féminines pour les valses et les fox-trot. Sur celui d’Edgar, qu’il conserva toute sa vie, les pages destinées à ses danseuses sont complètement blanches. Comme on sait qu’il écrivait méticuleusement tout, on peut en déduire qu’il n’y dansa avec personne. Un de ses camarades a dit qu’Edgar « ne sortait pas avec les filles ». Sa nièce Dorothy le confirme : « Edgar n’a jamais eu de petite amie. Jamais ! » Ses camarades se moquaient de lui en disant qu’il n’était amoureux que du corps des cadets.
Sur la photo de classe de cette année-là, Edgar Hoover, la bouche pincée et austère, semble plus fragile que ses camarades bien bâtis. Au-dessous de son nom figure la mention : « Gentleman au courage intrépide et à l’honneur sans tâche. » C’est lui qui prononça le discours d’adieu de sa promotion.
Dans le dernier rapport du corps des cadets, il écrivit : « Il n’y a rien de plus agréable que de faire partie d’un groupe composé d’officiers et d’hommes dont vous sentez qu’ils sont de cœur et d’âme avec vous. Le plus triste moment de l’année fut quand j’ai compris que je devais me séparer de camarades qui avaient fait partie de mon existence. »
Et il conclut en vantant les mérites de la compétition. La discussion est comme la vie, dit-il, « rien de plus ou de moins que l’affrontement de l’esprit d’un homme contre un autre ». Et c’est avec ces certitudes, curieusement ancrées s’agissant d’un jeune de dix-huit ans, qu’il entra dans le monde des adultes.Edgar Hoover n’a jamais parlé de son père, même avec ses plus proches amis. Ceux de la génération qui grandit pendant la Première Guerre mondiale n’ont de lui qu’un souvenir vague. Pour eux, Dickerson Sr reste « Daddy », un homme aimable avec une petite moustache qui aimait emmener les enfants à la cave pour leur faire goûter la boisson au gingembre qu’il fabriquait lui-même. Mais, la plupart du temps, Daddy n’était pas à la maison. Il était souvent absent car, pendant la guerre, les médecins l’avaient envoyé dans un asile à quelque vingt kilomètres de Washington. On ne parlait jamais de sa maladie en présence de ses petits-enfants. L’un d’eux se souvient simplement qu’il avait eu une « dépression nerveuse ». Il avait cinquante-six ans lorsque Edgar quitta le college, et travaillait toujours comme imprimeur au service cartographique. Il gagnait correctement sa vie mais pas assez pour faire oublier à sa femme Annie qu’elle s’était mariée au-dessous de sa condition. A la maison, il avait toujours été le second en tout. Vers la cinquantaine, il commença à souffrir de dépression et de craintes irrationnelles. De fréquents séjours à l’asile n’améliorèrent pas son état qui continua à se dégrader. Au cours des huit années qui lui restaient à vivre, le père d’Edgar devint un individu pitoyable. Son certificat de décès, datant de 1921, indique qu’il est mort de « mélancolie » accompagnée d’« inanition ». A l’époque, « mélancolie » était le terme employé pour ce que les médecins appellent aujourd’hui « dépression ». L’inanition peut être la conséquence de cette maladie si le sujet perd l’envie de vivre et cesse de manger pour en finir.
Cette tragédie eut un effet traumatisant sur Edgar. Son frère aîné et sa sœur, âgés d’une trentaine d’années, étaient partis depuis longtemps, s’étaient mariés et avaient des enfants. Seuls Annie et le jeune Edgar restaient à la maison et faisaient preuve de peu de patience à l’égard de leur père. « Ma mère, dit Dorothy, avait coutume de dire que mon oncle Edgar n’était pas très gentil avec le malade. Il avait honte de lui. Il ne pouvait supporter que grand-père ait une déficience mentale. Il ne pouvait tolérer quoi que ce soit qui ne fût parfait. »
Dorothy, une institutrice à la retraite qui connaît bien les épreuves de la vie, pense que peut-être « tout le clan Hoover était un peu dérangé de la tête ». La famille était sérieusement perturbée. Le fils aîné, Dickerson, était très distant, et sa sœur Lillian était « froide, très froide ». Le jeune Edgar, qui venait souvent chez Dorothy pour jouer au croquet, semblait au début « agréable à fréquenter ». Puis il changea brusquement d’humeur pour devenir très renfermé, « avec des tendances à nous repousser ».
« J’ai souvent pensé, dit sa nièce Margaret, qu’il avait peur… je ne sais comment dire cela… de trop s’impliquer avec les gens. » Cinquante ans plus tard, William Sullivan exprime la même opinion. Edgar, dit-il, « n’avait pas la moindre affection pour un seul être humain de son entourage ».
« Je n’avais aucun respect ou amour pour lui en tant qu’oncle, dit Dorothy Davy. Quoi qu’il ait fait pour le pays, il ne nous a servi à rien comme parent. » D’autres membres de la famille confirment, parfois timidement, comme si Edgar était toujours en vie pour les réprimander, qu’il ne se préoccupait pas beaucoup de ses liens familiaux. Lorsque sa sœur, qui était veuve, fut frappée par la maladie de Parkinson, il ne fit rien pour l’aider. Quand elle mourut, sa présence aux funérailles fut si brève qu’elle sembla insultante.
Le seul lien familial permanent pour Edgar devait être sa mère, Annie. Lorsqu’ils furent libérés du fardeau du père, ils devinrent inséparables. Edgar resta auprès d’elle jusqu’à ce qu’il ait plus de quarante ans. Ce n’est que lorsqu’elle mourut, en 1938, qu’il quitta le domicile familial de Seward Square pour s’installer dans une maison à lui, mais pour y vivre seul