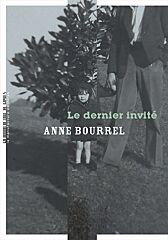Anne Bourrel
Gran madam’s
Virgine Lupesco, ex-étudiante en lettres, est tombée dans la prostitution. Elle travaille sous le nom de Bégonia Mars à la Jonquera, dans une de ces boîtes proches de la frontière, le Gran Madam’s. Quand elle ne se plie pas aux désirs de Ludovic, son mac, elle prend des coups. Et pourtant c’est ensemble, et avec l’aide du Chinois, qu’ils vont assassiner le patron du Gran Madam’s, le Catalan. Ils déposent son corps au sommet du monument pyramidal qui, sur l’autoroute, borde la frontière franco-espagnole. Bégonia, Ludovic et le Chinois vont ensuite prendre la fuite vers Paris. À Leucate, ils rencontrent Marielle, une jeune ado fugueuse qui leur demande de la ramener chez elle. La cavale bifurque et prend un tour inattendu. Hébergé par les parents de la jeune fugueuse, le trio va découvrir petit à petit les raisons qui ont poussé la jeune fille à fuir…
- téléchargez l’extrait
Son regard enfle.
Il défait son pantalon, je fais tomber les bretelles à paillettes. Je fais glisser la culotte, il garde sa chemise à carreaux sur le dos, il enfile le plastique sur son truc. J’ai les yeux qui voient pas, je vole, je flotte, je me mets ailleurs.
Il entre, s’affale, son souffle s’accélère, ses coups aussi, ça va durer longtemps, je suis secouée comme un arbre, secouée, secouée, secouée. J’ai mal au cœur tellement il me secoue, ça va bientôt finir cette affaire ? Mentalement, je m’encourage, je gémis un peu, il s’en fout, il reste dans son délire, pas la peine que je fasse mon numéro, il continue seul sur la lande, ah, il vient, non, toujours pas, toujours pas, toujours pas, il a dû prendre un truc pour que ça dure aussi longtemps, il est en sueur, le tissu de sa chemise est hérissé de piques, il me souffle fort dans l’oreille, on dirait un train à vapeur, il me retourne, il rit tout seul, je lui dis, non, pas là, il grogne et il re-rentre en me tenant la taille entre ses deux mains, il secoue, il secoue, je me tiens comme je peux au dossier du lit, j’ai la peau des joues qui vibre, je pense pas, je ne peux pas penser, je suis trop secouée, secouée, secouée, la lumière clignote, en équilibre sur mes genoux, plus qu’une main accrochée, de l’autre main je montre la porte, pour lui dire, le parcmètre est vide, ça clignote, faut remettre du pognon si tu veux finir, il grogne mais il comprend, il connait le système, il dit, si, lo pongo, il sort à moitié à poil dans le couloir, j’en profite pour souffler, ouh, ça tourne, je suis sur un bateau, il revient, encore vingt minutes et ça repart, il me fait glisser sur le bord du lit, me re-retourne, me remonte vers lui, il m’écarte les jambes, il reste debout, j’ai la tête à l’envers, il rentre encore, profond, et ça repart une nouvelle fois, secouée, secouée, secouée, le type y met toute sa force, il me pince le haut des cuisses, j’ai l’impression de descendre une pente à toute vitesse, je peux même pas arrêter les sons disloqués qui sortent de ma bouche, putain, il vient ou quoi ?
J’ai vu l’heure en rentrant dans la chambre, marquée au dessus du parcmètre : quatre heures du matin. Le coton de ma tête. Le jour va se lever. On va partir. Le Boss a tout prévu. Il y a trois jours, il nous a dit, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Dès qu’il monte dans sa bagnole, on s’éclipse de la boite, ni vu ni connu, on le suit, on roule jusqu’à la frontière, on le coincera là-bas, après, on revient à la boite et on fait comme d’habitude. Le service terminé, on se casse.
Je voyage dans le coton de ma tête, souvent, quand secouée. Comment tu veux résister à tout ça si tu sais pas voyager dans ta tête? Ça dure encore longtemps, ce roulis, et puis je l’oublie. Blanc dans mes yeux, tapages et tangages, j’ai plein de mots en T sur le bout de ma langue. Est-ce que je vais mourir ici, tabassée ? Le type n’est plus là. Parti. J’ai dû m’absenter aussi. Va pas trop loin dans ta tête, je me dis, va pas trop loin, ce soir c’est la dernière fois.
Je sniffe et re-sniffe entre deux portes qui s’ouvrent et se ferment, c’est le grand tournis, j’ai chaud, pas le temps pour une douche, ya affluence, faut assurer. J’ai du métier. Je danse en bas dans la grande salle, au milieu de tous ces yeux, je suis indifférente. Un type me choisit, il n’a pas de visage, c’est juste un autre client. Il pointe son doigt vers moi, il se tortille jusqu’à moi, aplatit direct les mains sur mon derrière, il veut prendre ce qui est à lui, il me souffle dans le cou mais ce n’est pas pour me dire de jolies choses, il veut juste que je lui dise le prix, alors qu’il le connait, le prix, c’est marqué à l’entrée, mais il veut ça, le client, que ce soit la pute qui dise combien elle coute. Il est d’accord avec le prix même si c’est un peu cher, c’est encore sa façon de faire. On finit par monter, il est là pour ça. Il glisse l’argent dans le parcmètre devant la porte, je ferme la porte, ça recommence. Ils sourient tous de la même manière quand ils s’approchent de moi après avoir déposé l’argent dans le parcmètre: là, à cet instant, ils montrent leurs visages en pleine lumière, pour que je vois bien jusqu’à quel degré d’hilarité et d’horreur ils se prennent pour les maitres du monde. Ils me croient soumise mais, c’est sûr, ils ne paient que l’ouverture des jambes, le reste, ma haine qui les pénètre, ils ne la sentiront que plus tard. C’est avec cette pensée-là que je supporte, en général. J’ai les jambes ouvertes et le type s’affale dedans, j’aimerais avoir des dents dans le sexe pour mâcher le type, le mâcher tout entier depuis le bout de sa queue jusqu’à sa tête que je ne regarde pas. Mais ya rien dans mon sexe, ya rien dedans, que de la chair de vieille pute, que de la chair de jeune morte, et des fils enchevêtrés, des restes des autres hommes qui me laminent depuis des millénaires, des traces, des trucs sales, ça doit puer là-dedans mais s’ils y vont avec autant d’entrain, c’est qu’ils doivent y trouver leur compte. Têtes d’hippopotame. Tête d’hippopotame, d’autres têtes d’hippopotame. De girafes. D’iguanes. Qui entrent et qui sortent, de ma chambre, de mon corps. À la file devant les chambres, parcmètres qui sonnent, parcmètres qui se remplissent, l’argent et le foutre coulent à flots. Tête de girafe remplace tête d’hippopotame. La girafe, il veut lécher, il me file un billet de vingt euros entre les seins, d’habitude j’accepte pas, mais là, je dis oui, j’aurais pas dû. Je sais que j’aurais pas dû. Je l’ai su au moment où j’ai dit oui, merde, pourquoi j’ai dit oui ? Il s’accroupit, il lèche, ça va mais tout à coup sans prévenir, il me mord, ce roquet, et il ne lâche pas. Il mord et je crie, il s’accroche, il rit gros, tout en mordant. Je sonne, l’alarme est à portée de main, le Chinois arrive vite, accompagné de Mario, un type musclé, le roquet à tête de girafe, ils le font dégager vite fait. Le Chinois me demande, ça va, pas de dégâts, non, pas de dégâts. Pause. Café, pétard, un whisky coca, le Chinois s’occupe bien de moi, en silence, un petit quart d’heure de répit. Dehors, sur le parking, on retrouve Ludovic le Boss.
On marche en silence autour des chaises en plastique du jardin. Seul, le crissement du gravier. J’ai mal là où il a mordu. Faute professionnelle. Ludovic me gifle, presque rien, une gifle pour la forme. J’ai chaud à la joue. Je suis vexée, mordue, giflée et vexée. Je me tiens comme un canard. Mon sexe est plus sale que d’habitude. Mon sexe est une plaie qui me colle. À la place, je voudrais rien avoir, comme les poupées en plastique. Le jour se lève orange sur le parking entre les arbres. Ludovic déclare : tout va bien.
Au dessus de sa bouche molle, s’agite un grain de beauté noir et poilu. Ses lèvres épaisses se frottent l’une contre l’autre. Je pense à un escargot sur une feuille de salade. Ludovic le Boss a un escargot à la place de la bouche. Ça me fait vomir. Debout sur le parking du Gran Madam’s avec le jour qui se lève, les cyprès qui dentèlent l’aube, je vomis au pied du Boss. Il croit que j’ai peur, il est à cran. Non, pas peur. C’est l’escargot, Boss, l’escargot de ta bouche qui me fait cet effet. En vrai, je dis rien. Lui : Putain, mes pompes ! Se recule d’un bond. Je vomis ma nuit, la secousse de l’hippopotame, la morsure et aussi ce que nous avons à faire ce soir. Le Chinois accourt, toujours prévenant, le Chinois. Elle est malade ? Non, la trouille, fait l’escargot sur la face du Boss. J’ai plus rien à vomir. J’aurais bien continué à me vider. Le Chinois et Ludovic le Boss me regardent. Le Chinois, yeux mer, le Boss, yeux fer.coinÇa va, ça va. J’y retourne. C’est tout ce que j’ai à dire. Dans mon dos, le Boss répète pour le Chinois : Putain, mes pompes !
On y est allé à la frontière, à la nuit tombée. Le Chinois conduisait, c’est lui qui fait toujours tout. J’étais assise côté passager, je regardais tout droit devant moi. À l’arrière, Le Boss parlait seul. C’est bien, c’est bien, il disait, tout le monde dort. D’un côté comme de l’autre, sur l’autoroute, c’est le grand vide de la nuit. Pas un bruit, pas une lumière dans les collines noires et aucun phare de voiture ou de camion à l’horizon.
On roulait vite, vitres ouvertes, la Clio accrochée au pare-choc du Catalan. Il faisait presque froid. Ça aurait pu nous rafraichir des chaleurs de l’été, mais on avait autre chose en tête.
Pour ne pas avoir à lui courir après toute la nuit, on s’était assurés que le réservoir d’essence de sa voiture serait quasiment vide. Il n’irait pas bien loin. Sur ordre du Boss, le Chinois a presque tout siphonné.
Passée la frontière, les postes de douanes étaient étonnamment calmes. On se méfiait des caméras de surveillance, toujours allumées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le Chinois avait récupéré des casquettes rouges dans un fastfood, on les a mises. Elles étaient rouges avec écrit « Quick » sur la visière, une longue visière qui cachait bien nos visages.
Comme prévu, le Catalan a ralenti. En pleine panique, il a mis le cligno, le pauvre, pour virer à droite vers le parking derrière la douane. Il a ralenti, il allait s’arrêter. Sa voiture a toussé, on a manqué lui rentrer dedans. Il a freiné, il est sorti de sa bagnole, un coupé Audi bleu électrique tout neuf. La cravate et les mains en avant il regardait de tous les côtés, il cherchait quelque chose quelque part, ça a duré un millième de seconde, et il s’est mis à courir.
Il est parti à toute vitesse vers le monument pyramidal. Dans la lumière des phares de la Clio, j’ai vu ses traits crispés et ses yeux ronds.
On courait nous aussi, les casquettes rouges bien enfoncées sur le crâne, la visière baissée. « Quick » était brodé dessus en lettres jaune doré. Ils verront que ça à la vidéo, avait dit le Boss, ils verront que ça. On courait tous les trois derrière lui, je n’étais pas armée, le Boss et Le Chinois devaient s’occuper de tout. Je l’entendais, son souffle. Court. Coupé. Il s’élançait aussi vite qu’il pouvait, ses bras battaient l’air dans tous les sens, il titubait. Ce n’était pas un sportif, non et les pentes du monument sont très raides, ses jambes tricotaient et dans son dos les pans de sa chemise lui faisaient des ailes blanches inutiles. Il s’étouffait, il haletait et je n’entendais rien d’autre que son souffle asthmatique.
Pendant que le Catalan essayait encore de s’enfuir en remontant vers le haut du monument, Ludovic et le Chinois balançaient n’importe où presque toutes les balles de leurs gros calibres avec silencieux.
Pour tirer, ils n’étaient pas très doués, ils manquaient encore d’entrainement.
Le Catalan s’essoufflait de plus en plus, il n’en pouvait plus mais il continuait de grimper aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Ils l’ont poursuivi et quand ils sont arrivés en haut, hirsutes et désorientés, ils l’ont vu, allongé par terre, un bras et une jambe en sang mais toujours vivant. Le Catalan criait des trucs mais ils n’entendaient pas. Le son était coupé. Ils se sont regardés, ils étaient d’accord sans même avoir échangé un seul mot.
Ils ont décidé de l’achever à coup de pieds et de pierres.coinEt sur la tête du Catalan cognaient les pierres et les coups de pieds pleuvaient. Le Chinois a pris le révolver des mains de Ludovic. Il restait encore une balle, il a pointé l’arme vers le corps à l’abandon et il a tiré, tiré en plein dedans pour être sûr d’en avoir fini. Sur le blanc de la chemise sont apparues des fleurs rouges brodées de noir. Des brulures éphémères aussitôt englouties dans des flaques de pourpre visqueux.
Sur les joues du Chinois coulaient de grosses gouttes de sueur ou de pleurs, brillantes dans la lumière blanche de l’autoroute.
Comme deux vulgaires détrousseurs, ils lui ont fait les poches. J’ai détourné les yeux un instant vers la lune rousse qui semblait à cette heure emballée dans de fines couches de cellophane.
Ensuite, ils ont fait rouler le cadavre du Catalan jusqu’à la plateforme de pierres. Ils l’ont laissé comme ça, exposé en plein vent entre les piliers de brique, quatre griffes du même rouge que son sang.
J’avais peur que quelqu’un finisse par sortir des bureaux de douane, que l’on nous ait vus monter en haut du monument pyramidal, pourtant interdit à tout accès, que l’on nous surprenne en train de courir sur le parking. Mais personne n’a rien vu, personne n’a rien entendu et c’était même pas sûr qu’il y ait des caméras de surveillance.
Tous les trois l’un derrière l’autre, on est redescendu en trébuchant sur des mottes de terre sèches et des pierres glissantes qui roulaient sous nos pieds avec des bruits d’osselets. Lorsqu’on est arrivés au bas de la pyramide, des crapauds coassaient en rythme.
Et toujours aucun véhicule sur le goudron noir de l’autoroute. Derrière la douane, nous attendait la voiture du Catalan. Il avait laissé la portière de gauche ouverte tous feux allumés. L’alarme des phares était encore en marche. Je me demande vraiment ce qu’ils font les douaniers la nuit ; logiquement, on aurait dû se faire remarquer.
Le Chinois a retiré la clé du contact pour arrêter le bruit. Les phares se sont éteints comme des yeux qui se ferment. On n’entendait plus que les crapauds. Ludovic et moi, on était debout face à la voiture, les bras ballants, les jambes plantées dans le macadam. Le Chinois s’affairait. Il s’apprêtait à jeter les clés loin en avant, mais il s’est ravisé, il les a fourrées au fond de sa poche et il a claqué la portière. La voiture avait un air faussement tranquille.
On est remontés dans la Clio, on a passé la frontière, en France, on a ouvert les vitres en grand, on a jeté les casquettes, elles ont été avalées par la nuit et à la première sortie, on a repris l’autoroute dans l’autre sens jusqu’à la Jonquera. Arrivé à la boite, chacun est rentré de son côté. On savait ce qu’il nous restait à faire.