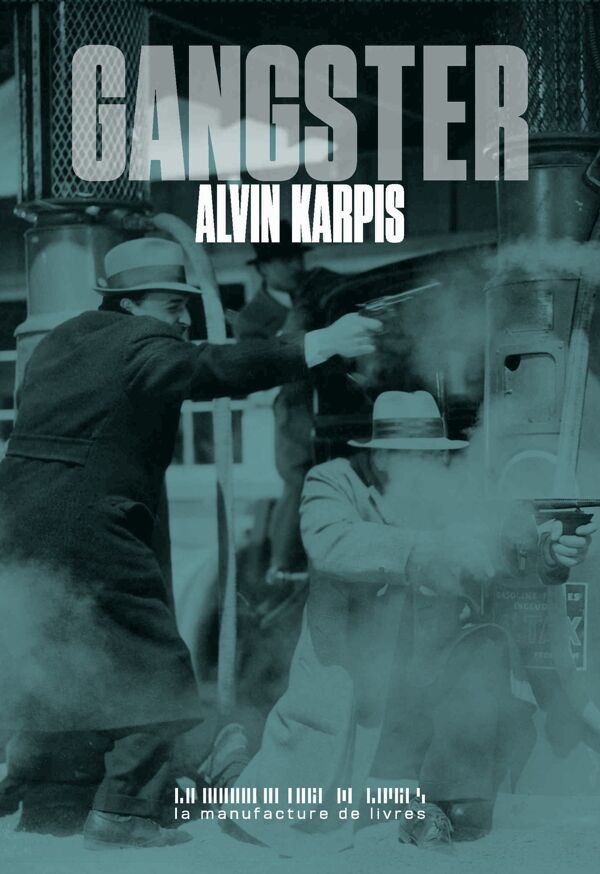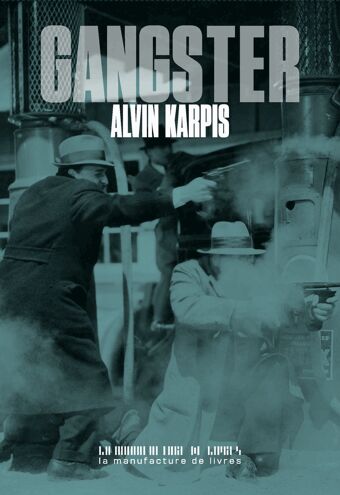
Alvin Karpis
Gangster
BiographieRécitDocument
a paru le 7 juin 2018
ISBN 978-2-3588-7255-3
Cahier photo 8 pages
BiographieRécitDocument
a paru le 7 juin 2018
ISBN 978-2-3588-7255-3
Cahier photo 8 pages
« Je ne crois pas qu’il existe ce qu’on appelle un “criminel né”, mais je n’étais pas sorti depuis bien longtemps de l’enfance lorsque j’ai décidé de faire carrière dans le crime. J’avais 10 ans et, déjà, je me préparais à devenir l’ennemi public n°1 des États-Unis. »
De 1925 à 1936, Alvin Karpis dévalise, braque, kidnappe et assassine quand il y est contraint, semant le chaos d’un bout à l’autre des États-Unis. Fidèle à ses amitiés, nomade par nécessité, traqué sans relâche par J. Edgar Hoover, le patron du FBI, Alvin Karpis deviendra l’obsession du gouvernement américain, l’un des quatre gangsters jamais appelés par les fédéraux « Public Enemy #1 » et le seul d’entre eux à y avoir survécu. Gangster est l’incroyable récit de cette vie criminelle aussi romanesque qu’un polar.
- téléchargez l’extraitProfession ? Gangster, braqueur, kidnappeur. Et j’étais sacrément bon, peut-être le meilleur d’Amérique du Nord. Et ce pendant cinq ans, de 1931 à 1936. Non, je n’essaie pas de flatter mon ego quand j’utilise ce mot de « professionnel ». Ce business est vraiment devenu mon métier parce que c’est comme ça que je l’ai abordé : en professionnel. Dans d’autres circonstances, j’aurais pu être un avocat brillant ou peut-être un homme d’affaires fortuné. J’aurais pu faire n’importe quoi qui demande du style et surtout pas une once de pitié. J’aurais même pu occuper un poste élevé dans la police. Je me débarrassais si facilement des flics et des mecs du FBI qu’on peut dire que je connaissais mieux le crime que n’importe lequel d’entre eux, y compris le numéro un, J. Edgar Hoover. Mais la vie a en décidé autrement, et ça depuis que j’étais tout gosse. Et je ne suis pas devenu avocat, homme d’affaires, ou un de ces G-Men 1. Je suis devenu un voleur, un voyou et un kidnappeur. Et oui, j’étais un pro.Je ne sais pas combien d’argent j’ai gagné. J’ai perdu le compte. J’ai pourtant une bonne mémoire et je me rappelle des détails de presque toutes les attaques de banques, de tous les braquages, de toutes les affaires de toutes ces années durant lesquelles Freddie Barker, moi et tous les autres membres du gang Karpis Barker, on sillonait le Midwest. Mais impossible de savoir combien de fric j’ai pu faire. Tout ce que je sais, c’est que dans les bons jours, nous vivions très bien. Nous avions toujours de l’argent pour acheter la meilleure bouffe, vivre dans les plus beaux hôtels et ou des appartements confortables, porter des vêtements de luxe et conduire de grosses cylindrées.Le problème était que je devais toujours faire attention à la manière de dépenser mon fric. Pendant toute ma vie d’adulte, j’ai été un fugitif. J’ai dû surveiller les flics et j’étais aux aguets chaque seconde du jour et de la nuit. J’ai peut-être gagné beaucoup d’oseille, mais je ne pouvais pas l’étaler comme un business man ordinaire, et je n’ai jamais fréquenté la haute société. Au lieu de cela, quand je cherchais du bon temps avec Freddie et les autres, c’était dans les bars clandestins ou les bordels. Je me sentais bien avec les gens qui vivaient dans ce genre d’endroits : je pouvais m’y détendre. Nous avions tous la même chose en commun : beaucoup de pognon et des flics qui nous attendaient.Je suis devenu un gangster pour faire de l’argent. Mais je n’étais pas tout à fait ce que vous pourriez appeler un « mercenaire ». Le fric n’était pas ma principale motivation. L’action et l’adrénaline, voilà ce que je cherchais. Planifier un coup et effectuer chaque étape avec une précision militaire, j’adorais ça. Nos jobs, comme on les appelait, n’étaient jamais improvisés. En tout cas pas après le début de notre âge d’or. Nous étions des sacrés pros : nous fixions le timing, les routes d’évacuation, le rôle de chaque type, et tous les détails de chaque vol ou kidnapping comme pour une opération militaire.Mais on avait beau tout planifier, un travail pouvait mal tourner. Et quand je dis ça, je ne parle pas d’un petit accroc. Certains ratés pouvaient devenir des catastrophes totales. Je pense à ce qui s’est passé quand nous avons attaqué la banque de Concordia au Kansas. C’était arrivé au printemps 1932, alors que j’avais vingt-quatre ans, et si un studio hollywoodien avait voulu faire un film sur cette affaire de Concordia, c’est pas Edward G. Robinson ou Jimmy Cagney qu’il aurait fallu pour les premiers rôles, mais Buster Keaton ou Laurel et Hardy.Nous étions cinq, Freddie Barker, Lawrence DeVol, Jess Doyle et Earl Christman. Christman était là parce qu’il avait besoin de fric bien sûr. Il était un spécialiste des embrouilles et des escroqueries, et il avait fait de la taule à Jackson, au Michigan. Il s’était évadé lors d’un transfert avec des shérifs de Seattle qui l’escortaient pour témoigner dans un procès sur une affaire d’attaque de train sur la côte ouest. Il était fauché, alors nous l’avons embarqué avec nous sur le coup de Concordia. C’était vraiment une embellie qu’on lui faisait : il n’avait aucune expérience de hold-up. Mais il y avait beaucoup de solidarité comme ça entre nous. On s’entre-aidait parce qu’on ne savait jamais quand la poisse allait vous tomber dessus. Jess Doyle était comme Christman – Concordia était aussi son premier coup. C’était un voleur de banque expérimenté qui avait cassé la nuit plus que sa part de coffres-forts, mais il n’avait jamais franchi en plein jour la porte d’entrée d’une banque avec une arme à la main.Les trois autres étaient aguerris. Freddie Barker, c’était l’un de mes amis les plus intimes. Il était un sale type quand il devait l’être, un gangster qui n’hésitait jamais à se tirer d’affaire. À certaines occasions, cela ne le dérangeait pas du tout, surtout quand c’était un flic qui était dans sa ligne de mire. Il était un des fils de la fameuse Ma Barker et, pendant des années, Freddie, son frère Doc, Ma, et moi avons vécu ensemble dans différentes villes du Midwest. C’est ainsi qu’est née la légende du « gang Karpis Barker ».L’autre gars de Concordia, Lawrence DeVol, travaillait avec moi depuis plusieurs années. Je l’avais rencontré la première fois en prison en 1926 à Hutchinson, Kansas. Je purgeais une peine de cinq ans pour cambriolage, et je me suis tout de suite entendu avec ce type taciturne, environ cinq ou six ans plus vieux que moi, qui semblait tout savoir des coffres-forts. C’était ça DeVol : un sacré bon professeur. Nous avons été libérés d’Hutchinson ensemble et plus tard, nous avons enchaîné des dizaines de hold-up.Nous vivions tous les cinq avec Ma Barker dans une grande maison à White Bear Lake, au nord-est de Saint Paul dans le Minnesota, lorsque nous avons décidé de nous en prendre à la banque de Concordia. Nous n’avons pas discuté du coup pendant que Ma était là. Nous ne l’avons jamais fait d’ailleurs. Contrairement aux histoires qui ont ensuite été racontées dans les livres et les films, Ma n’a joué aucun rôle dans nos braquages. En fait, toute sa vie, elle a été complètement en dehors de nos coups. À White Bear Lake, nous avons observé le même mode opératoire que nous avons toujours suivi. Quand nous discutions d’une affaire, on prenait une de nos voitures et on roulait. Une tire était l’endroit le plus sûr et le plus discret que l’on puisse imaginer, impossible de se faire écouter par les flics, ou Ma.La première étape du plan consistait à étudier les routes dans la région de Concordia. C’était la base de n’importe quel job.Nous avons emprunté chaque chemin de terre, route ou piste jusqu’à connaître le coin comme notre poche. Ensuite, nous avons tracé un itinéraire à partir de Concordia qui pourrait tromper la police. Il empruntait les petites routes les moins fréquentées. Une fois déterminé ce plan de sortie, nous l’inscrivions en détail dans un cahier. Nous avons mis le compteur de la voiture à zéro devant la banque de Concordia et refait le parcours. Chaque fois que nous changions de route, nous notions le kilométrage. Idem avec genre « une grange rouge sur la droite à tant de kilomètres, une maison de pierre à gauche à un autre endroit »… etc. Après avoir effectué l’itinéraire plusieurs fois, nous avions notre plan d’évacuation.Planifier la route ça voulait dire aussi planquer de l’essence à des points stratégiques. Notre première planque était à 30 km de la banque. Cacher du carburant c’était important car les flics avaient la sale habitude de tirer dans les réservoirs alors que nous nous échappions. Nous emportions des bouchons pour colmater les fuites, mais nous perdions beaucoup de carburant avant que nous puissions arrêter la voiture pour poser ces fichus bouchons. C’est pourquoi il fallait un nouveau plein d’essence à seulement 30 km du départ.Après Concordia, nous avons décidé d’aller nous planquer dans la région de Saint-Paul, à près de 600 km. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver un itinéraire sûr, d’autant plus que nous devions éviter les routes principales et les grandes villes où les flics pouvaient nous remarquer.Nous avons donc soigneusement planifié, disposé une demi-douzaine de planques d’essence et, pour faire bonne mesure, nous y avons stocké du ravitaillement. Nous avons étudié la banque, localisé le coffre-fort et le poste de chaque employé, assigné chacun de nos gars à un job précis. Il nous fallait sept ou huit minutes pour s’emparer de l’argent et s’arracher pour Saint Paul. Nous avions acheté des salopettes : c’était ce que portaient la plupart des ploucs de la région. De cette façon, nous pourrions nous fondre dans le paysage.Et enfin, par une belle journée ensoleillée, en milieu de matinée, nous sommes entrés dans la banque. Doyle attendait dehors au volant de la voiture. Christman se tenait juste à l’entrée, tenant quelques billets d’un dollar comme s’il venait faire un dépôt. Son rôle consistait à s’occuper des clients à leur arrivée. Avec un peu de chance, il n’aurait pas grand-chose à faire, car nous avions prévu d’être dehors avant l’arrivée de ceux-ci.DeVol, Freddie et moi, on est entrés. On a jeté un coup d’oeil vite fait. Il y avait sept ou huit employés derrière le comptoir, et les seuls clients en vue étaient deux vieux fermiers assis sur un banc, mangeant leurs petits-déjeuners dans des sacs en papier kraft. Nous avons sorti nos flingues et nous avons dit à tout le monde d’aller dans une petite pièce à l’arrière du comptoir. Les membres du personnel ont fait ce qu’on leur a dit, mais les deux fermiers ont continué de manger comme si de rien n’était. On a eu beau leur mettre nos armes sous le nez, ils n’ont toujours pas bougé. Freddie, DeVol et moi nous sommes regardés. Finalement DeVol est venu se coller devant en agitant son 45.– Hé les bouseux, nous sommes en train d’attaquer cette banque, a-t-il dit bien distinctement.Et alors tranquillement ces deux abrutis se sont levés avec leurs sandwichs et sont partis attendre avec le reste du personnel. L’incident ne nous a coûté qu’un petit retard, mais c’était un mauvais présage.Tous les trois nous avons vidé les casiers en un temps record et on a chargé les billets dans des sacs de la navy, les mêmes que tous les pilleurs de banque utilisaient. Puis DeVol et Freddie ont braqué le caissier en chef, l’ont amené dans la chambre forte et lui ont demandé de déverrouiller le coffre-fort. C’était l’un de ces gros coffres blindés avec un verrou à combinaisons multiples.– Ouvre ça ! ordonna DeVol.– Non, dit-il simplement.– Mais ouvre ce putain de coffre-fort ! cria DeVol.Le caissier était complètement buté, il secoua la tête.Je regardais DeVol, Freddie et ce caissier à travers la porte, et quand ça a commencé à s’envenimer, je suis retourné dans l’entrée de la banque pour vérifier si tout se passait bien. Par la fenêtre, je pouvais voir Doyle assis derrière le volant faisant semblant de lire un journal. À côté de lui sur le siège, je savais qu’il avait sa mitraillette Thompson. Christman, pendant ce temps, devait régler son premier accroc. Un couple de clients est arrivé. Il leur a dit, comme nous l’avions répété, que c’était un braquage et qu’ils devaient aller dans la pièce du fond. Christman a fait ça bien, dans le calme.Je suis revenu vers le coffre.– Ouvre ça ou je te descends ! disait DeVol au caissier.– Non.DeVol gifla le gars, mais ça ne servit à rien. C’était un fils de pute, mais un fils de pute déterminé.
Alvin Karpis "Public Enemy No. 1"
Documents à télécharger
Documents à télécharger