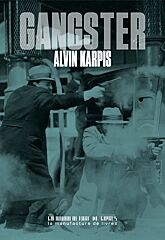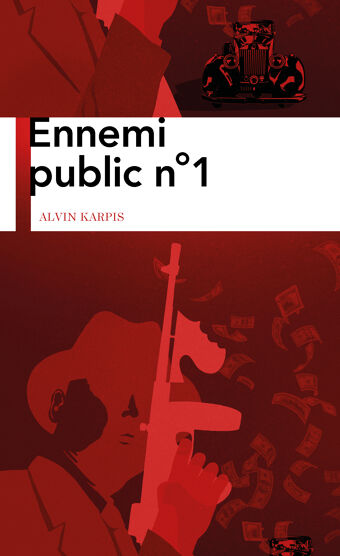
Alvin Karpis
Ennemi public n°1
États-Unis, années 30. Tout gamin, Alvin Karpis rêve déjà d’aventure, de liberté et d’argent facile : le rêve américain, version hors-la-loi ! Dès qu’il sait tenir une arme, il dévalise, braque, kidnappe… Il est fidèle en amitié, nomade par nécessité. Obsession des fédéraux, il joue au chat et à la souris avec le FBI et devient l’« Ennemi public n°1 », le premier dans l’histoire qui portera ce titre et le seul qui n’y laissera pas sa peau. Ce livre est le récit de cette vie criminelle aussi romanesque que le meilleur des polars.
- Revue de presseIl y a quelque chose de romantique et de presque idéaliste dans la vie de ce jeune type des années 30. Une passionnante histoire vraie.Une vie qui a inspiré romanciers et cinéastes.Complètement bouleversant ! C’est un vrai Polar !
- téléchargez l’extrait
Profession ? Pilleur de banque, gangster, kidnappeur. Et j’étais sacrément bon, peut-être le meilleur d’Amérique du Nord. Et ça pendant cinq ans, de 1931 à 1936. Non, je n’essaie pas de flatter mon ego quand j’utilise ce mot de « professionnel ». Ce business est devenu mon vrai métier parce que c’est comme ça que je l’ai abordé : en professionnel. Dans d’autres circonstances, j’aurais pu être un avocat brillant ou peut-être un homme d’affaires fortuné. J’aurais pu faire n’importe quoi qui demande du style et surtout pas une once de pitié. J’aurais même pu occuper un poste élevé dans la police. Je me débarrassais si facilement des flics et des mecs du FBI qu’on peut dire que je connaissais mieux le crime que n’importe lequel d’entre eux, y compris le numéro un, J. Edgar Hoover. Mais ma vie a en décidé autrement, et ça depuis que j’étais tout gosse. Et je ne suis pas devenu avocat, homme d’affaires, ou un de ces G-Men[1]. Je suis devenu un voleur, un voyou et un kidnappeur. Et oui, j’étais un pro.
Je ne sais pas combien d’argent j’ai gagné. J’ai perdu le compte. J’ai pourtant une bonne mémoire et je me rappelle des détails de presque toutes les attaques de banques, de tous les braquages, de toutes les affaires de toutes ces années durant lesquelles Freddie Barker, moi et tous les autres membres du gang Karpis Barker, on écumait le Midwest. Mais impossible de savoir combien de fric j’ai pu faire. Tout ce que je sais, c’est que dans les bons jours, nous vivions très bien. Nous avions toujours de l’argent pour acheter la meilleure bouffe, vivre dans de chouettes hôtels et ou des appartements confortables, porter des vêtements de luxe et conduire de grosses cylindrées.
Le problème était que je devais toujours faire attention à la manière de dépenser mon fric. Pendant toute ma vie d’adulte, j’ai été un fugitif. Je devais surveiller les flics et j’étais aux aguets chaque seconde du jour et de la nuit. J’ai peut-être gagné beaucoup de cash, mais je ne pouvais pas l’étaler comme un business man ordinaire, et je n’ai jamais fréquenté la haute société. Au lieu de cela, quand je cherchais du bon temps avec Freddie et les autres, c’était dans les bars clandestins ou les bordels. Je me sentais bien avec les gens qui vivaient dans ce genre d’endroits : je pouvais m’y détendre. Nous avions tous la même chose en commun : beaucoup de fric et des flics qui nous attendaient pour nous arracher à cette vie.
Je me suis lancé dans le crime pour faire de l’argent. Mais je n’étais pas tout à fait ce que vous pourriez appeler un « mercenaire ». Le fric n’était pas ma principale motivation. L’action et l’adrénaline, voilà ce que je cherchais. Planifier un coup et effectuer chaque étape avec une précision militaire, j’adorais ça. Nos jobs, comme on les appelait, n’étaient jamais improvisés. En tout cas pas après le début de notre âge d’or. Nous étions des sacrés pros : nous fixions le timing, les routes d’évacuation, le rôle de chaque type, et tous les détails de chaque vol ou kidnappins comme pour une opération militaire.
Mais on avait beau tout planifier, un travail pouvait mal tourner. Et quand je dis ça, je ne parle pas d’un petit accroc. Certains ratés pouvaient devenir des catastrophes totales. Je pense à ce qui s’est passé quand nous avons attaqué la banque de Concordia au Kansas.
C’est arrivé au printemps 1932, alors que j’avais vingt-quatre ans, et si un studio hollywoodien avait voulu faire un film sur cette affaire de Concordia, c’est pas Edward G. Robinson ou Jimmy Cagney qu’il aurait fallu pour les premiers rôles, mais Buster Keaton ou Laurel et Hardy.
Nous étions cinq, Freddie Barker, Lawrence DeVol, Jess Doyle et Earl Christman. Christman était là parce qu’il avait besoin de fric bien sûr. Il était un spécialiste des embrouilles et des escroqueries, et il avait fait de la taule à Jackson, au Michigan. Il s’était évadé lors d’un transfert avec des shérifs de Seattle qui l’escortaient pour témoigner dans un procès sur une affaire d’attaque de train sur la côte ouest. Il était fauché, alors nous l’avons embarqué avec nous sur le coup de Concordia. C’était vraiment une embellie qu’on lui faisait : il n’avait aucune expérience de hold-up. Mais il y avait beaucoup de solidarité comme ça entre nous. On s’entre-aidait mutuellement parce qu’on ne savait jamais quand la poisse allait vous tomber dessus. Jess Doyle était comme Christman - Concordia était aussi son premier coup. C’était un voleur de banque expérimenté qui avait cassé la nuit plus que sa part de coffres-forts, mais il n’avait jamais franchi en plein jour la porte d’entrée d’une banque avec une arme à la main.
Les trois autres étaient aguerris. Freddie Barker, c’était l’un de mes amis les plus intimes. Il était un sale fer quand il devait l’être, un gangster qui n’hésitait jamais à se tirer d’affaire. À certaines occasions, cela ne le dérangeait pas du tout, surtout quand c’était un flic qui était dans sa ligne de mire.
Il était un des fils de la fameuse Ma Barker et, pendant des années, Freddie, son frère Doc, Ma, et moi avons vécu ensemble dans différentes villes du Midwest. C’est ainsi qu’est née la légende du « gang Karpis Barker ».
L’autre gars de Concordia, Lawrence DeVol, travaillait avec moi depuis plusieurs années. Je l’avais rencontré la première fois en prison en 1926 à Hutchinson, Kansas. Je purgeais une peine de cinq ans pour cambriolage, et je me suis tout de suite entendu avec ce type taciturne, environ cinq ou six ans plus vieux que moi, qui semblait tout savoir des coffres-forts. C’était ça Devol : un sacré bon professeur. Nous avons été libérés d’Hutchinson ensemble et plus tard, nous avons enchaîné des dizaines de hold-up.
Nous vivions tous les cinq avec Ma Barker dans une grande maison à White Bear Lake, au nord-est de Saint Paul dans le Minnesota, lorsque nous avons décidé de nous en prendre à la banque de Concordia. Nous n’avons pas discuté du coup pendant que Ma était là. Nous ne l’avons jamais fait d’ailleurs. Contrairement aux histoires qui ont ensuite été racontées dans les livres et les films, Ma n’a joué aucun rôle dans nos braquages. En fait, toute sa vie, elle a été complètement en dehors de nos coups. À White Bear Lake, nous avons observé le même mode opératoire que nous avons toujours suivi. Quand nous discutions d’une affaire, on prenait une de nos voitures et on roulait. Une tire était l’endroit le plus sûr et le plus discret que l’on puisse imaginer, impossible de se faire écouter par les flics, ou Ma.
La première étape du plan consistait à étudier les routes dans la région de Concordia. C’était la base de n’importe quel job. Nous avons emprunté chaque chemin de terre, route ou piste jusqu’à connaître le coin comme notre poche. Ensuite, nous avons tracé un itinéraire à partir de Concordia qui pourrait tromper la police. Il empruntait les petites routes les moins fréquentées. Une fois déterminé ce plan de sortie, nous le décrivons avec une précision absolue dans un cahier. Nous avons mis le compteur de la voiture à zéro devant la banque de Concordia et refait le parcours. Chaque fois que nous changions de route, nous notions le kilométrage. Idem avec genre une grange rouge sur la droite à tant de kilomètres, une maison de pierre à gauche à un autre endroit… etc. Après avoir effectué l’itinéraire plusieurs fois, nous avions notre plan d’évacuation.
Planifier la route ça voulait dire aussi planquer de l’essence à des points stratégiques. Notre première planque était à vingt-cinq miles de la banque. Cacher du carburant c’était important car les flics avaient la sale habitude de tirer dans les réservoirs alors que nous nous échappions. Nous avions certes l’habitude de transporter des bouchons pour boucher les fuites, mais nous perdions beaucoup de carburant avant que nous puissions arrêter la voiture pour poser ces satanés bouchons. C’est pourquoi il fallait un nouveau plein d’essence à seulement vingt-cinq miles du départ.
Après Concordia, nous avons décidé d’aller nous planquer dans la région de Saint-Paul, à près de sept cents miles. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver un itinéraire sûr, d’autant plus que nous devions éviter les routes principales et les grandes villes où les flics pouvaient nous remarquer. Nous avons donc soigneusement planifié, disposé une demi-douzaine de planques d’essence et, pour faire bonne mesure, nous y avons stocké du ravitaillement.
Nous avons étudié la banque, localisé le coffre-fort et le poste de chaque employé, assigné chacun de nos gars à un job précis. Il nous fallait sept ou huit minutes pour s’emparer de l’argent et s’arracher pour Saint Paul. Nous avions acheté des salopettes : c’était ce que portaient la plupart des ploucs de la région. De cette façon, nous pourrions nous fondre dans le paysage.
Et enfin, par une belle journée ensoleillée, en milieu de matinée, nous sommes entrés dans la banque. Doyle attendait dehors au volant de la voiture. Christman se tenait juste à l’entrée, tenant quelques billets d’un dollar comme s’il venait faire un dépôt. Son job consistait à s’occuper des clients à leur arrivée. Avec un peu de chance, il n’aurait pas grand-chose à faire, car nous avions prévu d’être dehors avant l’arrivée des premiers clients.
DeVol, Freddie et moi, on est entrés. On a jeté un coup d’œil vite fait. Il y avait sept ou huit employés derrière le comptoir, et les seuls clients en vue étaient deux vieux fermiers assis sur un banc, mangeant leurs petits-déjeuners dans des sacs en papier kraft. Nous avons sorti nos flingues et, parlant à voix basse, nous avons dit à tout le monde d’aller dans une petite pièce à l’arrière du comptoir. Les membres du personnel ont fait ce qu’on leur a dit, mais les deux fermiers ont continué de manger comme si de rien n’était. On a eu beau leur mettre nos armes sous le nez, ils n’ont toujours pas bougé. Freddie, DeVol et moi nous sommes regardés. Finalement DeVol est venu se coller devant en agitant son 45 automatique.
- Hé les bouseux, nous sommes en train d’attaquer cette banque, a-t-il dit bien distinctement.
Et alors tranquillement ces deux abrutis se sont levés avec leurs sandwichs et sont partis attendre avec le reste du personnel. L’incident ne nous a coûté qu’un petit retard, mais c’était un sacré mauvais présage.
Tous les trois nous avons vidé les casiers en un temps record et on a chargé les billets dans des sacs de la navy, les mêmes que tous les pilleurs de banque utilisaient. Puis DeVol et Freddie ont braqué le caissier en chef, l’ont amené dans la chambre forte et lui ont demandé de déverrouiller le coffre-fort. C’était l’un de ces gros coffres blindés avec un verrou à combinaisons multiples.
- Ouvre ça ! ordonna DeVol.
- Non, dit-il simplement.
- Mais ouvre ce putain de coffre-fort ! cria DeVol.
Le caissier était une sorte de Hollandais complètement buté, il secoua la tête.
Je regardais DeVol, Freddie et ce caissier à travers la porte, et quand ça a commencé à s’envenimer, je suis retourné dans l’entrée de la banque pour vérifier si tout se passait bien. Par la fenêtre, je pouvais voir Doyle assis derrière le volant faisant semblant de lire un journal. À côté de lui sur le siège, je savais qu’il avait sa mitraillette Thompson. Christman, pendant ce temps, devait régler son premier accroc. Un couple de clients est entré. Il leur a dit calmement, comme nous l’avions répété, que c’était un braquage et qu’ils devaient aller dans la pièce du fond. Christman a fait ça bien, dans le calme.
Je suis revenu vers le coffre.
- Ouvre ça ou je te descends ! disait DeVol au caissier.
- Non.
DeVol gifla le gars, mais ça ne servit à rien. C’était un fils de pute, mais un fils de pute déterminé.
Je suis revenu au fond à la recherche d’une fille et je l’ai emmenée dans la chambre forte. J’ai braqué mon arme sur son estomac. C’était un 45 automatique avec un chargeur de 20 coups, une arme qui ressemblait plus à une mitraillette qu’à un pistolet. Les yeux de la jeune fille roulèrent de terreur quand elle sentit le museau du 45 sur son ventre.
- S’il vous plaît, ouvrez… l’argent c’est une chose, mais nos vies en sont une autre, supplia t-elle.
Mais le type n’en avait rien à foutre, alors je lui ai balancé :
- Si tu n’ouvres pas, je vais couper cette fille en deux.
Je n’avais aucune intention de tirer. Mais en disant cela, j’ai imaginé que cela pourrait aider le caissier à sauver la face. J’ai pensé qu’il pourrait ouvrir le coffre-fort et dire ensuite qu’il devait le faire pour sauver la vie de la fille. Mais il était complètement borné. Il m’a juste regardé et a à peine cligné des yeux.
- Allez-y, je la connais pas cette dame. Vous pouvez lui tirer dessus et me descendre après, mais jamais je n’ouvrirai ce coffre.
J’ai ramené la fille avec les otages. Nous étions maintenant à la banque depuis vingt minutes. Deux autres clients sont arrivés. Christman les a conduits avec les autres. Puis un garçon d’environ onze ou douze ans est entré. Je l’ai pris par le bras.
- Petit, c’est un cambriolage, mais t’inquiète. On te fera pas de mal.
- Enlève tes sales pattes de moi, m’a balancé ce merdeux !
Qu’est-ce que c’était que cette ville de malades ? D’autres clients arrivaient et Christman les dirigeaient toujours dans la pièce du fond. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu une serveuse qui sortait du restaurant de l’autre côté de la rue. Elle avait un livret de banque à la main et des factures. Elle a traversé et est entrée dans notre banque.
- Ma jolie c’est une attaque à main armée !
Je l’ai emmenée dans la pièce du fond. Ils étaient tous là, sept employés, les deux fermiers sourds, le sale gosse de douze ans et une douzaine d’autres clients. Ils étaient de plus en plus serrés les uns contre les autres. C’était aussi bondé qu’une rame de métro à l’heure de pointe.
J’ai dit à la serveuse de s’asseoir sous la table.
Dans la chambre forte, le caissier avait moins fière allure. Freddie et DeVol l’avaient salement tabassé, et il saignait. Mais il continuait de refuser d’ouvrir ce putain de coffre.
- Essayons de trouver d’autre fric dans cette chambre forte, suggéra DeVol.
- OK mais on ne peut pas s’éterniser ici, ai-je dit.
C’était en train de devenir l’un des plus longs braquages de banque de l’histoire.
DeVol a encore essayé avec le caissier.
- Comment tu as envie que je te crève ? A-t-il demandé.
Le Hollandais a juste secoué la tête.
Je suis revenu voir Christman.
- J’en ai encore mis deux, a-t-il dit.
J’ai regardé par la fenêtre. Doyle avait des problèmes lui aussi. Un homme et une femme dans la voiture derrière la nôtre avaient manifestement vu ce qui se passait dans la banque, et Doyle avait manœuvré notre voiture pour les bloquer. Ils étaient assis, collés à leurs sièges.
J’ai vérifié la rue. Pas encore de flics. Mais de l’autre côté de la rue, dans le restaurant, je pouvais voir un mec qui semblait être le propriétaire et une autre serveuse qui faisait un signe de la main. Elle se retourna, passa la porte du restaurant et traversa la rue en direction de la banque.
- Tu cherches ta copine ? dis-je dès qu’elle eut franchi la porte.
- Ouais, dit-elle. Monsieur Georges n’est pas content, il pense qu’elle est en train de se foutre de lui.
- Mais bordel on est en train de voler cette banque ! J’en pouvais plus de répéter ça sans arrêt. Ta copine est sous la table dans la pièce du fond et tu vas aller te planquer avec elle.
Ça faisait trente-cinq minutes que nous étions dans cette putain de banque. La police de Concordia n’avait toujours pas eu vent de ce qui se passait. Soudain, la porte de la banque s’est ouverte sur un autre mec. J’ai tourné mon quarante cinq dans sa direction. C’était le propriétaire du restaurant, Monsieur Georges. Il vit l’arme et son visage se figea.
- Espèce de fils de pute ! j’ai crié. Je devais lâcher mes nerfs sur quelqu’un. Tu crois que c’est une blague ? Je te préviens que si on doit tirer, je commence par toi.
Je l’ai poussé dans la pièce du fond.
- OK, dit DeVol au caissier, c’est ta dernière chance : tu ouvres ou je te bute.
Toujours non.
- On se casse les gars… dis-je. Nous sommes ici depuis trois quarts d’heure.
Et nous avons filé. Le coffre-fort est resté désespérément fermé, l’argent encore à l’intérieur, et le caissier assis par terre, marmonnant à travers ses lèvres en sang.
Nous avons pris deux filles avec nous en otage. C’était ce qu’on faisait d’habitude dans n’importe quel braquage : mettre deux nanas sur les marchepieds de la voiture pour décourager les flics de nous tirer dessus. Mais il n’y avait pas de policiers. Ils étaient encore plus nuls que nous ce jour-là. Quoi qu’il en soit, nous avons laissé les filles après quelques kilomètres et elles nous ont remerciés en pleurant.
Nous avons filé au nord de Concordia pour faire croire que nous prenions la route du Nebraska. Puis nous avons tourné vers l’est. Nous avons failli nous embourber, alors on a changé de route. Changement de plan ça voulait dire que nos calculs de kilométrages ne valaient plus rien. Et naturellement, nous nous sommes perdus.
Coup de bol, nous nous sommes faufilés hors du Kansas à travers le Missouri. Mais dans le sud du Minnesota, nous nous sommes à nouveau paumés et nous avons essayé de mettre le cap sur Saint Paul avec une boussole. Le problème était que tout le monde avait son idée sur la façon de lire la boussole. Nous avons finalement abandonné et essayé de tracer notre route en nous aidant des étoiles.
- C’est la Grande Ourse, dit Doyle en montrant le ciel. Je travaille la nuit moi, je sais à quoi elle ressemble !
- Quel con ! dit DeVol. J’ai été un cambrioleur de nuit aussi, et c’est la Petite Ourse ça !
On s’est engueulés toute la nuit en tournant en rond. Il a fallu des heures avant d’atteindre White Bear Lake, nous en avions marre et nous étions crevés. Mais une bonne nouvelle nous attendait. Nous avons jeté nos sacs sur l’un des lits et avons compté 22 000 $ en espèces.
Parmi les documents que nous avions pris dans la chambre forte, il y avait aussi des bons au porteur, pour la plupart non négociables, et un autre document marrant.
- Regarde ça, a dit DeVol. Nous avons volé l’acte de propriété du palais de justice de Concordia.
Je ne crois pas qu’il existe ce qu’on appelle un « criminel né », et pourtant je n’étais pas bien vieux lorsque j’ai décidé de faire carrière dans le crime. La première fois que je me suis senti attiré par le vice, ce fut dans les faubourgs de Topeka au Kansas, où je grandissais dans une grande maison vétuste de la Deuxième Rue. Je vivais avec mes parents, ma sœur aînée et deux sœurs cadettes. Si tout le monde menait une vie bien rangée, moi, je passais mon temps à traîner du côté de Kansas Avenue et de la Quatrième Rue. À l’époque, les putains, les macs et les flambeurs à la petite semaine opéraient dans le secteur et je ramassais un dollar par-ci par-là, en faisant le coursier pour l’un ou pour l’autre, et j’aimais ça : ce genre de vie me plaisait. J’avais dix ans et, déjà, je crois bien, je me préparais à devenir l’Ennemi public numéro un des États-Unis.
En réalité, je n’étais pas américain et ne suis d’ailleurs jamais devenu citoyen des États-Unis. J’étais canadien, raison pour laquelle le gouvernement des États-Unis m’a expulsé au Canada lorsqu’ils m’ont finalement libéré de prison en 1969. Je suis né à Montréal, au Québec. Mes parents, John et Anna Karpowicz, étaient Lituaniens et ils ont échoué à Topeka en passant par Londres, Montréal et Grand Rapids, dans le Michigan. Ils ont eu un enfant à chaque étape - Mihalin à Londres, moi à Montréal, Emily à Grand Rapids et Clara à Topeka.
C’est à Topeka que mon père s’est fixé le plus longtemps. La maison de la Deuxième Rue avait un étage et derrière se trouvaient une étable avec des vaches laitières et un poulailler. Il travaillait comme un esclave pour gagner de l’argent pour ma mère et nous autres. Il faisait marcher la ferme, si l’on peut qualifier de cette appellation la bâtisse délabrée dans laquelle nous vivions, et il occupait en même temps un emploi à plein temps comme peintre publicitaire pour le chemin de fer de Santa Fé. Il ne cessait jamais de s’activer et il en attendait autant de sa famille. En fait, il se servait d’un fouet de charretier pour me faire travailler quand je renâclais à la tâche. Mes sœurs ne lui posaient pas les mêmes problèmes. C’étaient des filles honnêtes, dures au travail. Ma mère me témoignait plus d’indulgence que mon père. C’était une femme douce et bonne, mais je doute qu’elle m’ait vraiment jamais compris. Et il y a un autre adulte qui a marqué mon enfance : l’institutrice de l’école élémentaire Branner qui, un beau jour, a tout tranquillement transformé mon nom d’Albin Karpowicz en Alvin Karpis. Selon elle, c’était plus facile à prononcer. Et, en dehors des faux noms que j’ai pris à diverses occasions pour des raisons professionnelles, ce nom m’est resté.
Mais la personne qui a fait sur moi l’impression la plus durable lorsque j’étais gamin, c’est Arthur Witchey : à dix-huit ans il sortait tout droit d’une maison de redressement. À dix ans, je le considérais comme un authentique caïd et, quand il m’a demandé si ça me plairait de cambrioler une épicerie avec lui, je n’ai pas eu l’ombre d’une hésitation. « Et comment ! » j’ai dit. Je piaffais d’impatience, rêvant d’accéder à ce que j’estimais les sphères supérieures. Faire des courses pour les truands, c’était une chose. Effectuer un coup, c’était gravir un échelon. Et ça semblait si simple ! Une nuit, Arthur et moi sommes entrés dans une épicerie, on a raflé tout le fric et toutes les marchandises faciles à écouler, et on a filé.
Arthur m’avait lancé et, au cours des années suivantes, j’ai fait déferler sur Topeka ma petite vague personnelle de délits. Si je voyais quelque chose qui me plaisait dans un magasin, j’attendais tout bonnement le moment favorable et, une fois la nuit tombée, je balançais une brique dans la vitrine et volais l’objet convoité. J’ai appris à repérer l’itinéraire des flics en patrouille, à bien épier les magasins que je voulais visiter, en un mot, à me débrouiller. Tout ça n’était que de la broutille, bien sûr, mais je ne me suis jamais fait pincer, et la seule chose qui ait mis fin à mes débordements, ça a été la décision de mon père d’aller habiter Chicago.
J’avais quinze ans et là-haut, dans le Nord, j’ai connu une courte période d’honnêteté. Mon père avait trouvé un emploi de concierge. Mihalin s’est mariée et, peu de temps après, ce fut le tour d’Emily, le membre de la famille dont je m’étais toujours senti le plus proche. Clara allait encore en classe et j’ai travaillé d’abord comme garçon de courses, puis comme expéditeur dans une maison de produits pharmaceutiques. J’ai donc suivi le droit chemin pendant près de deux ans, jusqu’au printemps de 1925 où j’ai été atteint de je ne sais quels troubles cardiaques et où le docteur m’a conseillé de trouver un travail moins pénible.
Quand j’y pense maintenant, ça me fait bien rigoler. J’ai dû renoncer à mon boulot honnête pour ménager mon cœur et je me suis aussitôt relancé dans mes activités criminelles qui, c’est le moins qu’on puisse dire, peuvent être assez éprouvantes, elles aussi, pour le cœur ! J’ai quitté Chicago pour retourner à Topeka et je me suis mis en cheville avec un ami aussi porté que moi sur le « business ». À nous deux on a monté un stand de hamburgers qui servait en même temps de base pour la vente illicite d’alcool. On se faisait également des extras en cambriolant les entrepôts. Peu nous importait ce qu’on volait : pneus, bonbons, couteaux de poche, tout ce qui nous tombait sous la main.
Une autre activité qui absorbait pas mal de mon temps alors, c’étaient les voyages en chemin de fer. J’adorais le bruit et les trépidations des trains. Mon amour pour le rail me vient peut-être de mon enfance, car notre maison de la Deuxième Rue s’élevait juste à côté d’une voie ferrée. Les trains me fascinaient. J’en ai vu, de tous les coins des États-Unis, depuis le sud d’Iowa en passant par le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma et l’Arkansas jusqu’en Louisiane et dans le Mississippi, et depuis l’ouest de l’Ohio en passant par le Michigan, l’Illinois, le Wisconsin et le Minnesota pour échouer dans les deux Dakotas. Les trains passaient partout en ce temps-là, et c’était ce que je voulais… aller partout.
Les chemins de fer m’étaient plus familiers qu’à n’importe quel contrôleur. Je connaissais tous les petits détails indispensables aux resquilleurs. Je savais par exemple où s’arrêtait le Santa Fé pour prendre de l’eau, où ralentissait le Golden State pour amorcer un virage, quelles villes traversait le Katy. En plus, je récoltais une foule de renseignements intéressants sur les villes et les villages échelonnés le long des voies ferrées. Je savais par exemple où se trouvaient les meilleurs magasins d’habillement ou encore les stands d’exposition de voitures les plus prospères. Ce genre de tuyaux pouvait se révéler utile à un gars qui avait choisi de faire carrière dans le cambriolage.
C’est à bord d’un train que j’ai eu mes premiers ennuis sérieux avec la police. Ça s’est passé à Van Buren, dans l’Arkansas, avec un flic des chemins de fer. Il avait la réputation d’être le contrôleur le plus coriace de la région et avait la manie de fouiller les wagons de marchandises à la recherche de clochards. Je n’ai pas attendu qu’il braque sa torche électrique sur moi. J’ai sauté en bas du wagon et j’ai tiré tout en cavalant.
Plus tard, c’est en voyageant sur le toit du Pan American pour gagner la Floride que je me suis fait pincer et je me suis tapé trente jours de pénitencier. Je ne peux pas dire que c’était marrant, mais en tout cas personne ne m’a matraqué. Je m’en suis tiré sans dommage, à l’exception d’un détail : mon casier judiciaire n’était plus vierge. Si bien que quand je me suis fait coincer au cours d’un cambriolage, j’ai écopé d’une longue peine.
Mon arrestation n’a rien eu de sensationnel. Ça s’est passé en 1926 et j’avais dix-huit ans. Je me livrais à un boulot tout à fait courant, le casse d’un entrepôt dans une petite ville du Kansas. J’étais tout bêtement en train de regarder autour de moi ce qui valait le coup d’être embarqué quand les flics se sont amenés et m’ont surpris. Tout comme le juge quand j’ai comparu devant le tribunal quelques jours plus tard.
[1] Agent du FBI