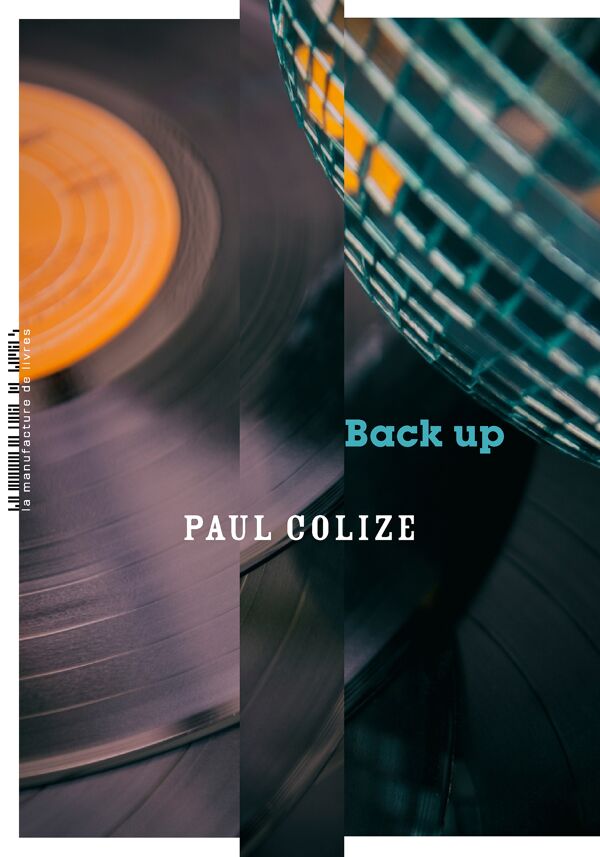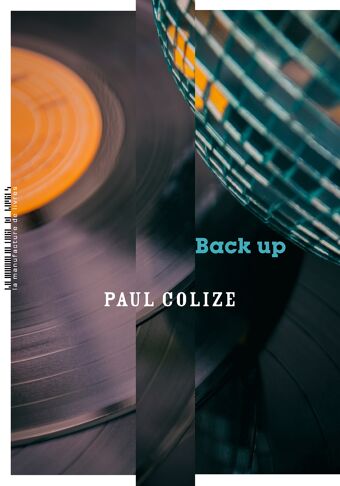
Paul Colize
Back up
Berlin, 1967. Les musiciens du groupe de rock Pearl Harbor trouvent la mort coup sur coup. La police conclut à des décès naturels mais un journaliste reprend l’enquête qui s’enlise.
Bruxelles, 2010. Un sans-papier amnésique suite à un accident retrouve petit à petit ses souvenirs : ses premières amours pour Chuck Berry et Elvis Presley, son adolescence dans l’euphorie des sixties, sa carrière de batteur de génie entre la France, Londres et Berlin et surtout ce jour où il remplace au pied levé le batteur du groupe Pearl Harbor pour l’enregistrement d’un titre qui ne sera jamais commercialisé…
Sur fond de rock’n’roll et de guerre du Vietnam, ce polar plein de fausses pistes nous révèle pas à pas une formidable machination et nous livre les clés d’un mystère vieux de quarante ans.
Ce livre a été réédité dans le cadre de l’opération « 10 ans, 10 livres » de La Manufacture de livres.
- La bibliographie, la filmographie, le détail de la bande-son incitent à ne pas prendre à la légère ce roman qui ne manque pas de charme et aurait pu prendre la forme, aujourd’hui à la mode, d’un dictionnaire amoureux. Sa forme actuelle suffit à persuader qu’il est urgent de (re)découvrir Colize.
- Une plongée au cœur des 60’s, de Berlin à Londres, au rythme des plus grands du rock pour un polar original que vous ne lâcherez pas !
- téléchargez l’extrait
1. Un joli petit oiseau
Larry Speed débarqua à l’aéroport de Majorque le samedi 18 mars 1967 en milieu d’après-midi.
À la sortie de l’avion, il cligna des yeux, chaussa ses lunettes noires et ôta son blouson de cuir. Lorsqu’il avait quitté Tempelhof, quelques heures plus tôt, Berlin se perdait dans la brume et la température ne dépassait pas cinq degrés.
Au lendemain de l’enregistrement, c’est lui qui avait suggéré aux autres de s’offrir quelques jours de vacances. Avec trois mille marks dans la poche et quinze mois de travail dans les jambes, il estimait que c’était plus que mérité. De plus, la co-habitation et la promiscuité prolongées avaient entraîné son inévitable lot de tensions et de tiraillements.
De sa voix éraillée, il les avait convaincus qu’un peu de recul leur serait bénéfique.
Les autres avaient acquiescé.
Dans l’après-midi, il s’était rendu dans une agence de voyages sur le Kurfürstendamm. La gérante lui avait proposé Majorque, la Grèce ou Istanbul.
Goguenard, il lui avait adressé un clin d’œil et lui avait demandé où il y avait le plus de bonnes putes à baiser.
La femme était restée de marbre et lui avait recommandé les Baléares, destination pour laquelle il restait des places disponibles dans l’avion du samedi.
Le jour venu, il avait empilé quelques affaires dans une valise, glissé sa Fender dans son étui et commandé un taxi pour l’aéroport. Il avait également pris soin d’emporter son Teppaz à piles et quelques 33 tours dont Fresh Cream, l’album du power trio qui tournait en boucle dans la chambre depuis trois mois.Larry Speed, de son vrai nom Larry Finch, était le fondateur et le leader de Pearl Harbor, le groupe de rock qu’il avait formé trois ans auparavant, alors qu’il vivait encore à Batter-sea, un quartier de la banlieue sud de Londres.
Enfant illégitime, il n’avait pas connu son père, un insatiable coureur de jupons qui avait disparu du jour au lendemain quelques semaines avant sa naissance. Il avait passé son enfance et la majeure partie de son adolescence au second étage d’une modeste maison de Queenstown Road, choyé par une mère omniprésente qui l’idolâtrait.
Durant près de vingt ans, les quatre gigantesques cheminées de la centrale électrique construite sur le versant de la Tamise lui avaient servi d’horizon.
À l’inverse du mythe qui veut qu’un bassiste de rock soit un bagarreur intrépide, prompt à passer à tabac le premier contradicteur venu, Larry était un blanc-bec chétif, au visage émacié, au teint maladif et au courage limité.
Sous l’impulsion de sa mère, il avait suivi des cours de solfège et appris le piano à l’âge de huit ans. Quatre ans plus tard, il était passé à la guitare jazz, pour rapidement basculer vers la basse et suivre les pas de son modèle de l’époque, Charlie Mingus.
De sa formation classique, il avait conservé la rigueur et la précision. Il affirmait avec le plus grand sérieux que les lignes de basses les plus abouties avaient été composées deux siècles auparavant par Jean-Sébastien Bach et que personne ne l’avait surpassé, excepté Jack Bruce.
Introverti, taciturne, misanthrope, il masquait son mal de vivre derrière un sourire cauteleux et des sarcasmes assassins.
Néanmoins, il subissait de saisissantes métamorphoses lorsqu’il entrait en scène. Il devenait alors excentrique, enjoué et gesticulait comme un forcené.Peu avant seize heures, il arriva au Punta Negra, un hôtel flambant neuf perché sur une petite péninsule de la Costa d’en Blanes, à une vingtaine de kilomètres de Palma.
Il prit possession de sa chambre, ouvrit sa valise et en étendit le contenu sur le sol.
Une demi-heure plus tard, il fit son apparition à la piscine de l’hôtel où sa peau fatiguée, ses longs cheveux noirs et sa chemise à franges ouverte sur son torse décharné détonnèrent avec le hâle et les rondeurs des vacanciers allongés sur les chaises longues. Pour souligner le contraste, ses bras étaient chargés de tatouages dont le plus explicite louait les bienfaits de la fellation.
Scandalisés, les clients de l’hôtel échangèrent à mi-voix des propos en l’épiant du coin de l’œil.
Indifférent aux regards suspicieux, Larry s’accouda au bar et commanda une bière qu’il avala d’un trait. Déconcerté par le prix dérisoire qui lui fut réclamé, il passa à la vitesse supérieure et relança au gin coca.Vers dix-huit heures, alors que le soleil commençait à décliner, il avait ingurgité assez d’alcool et offert suffisamment de pourboires au barman pour s’enquérir des possibilités de divertissement aptes à pimenter son séjour. Ce dernier lui apprit que Majorque bénéficiait au quinzième siècle d’un bordel public dont la dextérité des pensionnaires attirait les marins à vingt mille lieues à la ronde. D’après ses dires, l’attachement au travail bien mené s’était transmis au fil du temps. Il l’aiguilla vers quelques lieux opportuns en lui vantant le Mustang et le Bora Bora.
Larry remonta dans sa chambre et passa commande au service d’étage d’un demi-poulet rôti, de pommes frites, de petits pois et d’une bouteille de rosé bien frais.Selon les déclarations que firent les occupants voisins, il avait pris son repas devant la télévision en reproduisant à tue tête le discours du commentateur espagnol. Il avait ensuite écouté quelques LP en sautant à pieds joints dans la pièce.
Un taxi vint le chercher à vingt-trois heures et le déposa au Mustang Ranch, à Bajos, dans le centre de Palma.
Dans le night-club, il fut approché par plusieurs entraîneuses et jeta son dévolu sur Nadia, une femme aux cheveux noir jais et aux formes généreuses, plus âgée que les nymphettes qu’il avait écartées. Il lui offrit une coupe de champagne français et fit quelques pas de danse avec elle. Ils se mirent ensuite d’accord sur la somme de dix mille pesetas en contrepartie de ce que Nadia nommait le grand vertige.
Vers deux heures trente, il commanda un taxi. Ils s’y engouffrèrent et prirent la direction du Punta Negra.Le portier de nuit de l’hôtel les vit entrer vers trois heures du matin. Il déclara par la suite que le couple semblait dans un état d’ébriété avancé.
Vers cinq heures du matin, Nadia se présenta à la réception et demanda au portier de lui appeler un taxi. Elle titubait quelque peu, mais ne semblait ni affolée ni anxieuse.
Interrogée plus tard, Nadia affirma que Larry dormait paisiblement lorsqu’elle l’avait quitté.Comme chaque dimanche, l’employé chargé d’entretenir les jardins commença son travail à six heures trente, soit une heure plus tôt que les autres jours de la semaine, dans le but d’assister à la messe à onze heures.
Il entama le nettoyage de la piscine vers sept heures quarante-cinq et discerna le corps d’un homme dans le fond. Il appela aussitôt à l’aide. Deux cuisiniers assistés d’un serveur vinrent à la rescousse. Les hommes hissèrent Larry Finch hors de l’eau, mais ne purent que constater son décès.
Le médecin légiste dépêché par la police conclut à une mort par asphyxie ayant entraîné un œdème pulmonaire traumatique et situa l’heure de la noyade aux alentours de six heures du matin.
Nadia, de son vrai nom Marta Rego, précisa dans sa déclaration à la police que Larry avait beaucoup bu et s’était enfermé à plusieurs reprises dans la salle de bain durant quelques minutes.
Hormis la bordée d’obscénités dont il l’avait abreuvée pendant leurs ébats, elle l’avait trouvé plutôt gentil. Selon elle, il avait fait preuve d’une sexualité à la normalité consternante.
En plus des trois grammes d’alcool présents dans son système sanguin, les analyses dépistèrent la présence de codéine, de diazépam, de morphine et d’acide lysergique, un hallucinogène de synthèse plus connu sous l’acronyme LSD.
La police en conclut que Larry Finch était vraisemblablement descendu pour se baigner et avait été victime d’une hydrocution.Lorsque la mère de Larry apprit son décès par téléphone, elle fit couler un bain chaud, s’y plongea avec une photo de son fils et s’ouvrit les veines.
Pendant que la vie quittait son corps, elle fredonna les couplets de Hush Little Baby, la berceuse qu’elle lui chantait durant les premières années de sa vie.Hush, little baby, don’t say a word,
Mama’s gonna buy you a mockingbirdChut, petit bébé, ne dis pas un mot
Maman t’achètera un joli petit oiseau2. X Midi
L’appel arriva au service d’urgence à 18.12 heures.
Une femme signalait qu’un piéton avait été renversé par une voiture sur l’avenue Fonsny, à proximité de l’entrée de la gare du Midi.
Le préposé lui posa les questions susceptibles d’évaluer la gravité de la situation.
— Y a-t-il d’autres blessés ?
— Non.
— Lui avez-vous parlé ?
— Quelqu’un a essayé, mais il ne répond pas.
— Est-il conscient ?
— Je ne pense pas.
— Est-ce qu’il bouge ? Est-ce qu’il remue les jambes ou les bras ?
— Non, pas à première vue.
Il déclencha aussitôt le dispositif d’intervention.
Une ambulance se rendit sur les lieux et l’hôpital Saint-Pierre fut averti que l’envoi d’une équipe du SMUR était requis.
Les informations furent immédiatement relayées au central de la police, comme la procédure l’exigeait. Une patrouille mobile qui circulait dans le quartier prit aussitôt la direction de la gare du Midi. À grand renfort de hurlements stridents, la voiture se faufila dans le trafic, monta sur le terre-plein et se gara tant bien que mal devant l’entrée de la gare.
Les policiers coupèrent la sirène, mais laissèrent tourner les gyrophares. Ils sortirent, ajustèrent leur tenue et se dirigèrent d’un pas nonchalant vers l’attroupement.
Une vingtaine de personnes se tenaient en demi-cercle autour d’un taxi. Le véhicule gênait le passage, ce qui engendrait un concert d’avertisseurs en arrière-plan.
Un homme se détacha du groupe et vint à leur rencontre.
Il semblait affolé.
— Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a traversé d’un coup, sans regarder. Il s’est jeté sous la voiture, j’ai freiné dès que je l’ai vu, mais c’était trop tard, je n’y suis pour rien.
L’un des policiers fit reculer les badauds de quelques mètres. Son collègue se risqua sur l’avenue pour résorber l’embouteillage.
À intervalles réguliers, la gare crachait des bouffées de passagers qui s’éparpillaient sur le trottoir. Certains venaient grossir les rangs des curieux, d’autres pressaient le pas, indifférents au drame qui se déroulait sous leurs yeux, impatients de retrouver leur foyer ou de décompresser dans l’un des cafés avoisinants. Quelques étudiants jetèrent un vague coup d’œil à la scène, les écouteurs fichés dans les oreilles, détachés de la réalité dans leur bulle de musique.
L’ambulance apparut quelques instants plus tard, sirènes en action, suivie de près par le 4x4 jaune du SMUR.
Le médecin se précipita et s’accroupit auprès de l’homme qui gisait en partie sous le taxi. Il se pencha, guetta sa respiration, inspecta ses yeux. Il lui glissa quelques mots à l’oreille, attendit en vain une réaction. Il examina ses bras, ses jambes, lui prit le poignet.
Son assistant vint aux nouvelles.
— Alors ?
— Le pouls est bien frappé, mais il a un Glasgow à 4.
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— On va le taper dans le camion. Il y a trop de monde ici et il fait presque noir. En plus, il commence à dracher.
L’infirmier leva les yeux vers le ciel. Quelques gouttes de pluie s’écrasèrent sur son visage.
— Ok, je vais chercher le scoop.
L’urgentiste dégagea précautionneusement la tête de la victime et lui plaça un collier cervical. Il découvrit une plaie sur le haut du crâne.
L’infirmier revint muni de la civière métallique.
Le médecin saisit les bras de l’homme et les croisa sur son ventre. Il posa une main sous l’omoplate de la victime, l’autre sous une fesse et le décolla du sol en le tirant vers lui.
L’infirmier glissa la première partie du scoop sous le corps de l’homme et soupira bruyamment.
— Putain ! Qu’est-ce qu’il fouette ! C’est à croire qu’ils nous en veulent, c’est mon deuxième SDF de la semaine.
L’homme à terre portait une barbe embroussaillée et de longs cheveux poisseux gonflés d’eau et de sang. Il était vêtu d’un épais manteau informe, troué en de nombreux endroits.
Ils renouvelèrent l’opération sur l’autre flanc et allongèrent le blessé sur la civière.
Les curieux s’étaient multipliés. Les témoins de l’accident livraient en aparté leur version des faits aux nouveaux venus. La pluie s’était mise à tomber et quelques parapluies s’étaient déployés. Une bande d’ados en jeans et blouson de cuir fendit la foule en jouant des coudes.
L’un d’eux franchit le périmètre délimité, considéra la scène et toisa le policier.
— Font chier, ces clodos ! Qu’il crève, ce con !
Le policier le dévisagea sans sourciller. Le face-à-face se prolongea pendant quelques instants. Le meneur roula un crachat et l’expulsa en direction de l’homme au sol puis rebroussa chemin, suivi comme son ombre par sa clique.
Les urgentistes transportèrent l’homme sous le regard des ambulanciers qui attendaient le moment pour entrer en piste.
Lorsque la victime fut à l’abri dans l’habitacle, le policier en faction s’approcha et s’adressa au médecin.
— Vie en danger ?
Le médecin acquiesça.
— Oui, je vous donne ses papiers dans une minute.
Il pénétra dans l’ambulance, prit une paire de ciseaux, découpa les vêtements de l’homme et fouilla ses poches. Il en sortit deux mégots, un briquet jetable, deux ou trois billets de banque et des pièces de monnaie.
Il héla le policier et lui présenta les objets.
— C’est tout. Pas de papier.
L’infirmier fit un aller-retour dans la BMW X5, revint les bras chargés de l’équipement nécessaire et entra à son tour.
Le médecin ausculta le thorax et les poumons de l’homme.
— Abdomen souple, bassin stable.
— Les jambes ?
— Pas de fracture à première vue, mais sa tête a heurté le sol ou une autre bagnole, il saigne un peu. Je checke la neuro.
Il pinça l’homme au niveau des deltoïdes.
— Pas de réaction. Il n’ouvre pas les yeux.
— Pas de flexion des bras, pas de mouvements des jambes non plus.
— Mets-lui une perf, on va l’intuber.
L’infirmier prépara l’anesthésie pendant que le médecin appliquait des électrodes sur les épaules et le ventre de l’homme. Il ajusta le saturomètre sur l’un des doigts et referma le brassard du tensiomètre autour d’un des biceps.
D’un geste assuré, le médecin ouvrit la bouche de l’homme et inséra le tube endotrachéal.
Il jeta ensuite un coup d’œil aux instruments.
— Tu as raison, il pue la rage, le lascar. En plus, il devait être bourré, c’est un vrai tonneau de gnôle.
— On y va ?
— Oui, c’est bon.
Le médecin prit contact avec le service de réanimation de l’hôpital.
— Jacques ? C’est Guy, j’arrive avec un trauma crânien intubé et ventilé.
— Ok, je te prépare ça.
L’infirmier rejoignit son véhicule.
Le médecin resta dans l’ambulance auprès de l’homme. Les pompiers grimpèrent à leur tour dans l’habitacle. Les deux véhicules s’ébranlèrent et descendirent l’avenue Fonsny en direction de la rue Haute et de l’hôpital Saint-Pierre, distant de moins de deux kilomètres.
En convoi serré, ils se faufilèrent dans les embouteillages de fin de journée, franchirent le portail de l’hôpital et s’engouffrèrent dans l’entrée des urgences.
Deux internes vinrent leur prêter mainforte pour sortir la civière. Ils posèrent l’homme sur un brancard et l’emmenèrent dans un box de déchoquage. L’un des infirmiers le déshabilla.
Il ne put réprimer une grimace.
— Vous l’avez trouvé dans une décharge ?
Il brancha le monitoring, replaça le saturomètre et le tensiomètre.
Le médecin fit la moue.
— Je n’ai pas trouvé de papiers, tu as quelque chose ?
— Rien.
— Tant pis. On lui fait un total body.
Ils pratiquèrent un scanner de la colonne cervicale et du cerveau suivi d’une injection de produit de contraste pour explorer l’abdomen et le thorax.
Le médecin émit le diagnostic.
— Contusions cérébrales, deux côtes cassées, une plaie à la tête. Il y a un peu de sang dans le tube. Il est stable, regarde s’il y a de la place aux soins intensifs.
L’infirmier saisit le téléphone mural.
— Nous avons un trauma crânien. Homme. Entre soixante et soixante-cinq ans.
— Tu peux le monter dans dix minutes.
— Je préviens le neurochirurgien ?
— Je m’en occupe.À 18.57 heures, l’homme fut transféré au service des soins intensifs. L’équipe de garde le réexamina complètement. Deux aides-soignantes le lavèrent des pieds à la tête, mais l’odeur nauséabonde qu’il dégageait s’estompa à peine.
Le neurochirurgien lui rendit visite en milieu de soirée, consigna ses observations et se rendit chez le responsable du service.
— Arrêtez les médocs, on va voir s’il se réveille.Aux environs de minuit, un policier vint aux nouvelles. Aucun papier n’avait été trouvé sur l’homme. Seule l’une des aides-soignantes avait relevé un indice, quelques données griffonnées au marqueur sur sa main gauche : A20P7.
Le policier haussa les épaules.
— Avec ça, on n’ira pas loin. À part attendre quelques jours pour voir s’il y a un avis de disparition qui correspond, il n’y a pas grand-chose à faire.Le lendemain, à l’ouverture du secrétariat, l’employée administrative remplit la fiche d’enregistrement et mentionna que le sujet avait été admis à l’hôpital le jeudi 11 février 2010, à 18.45 heures.
À l’emplacement du patronyme, elle inscrivit : X Midi.3. Un sans abri
Une semaine après son admission à l’unité de soins intensifs, l’homme n’avait pas repris connaissance. L’équipe médicale avait suspendu l’administration de substances anesthésiques et s’était livrée à une surveillance rapprochée, mais aucune réaction n’avait été observée.
Les résultats de l’exploration électro physiologique ne laissaient espérer aucune évolution favorable à court terme.
Le rapport de l’examen tomodensitométrique cérébral mentionnait la présence d’une hémorragie sous-arachnoïdienne limitée dans la région sylvienne droite, sans œdème cérébral ni déviation du système ventriculaire.
La résonance magnétique avait détecté des lésions axonales diffuses dans le mésencéphale et plus particulièrement une lésion stratégique touchant les deux pédoncules cérébraux.
Enfin, les analyses sanguines avaient indiqué que l’homme était dans un état de santé satisfaisant. Seuls des signes de diabète avaient été dépistés. Le tensiomètre avait établi qu’il souffrait d’un peu d’hypertension et la cicatrice d’une ancienne blessure avait été relevée sur son épaule gauche.
Assez curieusement, il ne présentait aucune avitaminose, comme c’était souvent le cas chez les SDF.Avant que l’équipe de nuit ne s’en aille pour laisser place au personnel de jour, le médecin-chef s’empara du rapport médical de X Midi, appela les infirmières et se rendit avec elles au chevet de l’homme.
Tout en consultant le document, il s’adressa à l’infirmière de nuit.
— Avez-vous observé une réaction au cours des dernières heures ?
Elle répondit par la négative.
— Non, aucune réaction. Pas de sueur, pas d’agitation non plus.
Le médecin se pencha et examina les pupilles de l’homme.
— Il est stable, je vais l’extuber.
L’opération prit moins d’une minute. Lorsque le tube fut retiré et le masque à oxygène mis en place, il s’adressa à la seconde infirmière.
— Prenez contact avec la neuro et demandez-leur de préprer une chambre. Nous allons encore le garder ici ce matin. S’il n’y a pas de complications, nous le monterons en fin de matinée.
— Bien, Monsieur.
— Surveillez-le pendant la prochaine heure. Refaites un Glasgow avant de le transférer. En attendant, continuez la Fraxiparine et le Perfusalgan.
Elle approuva d’un mouvement de tête.
La seconde femme jeta un coup d’œil au patient et baissa le ton.
— Il faut que je vous parle, Monsieur.
Le médecin suivit la direction de son regard et prit l’air surpris.
— Vous le connaissez ?
La veille, deux policiers étaient venus relever les empreintes digitales de l’inconnu. Ils avaient également pris quelques photos dans l’espoir de pouvoir l’identifier. Jusque-là, aucune famille ne s’était manifestée pour signaler la disparition de quelqu’un répondant à son signalement.
L’infirmière esquissa un maigre sourire.
— Non, ce n’est pas ça.
Il la prit à part.
— Je vous écoute.
— Avant d’entrer ici, j’ai travaillé à César De Paepe pendant trois ans. Pendant l’hiver, ils organisaient un service de soins pour les SDF. Le soir, les sans-abri pouvaient recevoir des soins gratuitement. J’ai été plusieurs fois affectée à ce service.
— J’en ai entendu parler.
— Les hommes que j’ai soignés là-bas présentaient des caractéristiques similaires. Quel que soit leur âge ou leur état de santé général, ils avaient les dents gâtées et les ongles des pieds en très mauvais état. Ils développaient une sorte de seconde peau sur tout le corps. Il fallait les laver quatre ou cinq fois pour atteindre un début de résultat. En plus, ils présentaient des symptômes liés aux carences vitaminiques. Un autre indicateur nous permettait de repérer les SDF de longue durée.
Elle s’arrêta, chercha ses mots.
Le médecin intervint.
— L’hygiène intime ?
Elle acquiesça.
— Oui, les SDF perdent les réflexes élémentaires d’hygiène intime.
— Qu’est-ce que vous en concluez ?
— Malgré les apparences, je suis sûre que cet homme n’est pas un sans-abri.4. Le sourire de ma mère
Ma mère disait que ma naissance avait mis fin à la guerre.
Elle disait ça en souriant. J’étais assis dans la cuisine. Je la regardais. Je ne savais pas ce que ces mots voulaient dire. Sans doute étais-je heureux.
Elle préparait le repas, se séchait les mains sur son tablier et me souriait de plus belle.
Je suis né le 6 août 1945.
Plus tard, j’ai appris que ce jour-là, Little Boy, le monstre enfanté à Los Alamos, avait tué cent quarante mille personnes. Cent quarante mille innocents, assassinés, massacrés, brûlés vifs en l’espace de quelques minutes pendant que je sortais du ventre de ma mère. Quand j’ai découvert l’abjection, j’ai vu une ombre s’allonger sur ma ligne de vie. Je n’ai jamais compris que quiconque ait pu se réjouir d’une telle ignominie. Je ne suis jamais parvenu à voir les perspectives optimistes liées à cet événement, mais seulement le tribut expiatoire qui en résultait.De mon enfance, je ne conserve que des impressions diffuses et quelques souvenirs aux contours incertains.
De temps à autre des images, des odeurs ou des sensations surgissent du fond de mon subconscient, issues du trou noir qui a comblé ma vie. L’espace d’un instant, elles émergent, gesticulent. Je les perçois avec une acuité saisissante. Je pourrais en décrire chaque détail.
Ensuite, elles s’éloignent. Certaines reviennent dans le but de me harceler, de m’ensorceler ou de m’émouvoir. D’autres sont comme un flash, elles m’éblouissent puis disparaissent à tout jamais. Des pans entiers de ma vie se sont ainsi estompés dans les miasmes du temps.Je me rappelle qu’il faisait chaud.
Peut-être était-ce la chaleur qui émanait de ma mère qui me laisse cette impression.
Il faisait chaud, la radio diffusait de la musique classique. Les choses semblaient simples, la réalité était accessible.
Nous habitions dans un petit appartement situé au-dessus d’un garage, dans l’avenue de la Couronne, non loin de la caserne de la gendarmerie.
J’étais assis dans la cuisine, je dessinais des mondes nouveaux à l’aide de mes crayons de couleur. Avec mes camions Dinky Toys, mon Meccano et le jeu de cartes que j’avais gagné à la tombola, ils formaient l’ensemble de mes jouets, mon univers.Le passage de la cavalerie constituait la principale attraction de la journée. Dès que j’entendais le bruit des fers sur les pavés, je me ruais à la fenêtre.
Dans l’avenue, tout le monde en faisait autant. Les voisins apparaissaient aux balcons et aux fenêtres. Nous regardions passer les escadrons.
Les chevaux marchaient au pas, à deux, trois, ou cinq de front. Les voitures se rangeaient pour les laisser passer.
Les gens avaient le temps.
Les jours de pluie, les cavaliers étaient couverts d’un long manteau qui se déployait sur la croupe du cheval. Parfois, ils défilaient dans leur tenue d’apparat, avec leur étendard et leur bonnet à poils noir. Ils avaient une sacrée allure.
Personne ne semblait importuné par les monceaux d’excréments que les chevaux abandonnaient derrière eux.
Lorsqu’ils partaient encadrer une manifestation au centre-ville, les gendarmes s’équipaient d’un casque et d’une longue matraque.En fin de matinée, je guettais l’arrivée de la carriole verte de l’Union Économique. Ma mère et moi descendions pour acheter le pain du jour. Je m’approchais du cheval, mais n’osais le caresser. Il portait des cache-yeux. Je tentais en vain de capter son regard. Il me faisait peur.
Vers midi, nous entendions la cloche du marchand de soupe. Je courais à la fenêtre et regardais les gens s’affairer à l’arrière de la camionnette, une casserole à la main.
Dès qu’ils avaient disparu, je retournais dans la cuisine.
Je m’asseyais et regardais ma mère aller et venir.
Je garde la sensation d’avoir passé mon enfance à contempler ma mère dans la cuisine.Les après-midi, je faisais un somme. Je m’allongeais sur mon lit, ma mère tirait les tentures. Je m’endormais aussitôt.
Le grésillement du moulin à café me réveillait.
Quelques instants plus tard, l’arôme emplissait mes narines. Je me levais et allais rejoindre ma mère. Je n’avais pas droit au café, une tasse de Banania et une tranche de pain beurrée couverte de sirop de Liège m’attendaient. Je l’avalais goulûment.
Ma mère disait que je ne mangeais pas, que je dévorais.
Une fois par semaine, le vendredi, elle cirait le parquet. Elle étendait d’abord la cire, la laissait reposer, puis polissait le bois avec une lustreuse manuelle qui pesait une tonne. L’odeur de la cire d’abeille me renvoie à ces vendredis heureux.
J’étais bien. Le temps durait longtemps.
Je suis sûr que ma mère m’aimait. Avec Mary, je pense qu’elle a été la seule femme qui m’ait aimé. Mon père rentrait tard, bien après que mon frère aîné était de retour de l’école. Mon frère s’amusait à me terroriser. Il disait que des bêtes féroces et des extraterrestres se cachaient sous mon lit et attendaient la nuit pour m’attaquer.
Quand mon père arrivait, il sentait la bière et le tabac. Je devais alors m’éclipser dans ma chambre.
Mon père était de mauvaise humeur. Il avait eu une sale journée. Il descendait chercher un sac de charbon à la cave et chargeait la chaudière. Ensuite, il disait à ma mère qu’il voulait une bière et qu’il fallait que les moutards lui fichent la paix.
Ma mère obtempérait.
Mon père était rarement de bonne humeur. Quand ça lui arrivait, il pinçait les fesses de ma mère, ou passait derrière elle, se collait contre son corps et lui attrapait les seins. Ma mère riait, prenait un air faussement offusqué, mais je voyais qu’elle n’aimait pas ça.
Je ne sais pourquoi, ce geste me déplaisait.
Je disparaissais dans la chambre. Je fulminais. J’aurais aimé pouvoir le défier, mais je ne disais rien.Un jour, la terre a tremblé sous mes pieds.
C’était la fin de l’été. Ma mère m’a annoncé que je devais aller à l’école le lendemain, que c’était une bonne nouvelle, que j’allais apprendre un tas de choses.
Je ne voulais pas, j’ai pleuré, j’ai crié. Mon frère jouait le vieil habitué et se moquait de moi. J’ai donné des coups de pied dans les meubles. Mon père m’a donné une gifle et je me suis calmé.
Le lendemain, en arrivant à l’école, j’ai opposé une résistance héroïque. J’ai à nouveau pleuré. Je ne voulais pas que ma mère s’en aille. Je tremblais de rage. Je voulais rentrer à la maison avec elle, m’asseoir dans la cuisine avec mes crayons de couleur et la regarder sourire.
J’ai tenté de transiger. Je consentais à rester à condition que ma mère puisse s’asseoir à mes côtés, sur le banc voisin.
Ils n’ont pas accepté.Mon instituteur s’appelait Père Martin, mais il fallait que je l’appelle Mon Père. Je devais lever le doigt pour pouvoir parler.
J’ai boycotté la procédure, je n’ai jamais rien dit.
Lors des dictées, il surgissait dans mon dos. Il se penchait. Je sentais son souffle dans ma nuque. Les muscles de ma main fondaient. Je ne pouvais plus écrire, je n’étais plus capable de tenir mon porte-plume, de le tremper dans l’encrier.
Je voulais rentrer chez moi et retrouver le sourire de ma mère.C’est à peu près tout.
De mon enfance, il me reste le sourire de ma mère.
5. C’est tout
C’est à la fin d’une effroyable journée, alors que j’avais une dizaine d’années, que j’ai entendu prononcer le mot rock’n’roll pour la première fois.
La disquaire à chignon chez qui nous allions de temps à autre l’a lâché avec dédain en me tendant un disque de Chuck Berry comme l’aurait fait une épicière avec des fruits avariés.
Les lèvres pincées, elle a déclaré que c’était nouveau, qu’on appelait ça du rock’n’roll.
Je n’ai jamais su au juste qui a été le premier rocker ou quelle a été la première chanson rock. Je ne me suis jamais mêlé à ce genre de débat.
Pour moi, le premier rock, c’est Chuck Berry et Maybellene.
C’est tout. Paul Colize, "Back Up", La Manufacture de livres, 14 février 2013